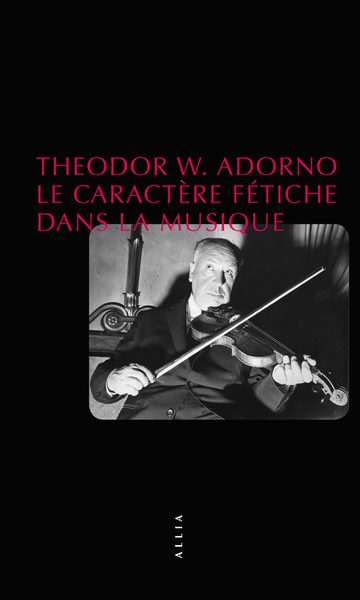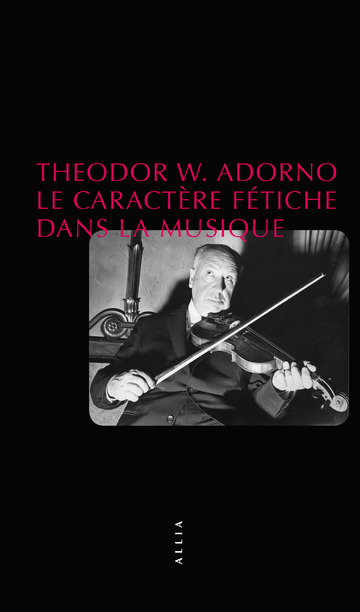Fondé en 1923, l’Institut pour la recherche sociale, devenu l’École de Francfort en 1950, a enfanté, aux côtés de Walter Benjamin et Max Horkheimer, un monstre de la théorie critique du nom de Theodor W. Adorno. Philosophe, compositeur et musicologue, celui-ci a notamment engagé une réflexion extrêmement puissante et exigeante sur la notion d’industrie culturelle qu’il a contribué à forger, à l’aube d’une société de consommation qu’analyseront notamment Guy Debord et Jean Baudrillard en France à la fin des années 1960. Pour T. W. Adorno, qu’elle soit dite légère ou sérieuse, la musique n’échappe pas au puissant phénomène de standardisation et de massification, où la consommation mécanique et servile tend à supplanter toute liberté individuelle et tout jugement critique.
Ce consumérisme de l’art s’exprime tout d’abord dans ce que le philosophe appelle son « caractère fétiche », expression empruntée à Marx – dans le sillage duquel s’inscrit pour une large part l’École de Francfort –, et qui s’explique notamment par l’idée que la valeur d’échange de la musique, devenue une marchandise comme une autre, se substitue à sa valeur d’usage : l’émotion et la satisfaction ne viendraient plus de l’écoute attentive d’un concert mais, bien en amont, du seul acte d’achat d’un billet, comme un homme qui aurait de l’argent n’éprouverait du plaisir qu’à la seule idée de le dépenser. L’opéra n’échappe pas alors à cette critique du « fétichisme musical ». Pour T. W. Adorno, il y a bien souvent, dans les esprits, une confusion entre « avoir une voix » et « être un chanteur », et une tendance à n’aimer une voix que pour elle-même quand l’opéra et le chant en général ne peuvent se réduire à cette seule matérialité. Par comparaison, le culte voué aux violons de maître, pour celui qui s’apprête à écouter un Stradivarius, finit par occulter la composition et l’interprétation de la musique elle-meme.
La régression de l’écoute constitue le pendant naturel de cette fétichisation. La standardisation, en particulier à travers la publicité, infantilise les auditeurs par une écoute atomisée, faite d’une palette d’extraits choisis pour leur potentiel commercial. L’on ne retient alors des symphonies ou des opéras que des mouvements et des citations séduisants, mus en clichés de l’« écoute-marchandise » qui dénaturent ainsi l’unité complexe de l’œuvre. Plus généralement, plus un morceau sera connu, plus il aura de succès, et plus il sera joué, tel est le cercle vicieux de la fétichisation et de la régression. Le risque étant alors de produire un « mécanisme névrotique de la bêtise dans l’écoute » par le « rejet présomptueusement ignorant de tout ce qui est inhabituel », c’est-à-dire inconnu.
Rien, absolument rien n’échappe à la plume acerbe et à la formule assassine de Theodor W. Adorno. S’il est parfois difficile de pénétrer cet esprit complexe dans une forme elle-même complexe, la jouissance que l’on y retire mérite largement l’effort intellectuel, et la traduction de Christophe David nous y aide par sa grande fluidité. L’approche interdisciplinaire – philosophique, économique, sociologique –, est pour beaucoup dans la richesse de l’analyse adornienne, sans que le propos s’en trouve noyé. Mais pour un texte précisément aussi riche et exigeant, il manque dans cette nouvelle édition un véritable appareil de notes, car beaucoup de termes mériteraient une analyse et une contextualisation précises, comme par exemple celui de « désenchantement », clairement emprunté à Max Weber, ou encore l’expression d’ « art responsable » qu’il est nécessaire d’expliciter.
Parce que la grande force de ce texte réside dans son actualité, tous les mélomanes, même ceux qui se pensent irréprochables, se doivent de lire cet essai afin de conserver un regard critique sur la façon qu’ils ont, et aujourd’hui plus que jamais, à l’heure du numérique, d’écouter et de consommer cet art qu’est la musique.