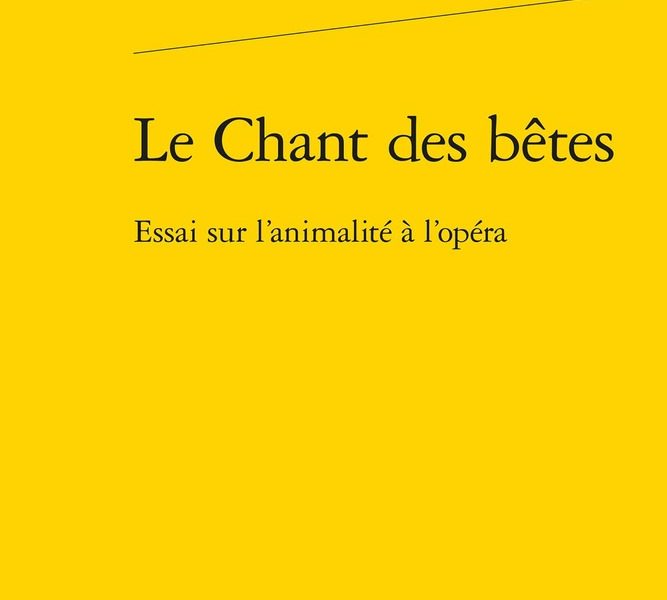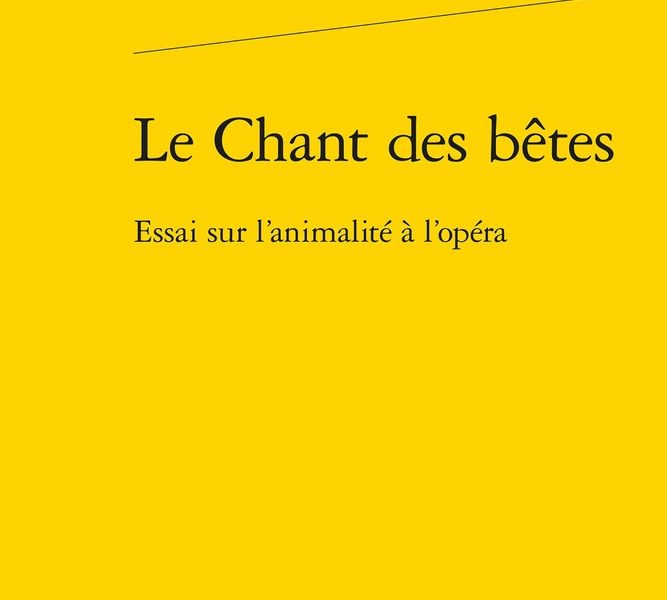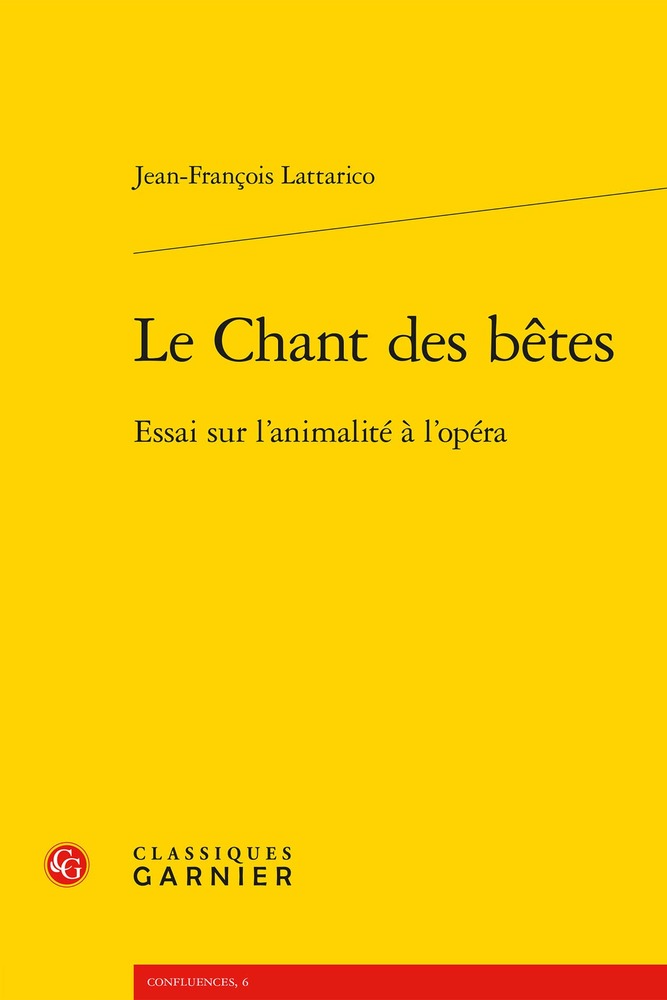Des animaux à l’opéra, on croirait avoir vite fait le tour : La Petite Renarde rusée, bien sûr, L’Enfant et les sortilèges, évidemment. En cherchant bien, et en sortant déjà du répertoire le plus fréquenté, Les Oiseaux de Braunfels. Pourtant, en s’attelant à cette question, c’est plus de 230 œuvres qu’a pu recenser Jean-François Lattarico, plus connu jusqu’ici comme spécialiste de Busenello et de la naissance de l’opéra italien. Le sujet se révèle vite foisonnant et fascinant, dès lors qu’on en élargit un peu les limites pour envisager les diverses formes d’animalité que peut accueillir l’art lyrique, même quand la bête n’est pas un personnage à part entière, même quand elle n’a pas voix au chapitre.
L’épais volume publié par les Classiques Garnier se divise en trois grandes parties grossièrement chronologiques – « L’animal allégorique », « L’animal silencieux » et « L’animal héroïque » – qui retracent comment, en quatre siècles d’histoire de l’opéra, on est passé d’un anthropocentrisme radical, où seule la parole humaine était jugée apte à exprimer l’émotion, à une ère du soupçon où le langage verbal humain est désormais perçu comme obstacle à la communication, ce qui permet à l’animal d’apparaître en tant qu’égal possible.
Allégorique, l’animal l’est d’abord dans ces spectacles de cour qui sont l’ancêtre du genre opéra. Les héros (humains) combattent des créatures au moins en partie bestiales, cependant que les divertissements dansés donnent souvent à voir une faune variée. Dans la partition d’Alceste de Lully, « on entend aboyer Cerbère », et dès 1661, à Venise, Pasive retrace les amours de Pasiphaé pour le taureau. L’animalité est également présente comme source de métaphores qui permettent de « réduire par l’artifice du discours la distance entre l’homme et l’animal ». On trouve notamment chez Haendel et bien d’autres de ses contemporains la fameuse aria di paragone où l’on compare l’humain à l’hirondelle ou au tigre d’Hyrcanie, et la tradition se maintiendra jusqu’au début du XXe siècle si ce n’est au-delà. Peu à peu, l’animal gagne le droit d’être sur scène, et sa présence physique est l’amorce d’un recentrage dramaturgique.
Silencieux, le non-humain le reste pourtant, non seulement dans les ballets, mais aussi dans certains grands opéras du répertoire : le cygne de Lohengrin ne parle ni ne crie, par exemple ; Rossini n’accorde pas d’aria à sa pie voleuse. Pourtant, le bestiaire fantastique convoqué par le Freischütz dans la scène de la Gorge-aux-Loups contribue à l’atmosphère de l’œuvre, et des créatures plus familières s’imposent peu à peu à l’opéra, le XIXe siècle marquant les derniers instants du mutisme animal. Capable d’imiter le langage des hommes, le perroquet est l’instrument privilégié de l’évolution qui va peu à peu anéantir ce logocentrisme lyrique. Contrairement à la chèvre du Pardon de Ploërmel à qui Meyerbeer n’accorde jamais la parole, le rôle-titre de Dolly, opéra sur le clonage signé Steve Reich, concède à la brebis un bêlement symbolique.
Héros, enfin, l’animal le devient lorsqu’est admis le principe d’une continuité entre les êtres, dès L’Oiseau bleu d’Albert Wolff (1919), d’après la pièce de Maeterlinck. La métamorphose permettant de passer de l’animal à l’humain et inversement inspire plus que jamais les compositeurs, et même La Femme sans ombre illustre cette « perméabilité biologique entre le corps de l’animal et celui de l’homme ». Les chiens prennent le pouvoir, depuis Barkouf d’Offenbach jusqu’à Kein Licht de Manoury, et c’est l’annonce d’un « Männerdämmerung » auquel participeront chevaux, grenouilles, renardes, chattes et insectes.
Cette somme fera désormais autorité sur un sujet bien plus développé qu’on aurait pu le croire. Evidemment, il est toujours possible de penser à tel détail dont il n’est pas fait mention, comme le cheval sur lequel Scribe prévoit dans Les Huguenots que Marguerite fasse son entrée au IIIe acte. On pourra signaler que La Colombe de Gounod s’inspire de la même nouvelle de Boccace (via un conte de La Fontaine) que L’Egisto de Marazzoli, ou regretter qu’il ne soit pas question de la Moule omnisciente, si bavarde dans Hélène d’Egypte. Mais l’exhaustivité n’est pas ici le propos, et l’on sait gré à Jean-François Lattarico d’avoir, avec son livre, fourni un cadre aussi précieux à la réflexion de ceux qui voudront se pencher sur des aspects plus pointus encore.