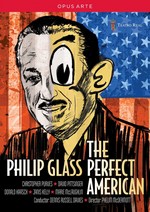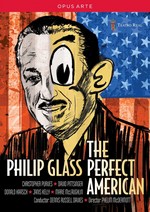Alors qu’une tournée internationale nous permet de redécouvrir aujourd’hui Einstein on the Beach, qui fit l’effet d’une bombe dans le monde de la musique contemporaine il y a un peu moins de quarante ans, le DVD nous offre le vingt-cinquième opéra de Philip Glass. Ce seul chiffre en dit long sur la production lyrique d’un compositeur qui vient de fêter ses 75 ans. Qui, de nos jours, peut se vanter d’avoir conçu autant d’opéras ? Evidemment, les choses ont bien changé, l’opéra a reconquis droit de cité, notamment peut-être parce que les compositeurs ont mis beaucoup d’eau dans leur vin. Si l’on songe au radicalisme d’Einstein on the Beach, The Perfect American paraîtra bien timide, bien rétrograde presque dans sa structure : certes, le protagoniste central est une fois encore un personnage ayant existé, mais le livret n’est pas un collage de citations sans intrigue aucune, puisqu’il s’inspire d’un roman allemand consacré à Walt Disney, qui n’est peut-être pas non plus un individu de la même envergure intellectuelle qu’Albert Einstein ou Gandhi, si l’on songe à la figure autour de laquelle fut composé le second opéra de Glass, Satyagraha. Certes, les deux actes nous replongent dans diverses époques de la vie de Disney, mais le théâtre du XXe siècle nous en a fait voir bien d’autres, et même la durée de l’œuvre est tout à fait raisonnable : 1 heure 50 minutes, ce qui est sans commune mesure avec les cinq heures d’Einstein. Ce qui reste, bien sûr, c’est une certaine idée de la musique, mais même là, tout semble devenu bien plus sage, et l’on est loin de la répétition hypnotique et interminable des mêmes phrases musicales. Et tout cela est chanté en anglais, pas en sanskrit (Satyagraha) ou en égyptien ancien (Akhnaten). Autant de concessions qui prouvent à quel point le monde de la création musicale a changé.
Surtout, peut-être, l’œuvre porte un regard très critique sur son « héros » qui n’a rien d’admirable tel qu’il nous est dépeint. Archi-conservateur, raciste, ce « parfait américain » a surtout l’air du parfait réactionnaire, comme le montre bien la scène comique où Walt Disney est appelé pour réparer le robot représentant Lincoln, dont il se voit forcé de contredire les propos bien trop socialistes à son goût. S’il n’y a aucun grand air qui pourrait s’imposer à la mémoire, le livret n’en inclut pas moins une scène assez tire-larmes, celle où Disney est confronté à un enfant cancéreux. Les personnages féminins sont assez peu développés (l’épouse, l’infirmière, les deux filles ne font que de brèves apparitions), et il y a finalement trois voix principales : celle de Walt, celle de son frère Roy, et le chœur qui revient périodiquement psalmodier les mots auxquels s’ancrent la nostalgie disneyenne du paradis perdu de l’enfance. C’est donc sur les épaules de l’excellent Christopher Purves que repose l’essentiel de cet opéra. Vocalement, les exigences du rôle ne paraissent pas démesurées, même si le baryton-basse britannique est presque constamment en scène : une course d’endurance, donc, mais dans un ambitus apparemment assez confortable, sans que les extrêmes soient sollicités. De couleur plus grave, la basse américaine David Pittsinger interprète le frère aîné, Roy, avec qui Walt peut évoquer le bon vieux temps, sur le thème du « tout fout le camp ». Troisième personnage masculin, dont la voix de ténor apporte une dose d’aigus : Wilhelm Dantine, narrateur du roman dont est tiré l’opéra, ancien employé des studios, qui tente en vain d’attirer l’attention de Disney. Ex-ténor mozartien, Donald Kaasch confère une formidable présence à cette figure qui semble sur le point de basculer dans la folie. Autour d’eux, on trouve surtout des silhouettes on l’a dit, parmi lesquelles on relève le cocasse Andy Warhol de John Easterlin, le Lincoln au visage de cire de Zachary James, et l’infirmière de Janis Kelly. Quant au spectacle, il bénéficie de l’intelligence et de la familiarité glassienne de Phelim McDermott, à qui l’on doit un splendide Satyagraha coproduit par le Met et l’ENO. On retiendra surtout la présence d’une dizaine de figurants incarnant les employés des studios, qui contribuent à créer l’atmosphère adéquate pour chaque scène. Au total, une production bien réglée, mais dont rien ne garantit qu’elle s’impose au sein de l’œuvre de Philip Glass, qui a livré des opéras qui parvenaient autrement mieux à toucher le public, comme dans sa trilogie Cocteau (La Belle et la bête sera d’ailleurs donné en janvier prochain à Saint-Etienne).