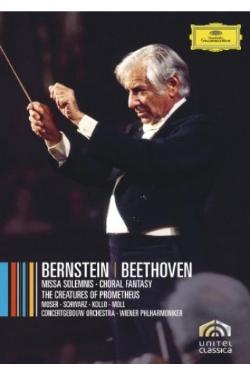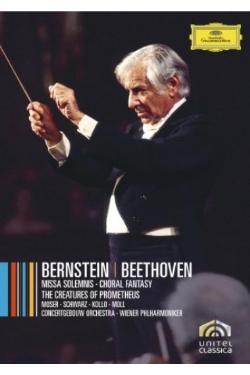Au panthéon des beethovéniens, la statue de Leonard Bernstein est sans doute aussi grande que celle du « Commandeur » Karajan. En 1963, l’intégrale marmoréenne du patron des Berliner s’imposait d’emblée comme une référence ; cela ne doit pas occulter la somme dionysiaque enregistrée l’année suivante avec le New-York Philharmonic par Lennie, nerveuse et chantante. Aux cordes opaques soulignées par le successeur de Fürtwängler répondait, outre-Atlantique, une petite harmonie mise en valeur et des tempi plus « secs » (le meilleur hommage que l’on pouvait rendre à Fritz Reiner, décédé quelques mois auparavant). La suite appartient à l’Histoire, qui s’est chargée de cristalliser la rivalité entre les deux chefs d’orchestre.
Bien entendu un beethovénien qui se respecte n’enregistre pas les seules symphonies. En 1978, c’est à Bernstein d’avoir la main sur Karajan, et de se faire filmer, un an avant lui, dans la Missa Solemnis. C’est en mars, au terme d’une longue tournée européenne, et juste avant de revenir au chevet de son épouse mourante, que les caméras d’Unitel s’installent dans la grande salle du Concertgebouw. On sera tenté de chercher, dans le moindre accent, dans la plus infime nuance, la marque du drame personnel que traverse Bernstein. On retiendra surtout une leçon, connue depuis longtemps mais qu’il est bon de répéter dès que l’occasion s’en présente : voir Bernstein diriger est un spectacle inestimable. Bien sûr, le compositeur de West Side Story a donné au disque quelques uns de ses plus beaux fleurons. Mais l’image apporte à l’impact sonore un surplus sensible. Elle n’est en rien, ici, un palliatif superficiel à une carence quelconque (il n’y en a pas), elle ne revêt pas simplement un intérêt historique (ce qui serait pourtant déjà considérable), mais elle appuie l’interprétation, fait corps avec elle, à part entière. Le visage tourmenté de Bernstein apporte une urgence étonnante à la pulsation du Gloria, sa gestuelle, dont l’ampleur va crescendo, comme dans une espèce de ralenti, fait gagner en densité l’ascèse du Credo, tandis que de l’Agnus Dei conclusif jaillit une étrange tourmente, comme une frayeur devant les beautés célestes que Beethoven nous fait entrevoir, et qui sont ici comprises comme jamais. Pour autant, cette direction symbolique au plus haut point ne semble jamais abstraite : les musiciens sont suivis du regard, aidés avec clarté et bienveillance… Bref, la quadrature du cercle est tout simplement réalisée.
Pour être à la hauteur d’un tel chef, il faut au moins être le Concertgebouw (récemment sacré meilleur orchestre au monde par le magazine Gramophone). Là encore, les différences avec Karajan sont marquées : les cordes rayonnent mais ne dominent pas un ensemble extrêmement équilibré. Il manque peut-être aux choristes une once de densité (et encore…), tandis que les solistes, évidemment superbes, pêchent peut-être par leur relative hétérogénéité : dans les ensembles, on entend surtout Kurt Moll et Edda Moser – ce qui n’est pas franchement tragique, nous sommes d’accord – au détriment de René Kollo et Hanna Schwarz.
Le programme est complété par deux concerts ultérieurs : quand, à la fin de l’année 1978, Bernstein revient en Europe pour enregistrer, à Vienne, sa deuxième intégrale des Symphonies de Beethoven, il en profite pour diriger des extraits des Créatures de Promethée : parenthèse enchantée, dont le classicisme corseté ouvre la voie à toute une génération de futurs grands beethovéniens, Abbado en tête. La Fantaisie Chorale, donnée en 1985, apaisée et riante, convainc légèrement moins. Bernstein et les Wiener Philharmoniker ne sont évidemment pas en cause, les chœurs non plus, mais Homero Francesch, plus qu’honorable, ne saurait égaler Rudolf Serkin, pianiste de la première version de Bernstein, en 1962.
On l’aura compris, c’est de toute manière une Missa Solemnis bouleversante qui fait le prix de ce DVD. Réjouissons-nous au passage que les témoignages filmés de Bernstein reviennent, ces derniers temps, au premier plan : il le mérite, et nous en avons besoin !
Clément Taillia