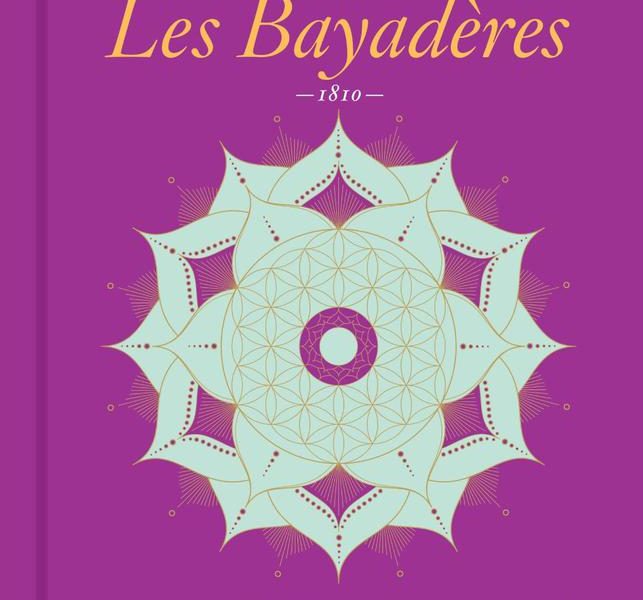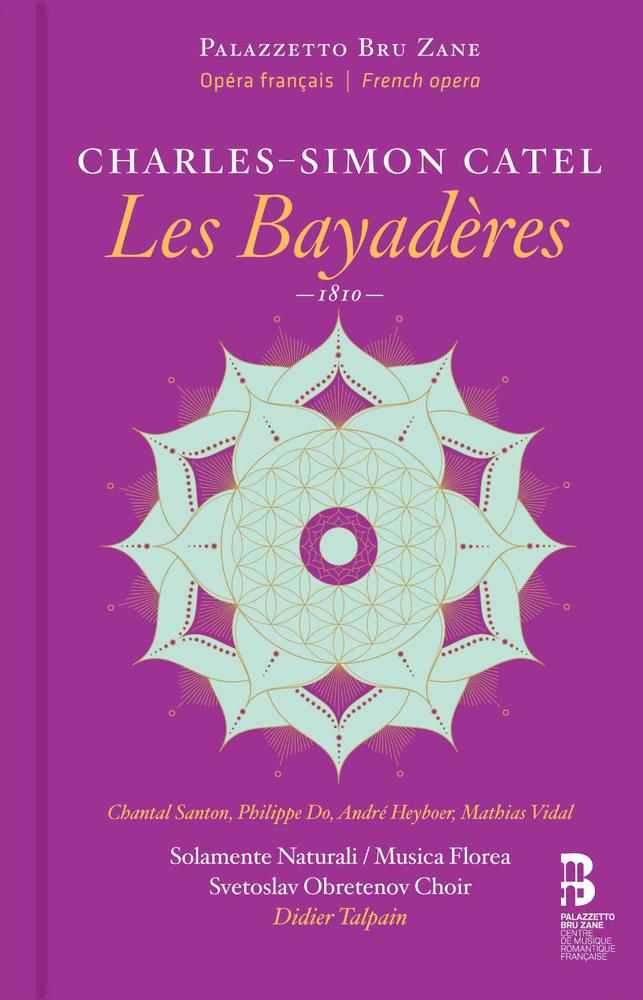Avec ces Bayadères, Charles-Simon Catel se voit enfin offrir une revanche éclatante, car la Sémiramis publiée en 2012 n’avait pas vraiment su nous convaincre de l’intérêt de son exhumation (voir compte rendu). Il s’agit là sans doute du chef-d’œuvre de ce compositeur (même si ce titre doit être réservé, selon Fétis, à Wallace ou le ménestrel écossais, représenté en 1817). Comme le souligne avec raison Gérard Condé dans le premier texte de ce somptueux livre-disque, il plane sur cet opéra comme une grâce mozartienne : le trio des favorites rappelle les trois dames de La Flûte enchantée et la marche des brahmanes a des harmonies qui rappellent étonnamment Sarastro et ses prêtres, mais on pourrait aussi dire que le deuxième acte, où la danse des bayadères prend « un caractère de tumulte et d’ivresse », évoque le premier finale de Don Giovanni. Voilà qui nous transporte bien au-delà de la seule curiosité historique, et l’on comprend que cet opéra ait été choisi pour l’inauguration de la salle Le Pelletier le 16 août 1821. Indépendamment des vertus propres à la partition, le livret offrait un cocktail idéal : de l’amour, de la violence, et de l’exotisme. Comme le dirait Flaubert dans son Dictionnaire des idées reçues, « Bayadère : Toutes les femmes de l’Orient sont des bayadères. Ce mot entraîne l’imagination fort loin ». En 1810, le public français connaissait déjà la terrible coutume indienne du suttee ou sati, ressort dramatique que saurait exploiter Jules Verne dans Le Tour du monde en 80 jours, mais l’on disait encore « Brame » au lieu de Brahmane. On ne cherchera pas trop d’orientalisme dans la musique, cette heure-là n’avait pas encore sonné, mais c’est là une œuvre à laquelle il serait bon de redonner sa chance en scène, ce que l’on imagine tout à fait possible hors de nos frontières, dans une de ces maisons où l’on ose encore prendre des risques.
A Didier Talpain, le Centre de musique romantique française avait déjà confié le tout premier volume de sa collection d’opéra français, Amadis de Gaule de Jean-Chrétien Bach. Il revient avec le même orchestre, qui fait fusionner deux ensembles, l’un de Bratislava, l’autre de Prague, pour un résultat des plus heureux, sans cette placidité qui plombe parfois l’interprétation des œuvres oubliées. Animée d’un dynamisme constant, l’œuvre progresse sans que jamais l’intérêt retombe. Curieusement, la prise de son ou le placement dans la salle de concert (il s’agit en grande partie d’un live) rend le chœur Stevtoslav Obretenov excessivement lointain, comme s’ils étaient séparés des solistes par plusieurs kilomètres.
Ce petit détail excepté, le chant qu’on entend sur ce disque est absolument sans reproche. Voix claire et bien timbrée, Chantal Santon brille dans un rôle exigeant, et l’on s’étonne une fois de plus que cette artiste ne se voie pas encore proposer les engagements auquel elle a droit hors du répertoire baroque auquel elle reste jusqu’ici associée. A ses côtés, Philippe Do sait trouver des accents héroïques fort bienvenus pour son personnage. Quant au méchant, Olkar, André Heyboer se montre à la hauteur des exigences de la partition, qui exige beaucoup de son interprète dans les aigus. Et les petits rôles sont tout aussi excellents, qu’il faudrait tous citer : Frédéric Caton en grand brahmane, son collègue basse Eric Martin-Bonnet qui cumule trois petits personnages, les ténors Mathias Vidal et Thomas Bettinger, et les trois odalisques/bayadères, Katia Velletaz, Jennifer Borghi et Mélodie Ruvio. Ne passez pas à côté de ces Bayadères, c’est un délice pour les oreilles. Et pour l’imagination.