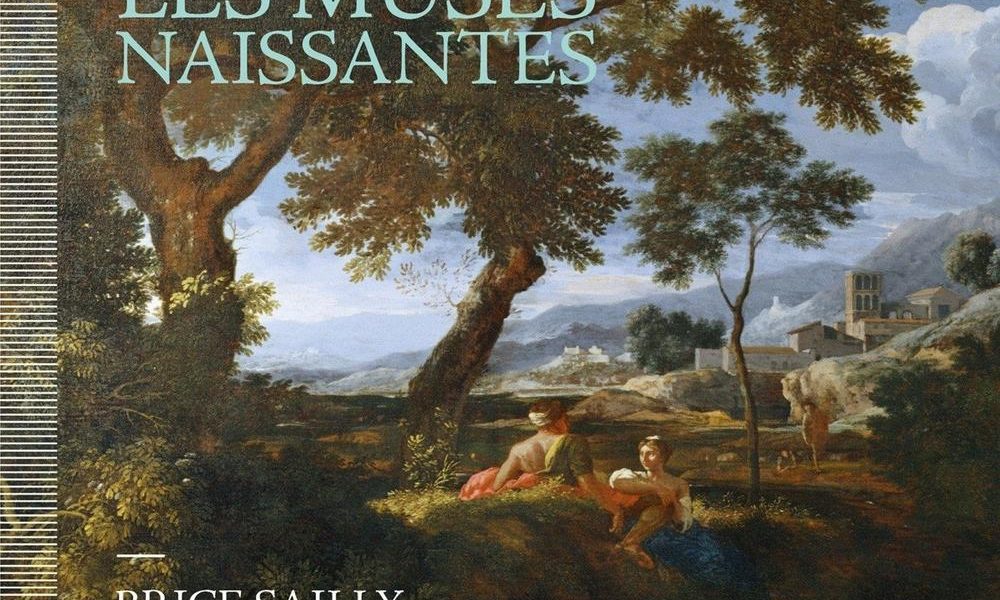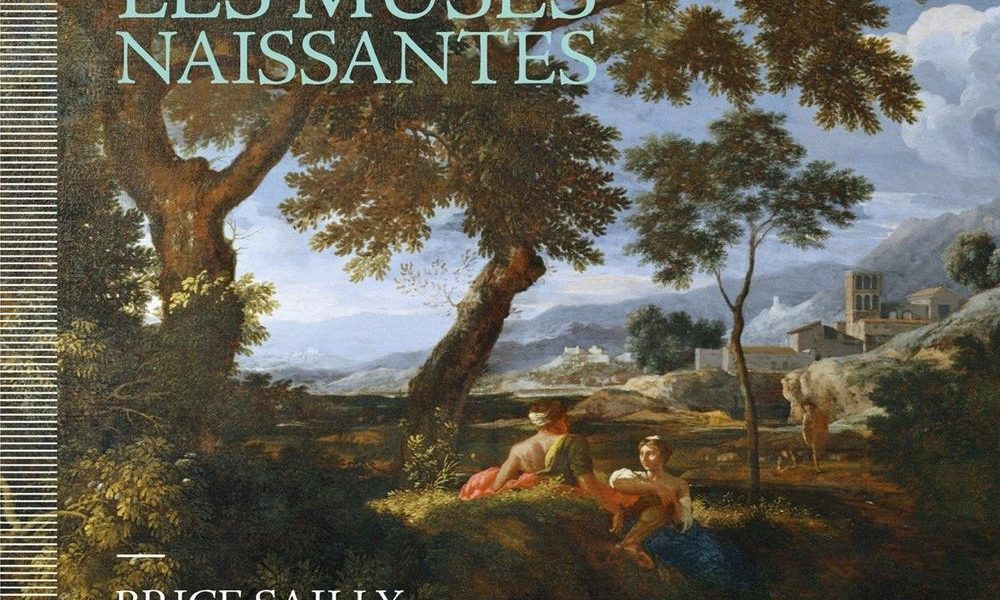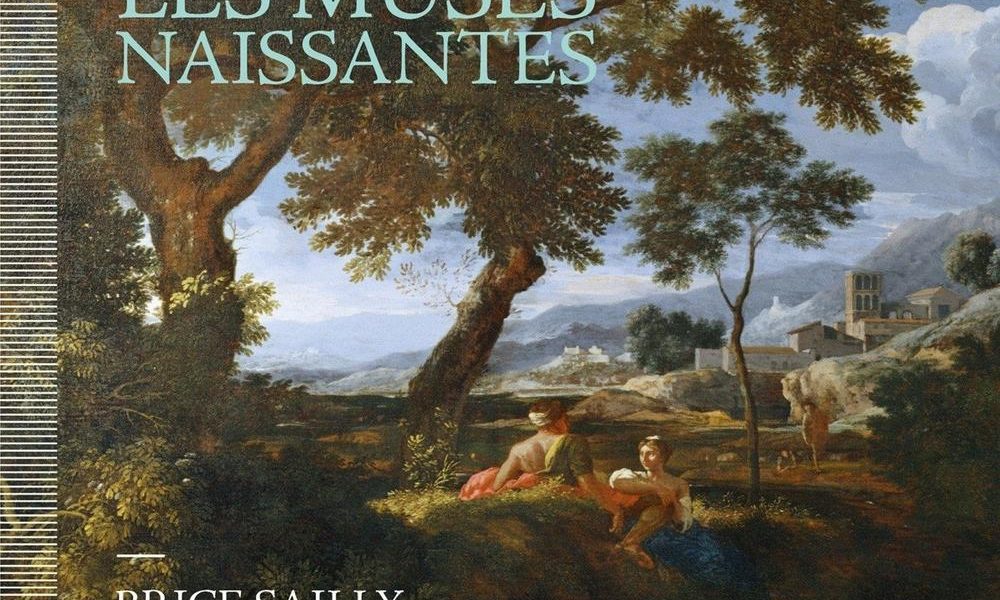Jérôme Lejeune n’a pas tort : l’œuvre de Couperin est déjà bien documenté par le disque et nous n’avions guère besoin, par exemple, d’une nouvelle intégrale de ses pièces de clavecin ni d’une énième version de ses fameuses leçons de Ténèbres. Toutefois, ses airs n’ont jamais fait l’objet d’un enregistrement complet – d’ailleurs, hormis Doux lien de mon cœur, qui jouit davantage des faveurs des chanteurs, ils restent peu donnés et relativement méconnus. Or, en réécoutant la première plage, miraculeuse, de cet album (À l’ombre d’un ormeau), nous nous surprenons à regretter que les interprètes n’aient pas comblé cette lacune.
De fait, le charme entêtant de cette musette joliment chaloupée n’est pas le seul à s’insinuer au creux de notre oreille et à ne plus nous lâcher. La simplicité de ces pages vocales ne rime pas avec facilité, elle est avant tout affaire de grâce, d’équilibre, entre délicatesse et mordant. Emmanuelle de Negri n’a pas seulement pour elle la rondeur d’un soprano lumineux et en même temps charnel, lequel nous change agréablement des voix souvent pointues et acidulées qui évoluent dans ce répertoire. Elle trouve surtout immédiatement le ton juste et peut compter sur La Chambre Claire pour épouser ses moindres intentions. A la fois péremptoires et mutines, mais sans aucune minauderie, dans la pastourelle Il faut aimer dès qu’on sait plaire, les intonations se parent de gravité et l’émission se fait plus nerveuse et incisive quand il s’agit de traduire l’inquiétude de l’amant séparé de sa belle dans la sarabande Qu’on ne me dise plus que c’est la seule absence. L’efflorescence ornementale au sein de la brunette Zéphyre, modère en ces lieux semble couler de source et la prononciation historique du français qui, chez d’autres, a parfois quelque chose d’affecté, frappe ici par son naturel et une saveur qui rehausse même la platitude et l’indigence de certains vers. Autant dire que nous avons hâte de retrouver Emmanuelle de Negri en compagnie des Arts Florissants dans un nouveau volume d’airs de cour.
En découvrant le reste du programme et en lisant le texte de présentation de Brice Sailly, l’auditeur comprendra aisément pourquoi des airs plus enjoués, sinon truculents n’ont pas été retenus. « L’enfance, ses amours radieuses et ses promesses tiennent lieu d’Arcadie », écrit le claveciniste, qui a retenu des pièces surtout intimistes, où le langage de Couperin oscille « entre tendresse et mélancolie », une ambiguïté ou plutôt une ambivalence féconde que peu d’artistes, toutefois, parviennent à restituer avec une telle acuité. Sailly en fait son miel et notre ambroisie, en particulier dans cette Petite Pince-sans-rire qui s’ombre fugacement de tristesse, mais la sensibilité du musicien s’épanouit également dans le climat feutré et introspectif des Ombres errantes, dont il excelle à distiller le mystère, avant de s’abandonner à la volupté lasse et pourtant sophistiquée de La Reine des cœurs.
Emblématique de ce « monde de discrétions humaines », pour reprendre la belle formule du soliste, Le Dodo ou l’Amour au berceau, fascinante paraphrase de Dodo l’Enfant do, nous le montre au sommet de son art : moelleux du toucher, fondu enchaîné des thèmes, agogique hardie mais parfaitement maîtrisée (il faut entendre cet alentissement progressif s’imposer avec la force de l’évidence et une fluidité exemplaire), tout suscite l’admiration et les écoutes successives n’entament en rien notre plaisir. En revanche, du modèle lullien, si prégnant dans La Grande Ritournelle (Huitième Concert dans le goût théâtral), la Chambre Claire peine à retrouver la majesté et a davantage retenu la langueur des sommeils. Du reste, alors que cette Chaconne ou Passacaille extraite des Nations (La Françoise) peine à trouver son élan, La Forlane fait assaut d’élégance mais manque de caractère et d’allant. C’est peut-être là aussi une question de goût, après tout, ne sommes-nous pas chez Couperin ?