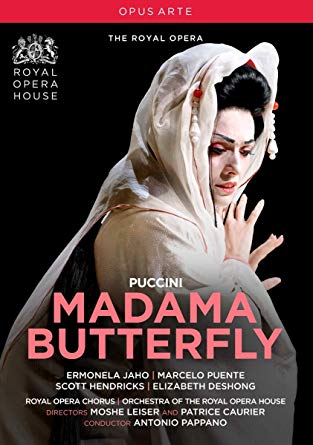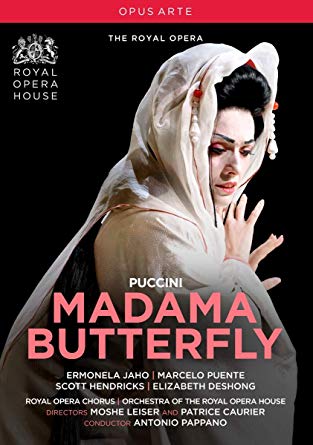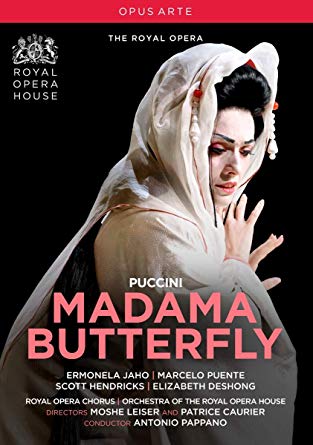A quoi devrait, dans l’idéal, servir un DVD ? La réponse paraît évidente : à immortaliser un spectacle qui se détache du lot, une production particulièrement mémorable. Autrement dit, une mise en scène en tous points réussie, ou qui a du moins le mérite de renouveler notre regard sur l’œuvre. A ce compte-là, la Butterfly de Covent Garden serait un peu hors concours car, de manière assez étonnante, Patrice Caurier et Moshe Leiser n’avaient apparemment pas grand-chose à apporter à la japonaiserie puccinienne. C’est à une version tout à fait traditionnelle que l’on a affaire, qui donne raison à Jorge Lavelli : pendant trois quarts de siècle, presque toutes les productions de Madame Butterfly se sont ressemblé, jusqu’à ce que l’on s’interroge sur le sens de cette œuvre. Rien de tel ici, et tout paraît bien simple. Seuls de rares moments laissent imaginer une ouverture sur une autre approche, qui ne se concrétise pourtant jamais : par exemple, quand le bonze apparaît, le décor placé à l’arrière-plan – un paysage presque enfantin aux couleurs pastel – s’écroule, mais cette piste n’est pas exploitée, alors qu’elle aurait pu signifier la naïveté du rêve de l’héroïne. Le reste du temps, une structure un peu massive, censée évoquer les parois coulissantes des maisons japonaises, laisse voir tantôt une photographie sépia de Nagasaki, tantôt de ridicules plantes artificielles pour le duo des Fleurs. Lors du suicide de Butterfly que ce cadre lourdaud s’envole dans les cintres pour ne laisser voir qu’un fond uni devant lequel s’élance une branche de pêcher dont les fleurs tomberont à terre avec la mort de l’héroïne. C’est joli, mais sans plus, et il faut au même moment subir les battements d’ailes (les manches du kimono) par lesquels la comparaison avec le papillon nous est rappelée avec une colossale finesse. A part ça, il y a les kimonos attendus, les ombrelles et les éventails, le bonze évoque Maître Po dans la série télévisée Kung Fu ; ne manque que le pont japonais cher à nos grands-parents. Sans être révolutionnaire, la production milanaise signée Alvin Hermanis avait au moins le mérite d’offrir de quoi subjuguer le regard par la beauté des costumes et des décors. Rien de tel ici.
Que peuvent donc offrir d’autre les images de ce DVD ? Une incarnation majeure du rôle principal, peut-être. Il est indéniable qu’Ermonela Jaho est à l’heure actuelle une Butterfly avec laquelle il faut compter : la soprano albanaise est l’interprète que tous les théâtres s’arrachent, de Berlin à New York en passant par Orange, faisant à chaque fois pleurer les spectateurs saisis par l’émotion ardente qu’elle sait communiquer à son jeu. Cette incarnation suffirait-elle à justifier l’existence du DVD Opus Arte ? Oui et non, car les gros plans viennent un peu trop souligner tout ce qui fonctionne sur une scène mais qui passe un peu moins bien à l’écran. La prise de son aide aussi à mettre en avant des aigus très souvent trop hauts et un timbre pas toujours des plus séducteurs. Quid de son Pinkerton ? Marcelo Puente est scéniquement parfait en bellâtre sûr de son fait, et laisse même voir un certain trouble amoureux par-delà le marchandage colonialiste. On pourra néanmoins lui reprocher le vibrato serré qui a tendance à décolorer ses aigus. Impeccable, en revanche, la Suzuki d’Elizabeth DeShong, voix somptueuse et actrice sensible, mais on sait depuis longtemps que cette artiste change en or tout ce qu’elle touche. Si le Sharpless épais et nasillard de Scott Hendricks n’a rien de bien enthousiasmant, Carlo Bosi propose un Goro idéal, peaufiné par des années d’expérience. Les petits rôles ne se distinguent guère, ni le terne Yamadori, ni le bonze adepte du parlando.
Ce que le DVD préserve, c’est enfin la direction d’Antonio Pappano, à qui Puccini va comme un gant. Energie et souplesse, dynamisme et émotion, tout y est, et l’on rage qu’il ne se passe pas sur la plateau des choses passionnantes que dans la fosse.