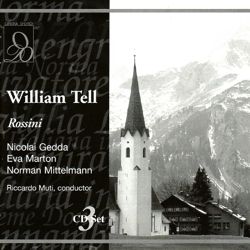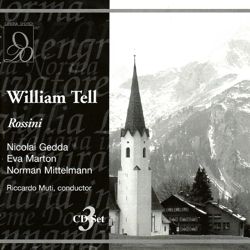Amateurs d’enregistrements pirates authentiques, de brume sonore, de voix comme perdues au fond d’un tunnel, de bruits parasites, ce Guglielmo Tell est pour vous. Les autres utiliseront toutes les ressources de leur imagination pour reconstituer à travers le brouillard acoustique le faste musical de la représentation. Pourtant faste il y a en cette soirée historique d’avril 1972 où Riccardo Muti dirige pour la première fois la version intégrale en italien du chef d’œuvre de Rossini. A commencer par la direction d’orchestre évidemment. Seize ans avant Milan et l’enregistrement qui tient lieu aujourd’hui de référence (Merrit, Studer, Zancanaro – Phillips), le maestro possède déjà la partition comme nul autre : visionnaire dans une lecture qui se place aux confluents de deux époques, épique et idyllique, monumental et minutieux, omnipotent car omniscient. Pour autant qu’on puisse en juger dans la nébuleuse phonique, l’Orchestre et le Chœur du Maggio Musicale savent comprendre et répondre aux intentions du chef et l’on regrette de ne pouvoir mieux apprécier ce qui semble relever de la prescience autant que de l’anthologie.
On aurait pu craindre qu’en ces années de prérenaissance rossinienne, les voix ne viennent désavouer l’excellence de la direction musicale. Et bien non ! Arnold demeure trop tendu pour Nicolai Gedda, qui avait déjà éprouvé le rôle un an auparavant en studio. Mais le ténor suédois fait preuve d’un héroïsme qui rachète quelques aigus à l’arraché et le style, sans être idéal, n’abuse pas de contresens. Norman Mittelman, baryton canadien à tout chanter (Mozart, Verdi aussi bien que Wagner, Bizet, les véristes italiens et les quatre rôles des Contes d’Hoffmann) propose de Guillaume un portrait qui ne manque ni d’autorité, ni de noblesse et, Muti aidant, l’interprète réussit à prendre le pas sur le chanteur, le temps d’un « resta immobile » d’une juste ferveur. On associe aujourd’hui Eva Marton davantage à Turandot qu’à Matilde. Pourtant, au début des années 1970, la soprano hongroise ne manquait pas d’arguments pour rendre justice à un rôle de soprano renonçant, pour la première fois chez Rossini, à toute virtuosité. L’engagement dramatique semble sans faille et le timbre possède un acier dont le tranchant apparaît particulièrement bienvenu dans la purée de pois sonore.
Le reste de la distribution, plus que secondaire dans un opéra qui malgré sa longueur donne l’essentiel de la parole aux trois protagonistes, ne démérite pas. Luigi Roni, en Gessler, vocifère plutôt moins que la moyenne. Jemmy, interprété par Maria Casula, ne suscite aucune envie de gifle, ce n’est pas si fréquent. Et le trio du 4e acte « Sottratto a orribil nembo » profite de la présence de Flora Rafanelli en Edwige dont le La grave parvient à transpercer le brouillage. Même le pêcheur, que l’on n’a pas jugé nécessaire de citer dans le programme, fait bonne figure en des temps où les ténors capables de discipliner une partition tournée vers une école de chant disparue, ne formaient pas légion.
On l’a compris, n’était la qualité de l’enregistrement, on tiendrait là un témoignage exceptionnel. Il fallait d’ailleurs que la soirée fût vraiment exceptionnelle pour qu’Opera d’Oro, malgré un handicap sonore majeur, ait décidé de l’ajouter à son catalogue. Encore faut-il, pour en prendre la mesure, vouloir franchir le mur du son.