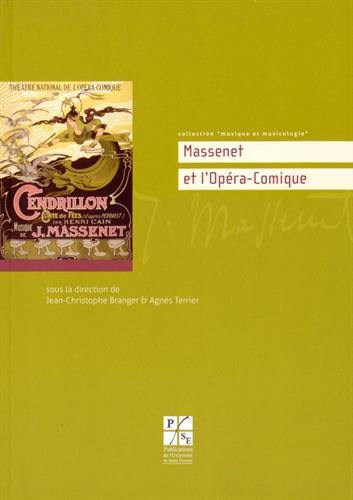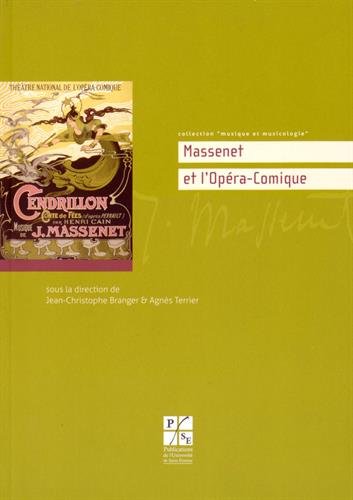Le centenaire de la mort de Massenet aura été l’occasion de divers hommages, colloques et réévaluations, et les délais de publication étant ce qu’ils sont, c’est aujourd’hui seulement que nous parvient la version imprimée de certaines communications présentées en 2012. A l’automne dernier a ainsi vu le jour l’exceptionnel volume intitulé Massenet aujourd’hui : héritage et postérité ; également reflet d’un colloque, Massenet et l’Opéra-Comique ne présente pas tout à fait le même intérêt. Le sujet est un peu plus ciblé, surtout dans le temps : les articles évoquent les œuvres données dans cette salle parisienne (sous ses différents avatars, avant l’incendie de 1887, pendant l’intérim et après la réouverture de 1898), mais la fourchette chronologie ne dépasse pas 1911, date de la création parisienne de Thérèse. Il était sans doute délicat d’offrir du neuf autour d’œuvres déjà abondamment étudiées, mais plusieurs des auteurs ici rassemblés y sont parvenus.
De cette rareté absolue qu’est La Grand-Tante (1867), dont n’a été conservée que la partition piano-chant, Emmanuel Reibel étudie la réception dans la presse. Même si Massenet bénéficia de conditions exceptionnelles (une bonne distribution incluant le ténor Victor Capoul), il n’est pas sûr que la Salle Favart ait joué un rôle de tremplin pour un jeune compositeur qui mit ensuite une dizaine d’années à s’imposer. La presse fut globalement favorable, mais la décennie voyait encore se déchirer partisans et adversaires de Wagner, et la musique du débutant fut donc jugée trop « instrumental », trop allemande, en somme. A l’inverse, en s’interrogeant sur l’influence musicale du XVIIIe siècle dans Manon, Catherine Massip aborde un sujet déjà magistralement étudié par Gérard Condé et par Jean-Christophe Branger. Pour trouver un peu de matière neuve, elle est obligée de s’arrêter longuement sur Le Portrait de Manon, œuvrette en forme de suite de Manon, où l’on retrouve Des Grieux vingt ans après, sans éviter au passage les erreurs factuelles (la gavotte du Cours-la-Reine est ainsi rebaptisée « Oh bénissons quand leurs voix appellent » pour « Obéissons »).
Pauline Girard se penche pour sa part sur la « production chorétique » de Massenet, c’est-à-dire ses ballets, ceux qui sont inclus dans les œuvres lyriques créées à l’Opéra-Comique (Manon, Esclarmonde, Grisélidis et Cendrillon), mais aussi ceux qui furent conçus comme œuvres autonomes. En effet, deux des quatre ballets de Massenet virent le jour Salle Favart : Les Rosati en 1901 et Cigale en 1904 (à quoi Jérôme Deschamps, dans son Avant-propos, ajoute Scènes alsaciennes, mais il s’agit là d’une partition initialement conçue comme une suite d’orchestre). Jean-Christophe Branger présente le poème symphonique Visions…, conçu comme prélude à la composition de Thaïs, et doté d’une invraisemblable partie d’ « électrophone » (procédé électronique d’amplification de la voix humaine), qu’on a pu entendre à Saint-Etienne et à Paris en 2012. Décidément, la genèse de Thaïs mériterait un volume entier, tant elle fut complexe.
Deux articles se penchent ensuite sur les interprètes de Massenet. Lesley Wright évoque les trois premiers Werther, pour lesquels on a la chance de disposer d’au moins un enregistrement d’un extrait de l’œuvre, et souligne comment Werther put peu à peu accéder à la huitième place parmi les œuvres les plus représentées Salle Favart, sans doute grâce à Léon Beyle, successeur d’Ernest Van Dyck et de Guillaume Ibos, créateurs du rôle à Vienne et à Paris. Vincent Giroud brosse un portrait du baryton Fugère (chanta-t-il vraiment Babylas dans Monsieur Choufleuri, ce rôle de ténor ?). Premier interprète de Fritelli dans Le Roi malgré lui, il créa aussi le rôle de Longueville dans La Basoche de Messager, œuvre qu’il faudrait remonter d’urgence. Jouant le Père dans Louise, il aurait assuré le succès de l’œuvre de Charpentier bien plus que Mary Garden dans le rôle-titre. Spécialiste du père Des Grieux, il incarna plusieurs personnages massenétiens, dont le père de Cendrillon et le diable de Grisélidis (ensuite à Monte-Carlo). Homme de théâtre comme le compositeur, acteur-caméléon aussi doué pour la bouffonnerie que pour le pathétique, Fugère était loué pour son art du phrasé et son naturel.
Le volume se conclut avec deux textes assez fascinants. Dans « Massenet metteur en scène à l’Opéra-Comique », Jonathan Parisi s’appuie sur des recherches exhaustives afin de prouver que le compositeur s’intéressait à l’aspect scénique et participait lui-même à l’élaboration des spectacles. Massenet se souciait des détails d’éclairage et notait les gestes avec une précision extrême, exigeant que le Livret de mise en scène soit respecté à la lettre. « Suivre mot à mot ce travail, comme s’il s’agissait d’apprendre ou de faire apprendre la musique d’une partition » écrivait-il à chaque « Avis très important ». Et l’on voudrait nous faire croire que la mise en scène n’est devenue un aspect essentiel que dans la deuxième moitié du XXe siècle ? Autour d’Esclarmonde, Florence Gétreau étudie le rôle du graphiste suisse Eugène Grasset tant dans la mise en scène que dans la présentation des partitions de Massenet. L’intérêt que lui inspire son sujet la pousse néanmoins à quelques excès. En quoi l’Art Nouveau, dont Grasset est l’un des fondateurs, a-t-il été « défiguré par les Anglais » ? Florence Gétreau n’est pas tendre non plus pour les autres artistes ayant travaillé pour le compositeur stéphanois : elle expédie Clairin ou Rochegrosse d’un trait de plume, en leur décernant l’étiquette pour elle péjorative d’ « académiques ». Son admiration légitime pour Grasset l’obligeait-elle à adhérer à une vision un peu dépassée de l’histoire de l’art, qui oppose schématiquement artistes novateurs et faiseurs vulgaires ? A ce jeu-là, c’est Massenet lui-même qui serait voué aux gémonies.