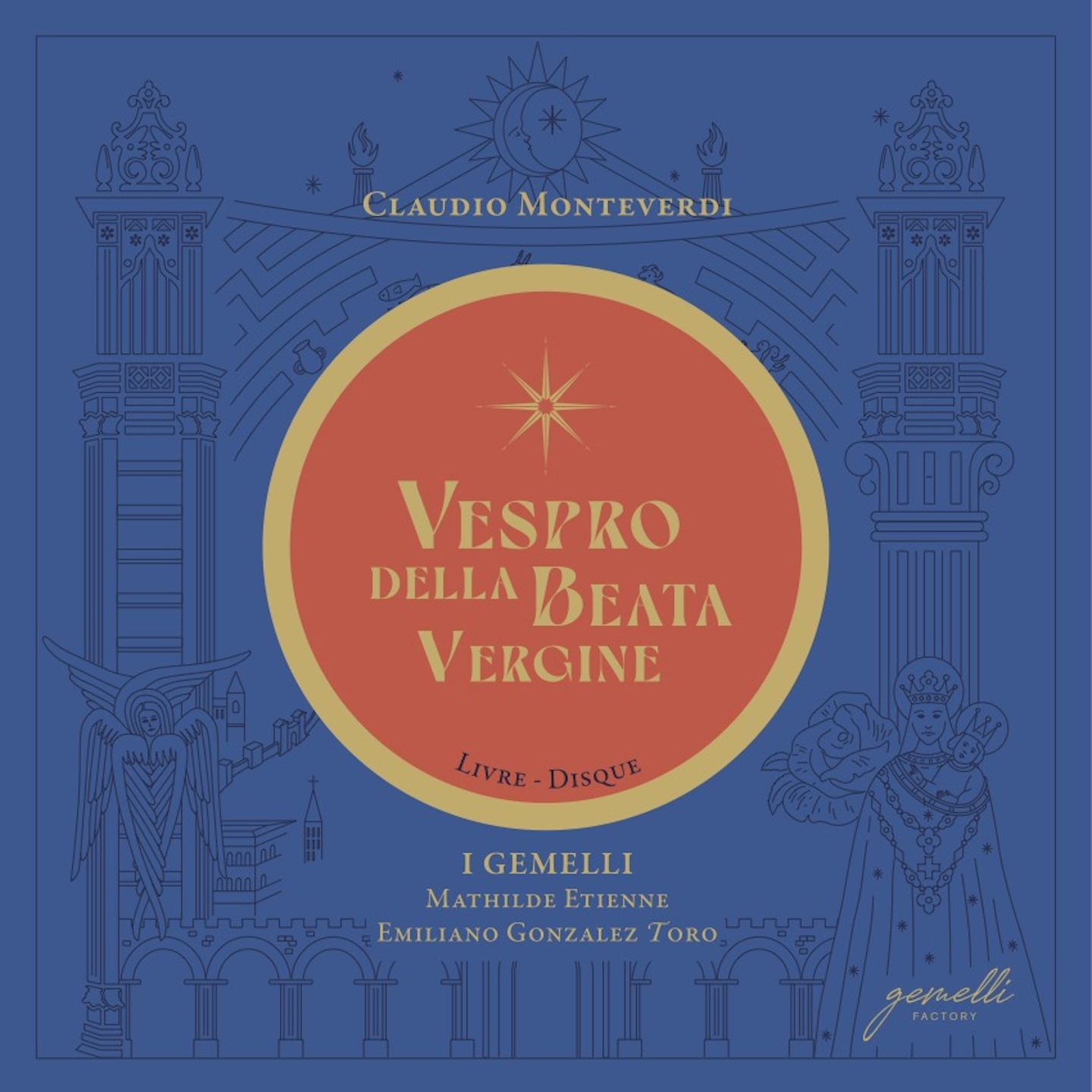Après un Orfeo et un Retour d’Ulysse fort réussis, on s’attendait à ce qu’I Gemelli enregistrent le Couronnement de Poppée. Raté : ce sont les Vêpres qui paraissent. Emiliano Gonzalez Toro justifie ce choix sans détour dans l’entretien liminaire : « il était important que je puisse graver les Vêpres, une œuvre dans laquelle la place du ténor est centrale, à un moment où je pouvais encore le faire » (dans Poppée, on le sait, le ténor est cantonné aux rôles de caractère).
Le projet a été soigneusement répété et élaboré durant deux ans, donnant lieu à une parution somptueuse : un livre-disque de près de 300 pages, riche d’une quinzaine d’essais dus à la plume érudite de Mathilde Étienne (mezzo, cofondatrice et codirectrice de l’ensemble), relevé de superbes enluminures et lettrines dues au pinceau inspiré de Natacha Lockwood.
Quant au contenu musical, il tient sur un seul disque, Toro ayant fait le choix de ne pas enrober les treize pièces de Monteverdi dans l’apparat liturgique que certains lui adjoignent et qui, souvent, encombre l’écoute.
Quelques mots encore sur les choix interprétatifs, eux aussi résumés dans la passionnante interview ouvrant le livre. Toro insiste sur le caractère vocal, lyrique de ce Vespro qu’il souhaite confier à une « assemblée d’individus » : une équipe de solistes chevronnés, pour la plupart bien connus des amateurs d’opéra. Si cette vision s’oppose aux lectures les plus résolument chorales (Herreweghe, Schneidt, McCreesh, Pickett, Pichon, etc.), elle ne va pas jusqu’à l’ascèse d’un Alessandrini, limitant strictement l’interprétation à une voix par partie – à douze chanteurs seulement. Ici, on en compte le double, pour un ensemble instrumental à peu près équivalent dans les deux cas (18/19 interprètes).
Reste la question du diapason, compliquée par le fait que le Magnificat et le Lauda Jerusalem, notés en chiavette, supposent une transposition, généralement une quinte plus bas (que Pichon choisissait de ne pas effectuer). Toro opte pour l’abaissement d’une tierce de ces pièces, interprétant l’ensemble à un diapason relativement élevé (465 Hz), censé préserver son caractère festif.
Si nous nous sommes attardé sur ces options, un peu barbantes pour les néophytes, c’est qu’elles conditionnent bien évidemment le caractère de la lecture. Sur le papier, elles nous ont toutes, sans exception, parues pertinentes. À l’écoute, le bilan est plus mitigé.
Commençons par les motifs de satisfaction, surtout réservés par les concerti pour solistes, ce qui n’étonnera personne. Des deux grands soli pour ténor, le premier, Nigra sum, a été confié à la voix incisive, claire et légèrement vibrée de Zachary Wilder, le second, Audi Coelum, au timbre plus chaud et velouté de Toro lui-même (auquel Wilder sert d’écho) : tous deux caressent l’oreille par un chant riche en couleurs et nuances – et une diction superlative. Superbement réussi s’avère aussi le duo de sopranos Pulchra es, où la lumineuse Nurial Rial se marie à l’ombreuse Éléonore Pancrazi.
Le caractère bondissant, la ferveur dansante conférés aux pages « chorales » que sont le Laudate pueri à huit voix et le Nisi Dominus à dix emportent également les suffrages : chaque « identité vocale » s’y voit préservée sans que, pour autant, la cohérence structurelle n’éclate.
Les réserves arrivent avec les pièces mixtes, celles qui font le plus évidemment alterner sections virtuoses pour solistes et pages pour tutti. Le Magnificat (à 7 voix, celui à 6, alternatif, n’ayant pas été retenu) – sans doute la pièce la plus opératique du corpus – s’en tire assez bien, même si les passages contemplatifs (« Esurientes », « Suscepit ») nous semblent plus inspirés que les passages véhéments. On trouve déjà ici un surcroît d’hédonisme, proche du style de Garrido, qu’on peut juger émollient. Ce défaut se retrouve amplifié dans le Dixit Dominus et le Laetatus sum, qui pâtissent d’une alternance un peu mécanique, qu’on pouvait déjà reprocher à l’ancienne version Corboz – notons d’ailleurs que Toro dédie son enregistrement à ce grand précurseur des lectures montéverdiennes. Dans ces psaumes, on souhaiterait percevoir davantage la présence d’un chef, capable de mettre en valeur l’architecture et de soutenir la tension (/l’attention).
Enfin, il faut déplorer deux (presque) ratages. Celui de la Sonata sopra Sancta Maria est peut-être dû à une prise de son morcelée ainsi qu’au charisme limité des cornistes/sacqueboutiers (on a entendu tellement mieux, par exemple chez Savall, qui reste notre référence).
Celui du Duo Seraphim est plus surprenant, eu égard au talent des trois ténors (Nicholas Scott se joignant à Toro et Wilder). Dans cette pièce que beaucoup considèrent comme l’acmé des Vêpres, la sauce ne prend à aucun moment, faute d’une réelle théâtralité, d’un jeu plus affirmé sur les contrastes et retards, faute d’assumer ce caractère de « duel vocal » que soulignait à l’envi la première version de Gardiner (par ailleurs si datée).
Plastiquement très séduisante mais un peu lisse, cette lecture des Vêpres pâtit, en somme, d’un certain refus de parti pris, de l’absence d’une « vision ». En ce sens, elle nous paraît finalement moins attachante que le récent et audacieux enregistrement de La Tempête (Alpha, 2019), dont les oripeaux orientalisants pouvaient agacer. Car, dans ce corpus éminemment disparate que sont les Vêpres, un rien d’artifice, voire de folie, n’est pas superflu…