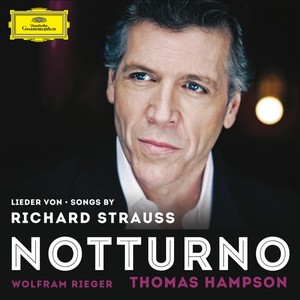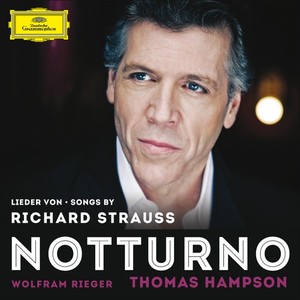Les barytons n’ont pas toujours été très heureux dans les lieder de Strauss. C’est que les qualités de diction et de suggestion n’y suffisent pas tout à fait.
Le coffret enregistré par Fischer-Dieskau pour Deutsche Grammophon distille à côté de franches réussites un ennui discret. Ses enregistrements de jeunesse sont plus convaincants mais il leur manque quelque chose. C’est qu’il faut à ce chant des aptitudes vocales particulières, notamment dans l’aigu : car l’aigu chez Strauss n’est pas escarpement, mais envol. Ainsi, des sopranos niais et des ténors peu éloquents font sentir cet envol mieux que des barytons, même sophistiqués. Etrangement, Prey lui-même, si aisé dans les notes élevées, a toujours chanté Strauss sur la pointe des pieds (et parfois en détonant allègrement, comme dans son enregistrement avec Sawallisch).
Thomas Hampson possède, lui, cette aptitude d’envol. Au-dessus du Mi, la voix semble flotter, sa couleur s’éclaire sans blanchir, la ligne s’épanouit de façon presque ténorisante. La comparaison est inévitable avec le seul baryton réellement convaincant dans Strauss – et qui l’enregistra avec le compositeur – : Heinrich Schlusnus. Ecoutez en parallèle le simple « Zueignung » : à l’ardente intensité d’un Schlusnus princier (capté en 1921) succède chez Hampson quelque chose de tendrement élégiaque. Dans le si difficile « Die Nacht », tout entier sur le fil de la voix, Schlusnus est d’une tendresse qui semble se parler à soi-même. Hampson est bien davantage dans le récit d’un souvenir qui semble venu de loin.
On l’aura compris : entre Hampson et Strauss, l’adéquation est instrumentale avant même d’être musicale et littéraire. Par bonheur, le baryton américain a mûri un programme auquel musicalement et littérairement il rend justice de merveilleuse façon.
Il n’est pas si fréquent que les voix straussiennes possèdent aussi une telle sensibilité au texte poétique. L’évidence s’en impose dans les lieder les plus descriptifs, où l’on reconnaît le talent narratif du chanteur – ainsi « Winternacht », « Ach, weh mir » – et surtout les lieder d’après Rückert (opus 87), qui referment le recueil sur une note transparente et presque enfantine.
Dans les lieder plus élégiaques (« Ruhe, meine Seele ! », « Befreit »), on est parfois saisi par cette persistance du sens dans des lieder où souvent l’on n’entend que son. « Freundliche Vision » atteint à une délicatesse de ton, de timbre, et pour ainsi dire à une beauté sensible inouïes, quelque part entre Peter Anders (l’autorité) et Prey (la fragilité).
Tout cela conflue dans « Notturno ». Le poème assez méandreux de Richard Dehmel trouve en Hampson un récitant tout de sobriété et de clarté, cependant que le piano de Wolfram Rieger (exceptionnel tout au long du récital) et le violon de Daniel Hope tissent avec la voix non une conversation mais un paysage qui progressivement nous embrasse, nous engloutit.
Si l’on se demandait ce que l’année Strauss allait nous apporter de merveilles qui ne fussent pas puisées au rayon des incunables et autres rééditions, nous avons la réponse : ce disque, qui à lui seul fait notre année Strauss.