Marie-Thérèse (Chevalier à la rose), Madeleine (Capriccio), Daphné et Arabella sont les quatre héroïnes straussiennes qu’a consenti à aborder jusqu’à aujourd’hui Renée Fleming. Plus en accord avec son tempérament scénique, son prestige et sa faculté hédoniste de se couler dans la phrase, tout en se laissant porter par le flot musical, que l’Impératrice de La Femme sans ombre, Hélène d’Egypte, Salomé ou Chrysothemis (Elektra), où elle ferait pourtant sensation, la soprano semble avoir trouvé là une sorte d’équilibre. Il faut reconnaître que la jeune fille rêveuse et idéaliste qui espère rencontrer l’homme de sa vie et échapper ainsi à ses parents ruinés, convient idéalement à la cantatrice américaine. Son timbre crémeux, son instrument souple et discipliné, sa diction svelte et l’étonnante facilité de son exécution correspondent très exactement aux exigences de ce rôle marqué à jamais par Lisa della Casa et où se sont illustrées plus tard, Gundula Janowitz, Kiri te Kanawa et Felicity Lott.
La production de Götz Friedrich filmée à Zürich en juin 2007, témoigne de la connivence qu’entretient désormais Fleming avec cette « comédie lyrique » de Strauss, qu’elle fréquente depuis ses débuts à Houston en 1998 et qu’elle a approfondie depuis à Munich et à New York en 2001. Inutile de chercher dans ce spectacle linéaire, aux images glacées, le moindre regard acéré ou nouveau sur l’œuvre inachevée par le librettiste Hugo von Hofmannsthal. Belle et sophistiquée comme dans une série américaine, Arabella évolue dans uns vaste complexe hôtelier aseptisé, créature distante et détachée dont l’attitude paraît parfois cruelle et incompréhensible à ses nombreux prétendants. Fleming n’a ni la grâce souveraine, ni le doux frémissement de Della Casa (à Munich en 1963, où l’image se joint à la parole), ni l’étrange maturité de Karita Mattila (dans la mise en scène high tech de Peter Mussbach au Théâtre du Châtelet), mais son interprétation rigoureuse gagne en épaisseur et en justesse à mesure que se resserre l’intrigue. Son personnage s’impose réellement au 3e acte, lorsqu’au retour du bal elle doit prouver son innocence face aux accusations mensongères qui lui sont faites et lors du dénouement heureux, « Das was sehr gut Mandryka », où sa séduction et son aisance vocale sont à leur apogée.
Lui donnent la réplique, une Zdenka au charme discret et à la présence savoureuse, campée par la soprano Julia Kleiter, heureuse de pouvoir quitter les costumes d’homme dans lesquels ses parents l’emprisonnent, Adelaïde sa mère, chantée par Cornelia Kalllisch une habituée du rôle et Waldner, joueur invétéré, parfait hâbleur viennois un brin vulgaire, confié à Alfred Muff. Rustre, malgré son application à masquer son manque d’éducation, le croate Mandryka que compose le baryton Morten Frank Larsen, souffre d’un vibrato large et d’une résistance vocale mise à rude épreuve – à la différence de Dietrich Fischer-Dieskau, grand titulaire pour qui le rôle a toujours paru simple. Plus sonore et mordant que Thomas Hampson, qui manquait d’envergure aux côtés de Mattila au Châtelet en 2002 et 2005, il parvient tout de même à résoudre la quadrature du rôle, odieux quand il se sent trahi, séduisant lorsqu’il se sait aimé.
Johan Weigel tire son épingle du jeu avec Matteo au milieu de chevaliers servants qui convoitent Arabella et où se querellent Peter Straka (Elemer), Cheyne Davidson (Dominik) et Morgan Moody (Lamoral), tandis que Sen Guo mène à bien le numéro souvent irritant de la Fiakermilli. Sous les mains expertes de Franz Welser-Möst, l’orchestre de l’Opéra de Zürich accompagne avec une certaine pertinence les tensions qui essaiment cette partition-conversation, en utilisant toutes les colorations de la gamme straussienne, sans pour autant atteindre la perfection architecturale de Josef Keilberth (à Salzbourg en 1958 et à Munich en 1963 avec Della Casa), stratège autrement plus impressionnant.
François Lesueur


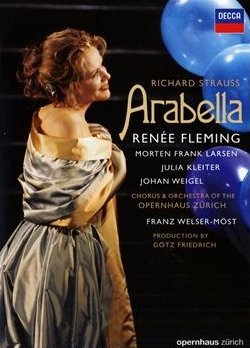


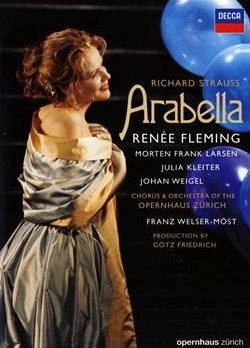

 : Supérieur aux attentes
: Supérieur aux attentes



