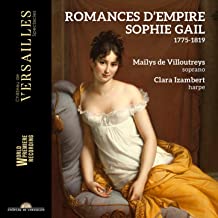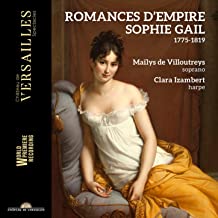Rousseau définissait ainsi la romance : « Air sur lequel on chante un petit poème du même nom, divisé par couplets, duquel le sujet est pour l’ordinaire quelque histoire amoureuse et souvent tragique. Comme la romance doit être inscrite d’un style simple, touchant, et d’un goût un peu antique, l’air doit répondre au caractère des paroles ». Jusqu’à son déclin, dans les années 1870, elle fit la fortune des éditeurs, auxquels collaborèrent les plus grands, de Cherubini et Spontini à Berlioz, mais surtout une foule de compositeurs médiocres alignant leurs notes sous des vers de mirliton. C’est certainement du Directoire à la Restauration qu’elle connut son apogée. Populaire et aristocratique, son caractère strophique permettait à l’auditeur d’en mémoriser naturellement la mélodie. Les sujets étaient bien ceux décrits par Rousseau, mais l’expression s’en élargissait, du pathétique à la désinvolture et à l’humour. Le bonheur, la passion – juvénile ou éteinte – se mêlent aux soupirs et aux larmes. La mort, même, nous vaut trois romances : Werther, puis Charlotte s’expriment, suivies d’une confession de Sophie Gail (« Il faut mourir »). Le moralisme, la sensibilité de Greuze, mais aussi le classicisme de Fragonard imprègnent encore l’air du temps, tout comme la nature rousseauiste. Ecrite le plus souvent avec accompagnement de piano ou de harpe, la romance est également destinée à la guitare ou à la lyre, dont les salons étaient friands.
Le programme, centré sur la figure singulière de Sophie Gail, fait alterner huit de ses romances avec des pièces contemporaines, dont quatre pour harpe seule. Si l’ariette « Oiseaux si tous les ans » d’un Mozart bien antérieur (1777) ne dépare pas, « An Chloe » et « Abendempfindung » (toutes deux de 1787) surprennent, malgré leur inspiration proche de celle de la romance, par l’usage de la langue allemande, alors impensable dans les salons, où tout le répertoire étranger était adapté en français.
Il est surprenant que la figure de Sophie Gail n’ait pas suscité auparavant la moindre curiosité. Cinq romances enregistrées depuis 1964 (1), excusez du peu. Après avoir publié ses premières pièces à 15 ans, puis travaillé avec Fétis, elle nous en laisse de fort nombreuses, mais aussi et surtout quatre opéras-comiques, dont l’ultime (La Sérénade) connaîtra sa recréation en Avignon pour les fêtes de fin d’année. Reconnue, après avoir diffusé la romance au cours de tournées dans toute l’Europe, elle tint salon, de 1808 à 1810, à côté de celui où Ingres tenait le violon, et de celui du prince de Chimay. Elle y accueillait les chanteurs à la mode (Garat, et Garcia, tout juste arrivé). Blangini, autre compositeur de romances, écrit à son sujet qu’elle « donnait la préférence à la musique sur le grec conjugal » (2). Victime de la tuberculose, elle disparaît à l’âge de 43 ans, en 1819.
Le récital paraît la meilleure introduction au genre. Ainsi le « Colas, Colas, sois-moi fidèle » (de Jadin) nous plonge dans ce répertoire où la plainte de l’amante abandonnée constitue un standard. Au plaisant refrain en forme de valse succède la première des romances de Sophie Gail. Si l’inspiration en est commune, la réalisation suffirait à démontrer les qualités d’écriture que soulignait Fétis. La fébrilité du garçon amoureux (« N’est-ce pas d’elle ») n’aura pas échappé aux auditeurs : ce sera un succès, fréquemment varié. « Mon cher Frontin », qui ferme le cycle, traduit avec une égale justesse les élans de passion juvénile. L’ample « Attente » est plus qu’une bluette. « La ronde du diable », nous vaut une musique aussi désinvolte que le texte, spirituel. Le lyrisme de « l’air du Chanoine de Milan » a de quoi séduire les amateurs. La mort n’a pas la gravité que le romantisme lui accordera. Cependant les deux airs inspirés par le Werther de Goethe (« La mort de Werther », puis « Charlotte sur le tombeau de Werther », respectivement de Jadin et de Jean-Louis Adam, le père d’Adolphe) sont porteurs d’émotion. La confession « Il faut mourir » de notre compositrice s’inscrit dans cette veine. « L’heure du soir », où l’attente se traduit par des phrases mélodiques bien conduites, prend des couleurs crépusculaires. « Celui qui sut toucher mon cœur », tyrolienne, ici fort bien chantée a cappella, atteignit à une célébrité peu commune si on en juge par les nombreuses variations que la mélodie suscita (dont deux au moins pour harpe). Chaque pièce appellerait un commentaire et la généreuse brochure d’accompagnement en est riche, reproduisant les textes en trois langues (français, anglais et allemand).
Maïlys de Villoutreys, bien connue des distributions baroques, trouve ici la fraîcheur épanouie qui sied à ce répertoire. Les phrasés sont conduits avec intelligence et délicatesse, l’expression est toujours appropriée, dont la sensibilité est dépourvue de mièvrerie. Tout juste regrette-t-on que l’auditeur ait peine à toujours comprendre le texte chanté, malgré sa prosodie le plus souvent syllabique, faute d’articulation. Mais l’effusion sentimentale comme l’expression dramatique sont au rendez-vous. La harpe, emblématique du Directoire et de l’Empire, restitue à ces mélodies leur caractère, le plus souvent élégant et expressif. En outre, les variations (dont celles de la romance de Chérubin, « Voi che sapete », par Nicolas-Charles Bochsa) sont bienvenues, éclairant le contexte qui entoura la création des romances. Clara Izambert, partenaire fidèle de notre soprano, joue avec bonheur ce répertoire qu’il nous faut découvrir.
Merci, donc, à nos interprètes pour cette illustration du genre, reflet de la sensibilité d’une époque, nous offrant une très large palette expressive, allant de la mélancolie à la légèreté et à la pochade (3).
(1) dont « Ma Fanchette est charmante » par Joan Sutherland (1964).
(2) Son mari, plus âgé d’une vingtaine d’années, était un helléniste réputé. Elle en avait divorcé dès 1801 pour vivre librement (4 enfants de quatre pères différents).
(3) « Le pleureur », de Martini, où l’amant déçu de Pierrette, sur un texte d’expression populaire, ne cache pas ses sanglots.