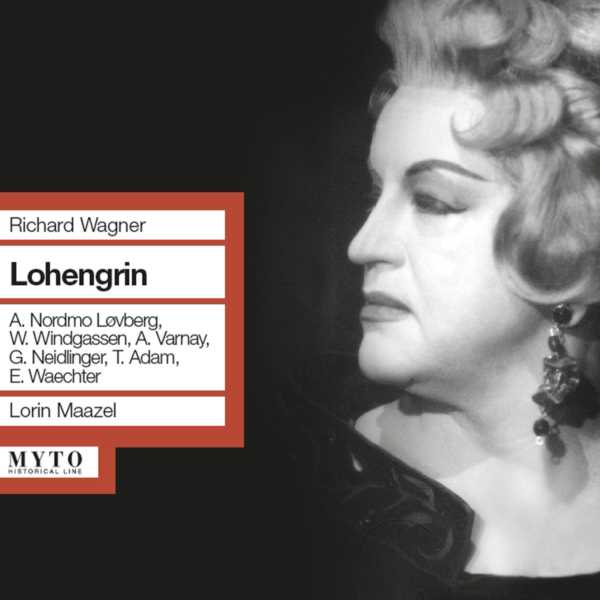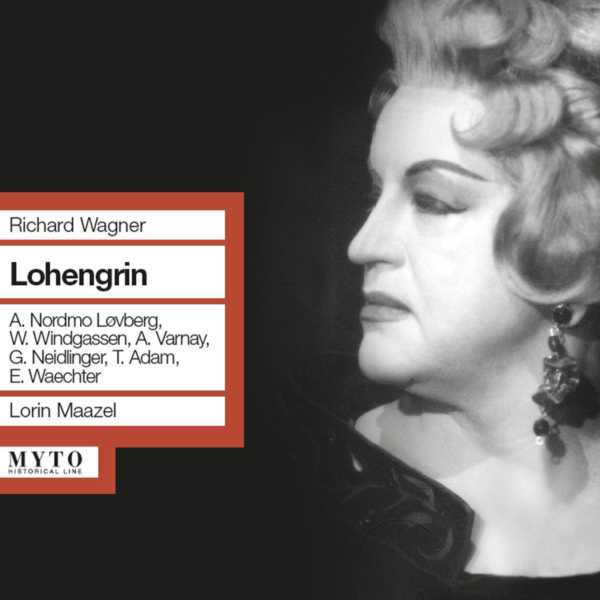Ce Lohengrin capté à Bayreuth le 25 juillet 1960 souffre d’une concurrence redoutable : les deux crûs bayreuthiens précédents (1958 et 1959), qui permettent notamment d’apprécier le Lohengrin ineffable de Sandor Konya, campent pour un bon moment au sommet de la discographie de l’œuvre.
Et pour en rester à cet été 1960, s’agissant du couple Lohengrin/Elsa, on n’est pas loin de ce que, dans un autre contexte, on appellerait une mauvaise pioche. Les hasards combinés des distributions multiples et des dates de retransmission n’aboutissent pas toujours à des résultats idéaux.
Comme toujours, Wolfgang Windgassen offre un chant probe, qui ne triche pas. Il n’empêche : sa voix n’est intrinsèquement pas celle du rôle, et elle s’est notablement alourdie depuis 1953/54, où il chantait déjà Lohengrin sur la Colline sacrée. A l’été 1960, le ténor regarde définitivement plus vers Tristan que vers Tamino. A l’aise sur les passages les plus vaillants du rôle, il se trouve en difficulté lorsque le chant est à découvert, ou situé sur un registre plus mélancolique ou élégiaque : cela se vérifie tout particulièrement au moment de son entrée, au I. Cette entrée, à froid, à capella, piano, sur le haut medium, est, il est vrai, redoutée de tous les titulaires du rôle.
L’engagement de l’Elsa d’Aase Nordmo Løvberg ne fait pas défaut, mais le timbre est peu flatteur, l’émission poussive, et l’intonation parfois approximative. Quelques beaux moments parviennent à émerger (en particulier à la fin du II), mais les emportements du III dans le duo avec Lohengrin la trouvent bien précautionneuse. Non que cette Elsa soit, dans l’absolu, indigne, mais on soulignera, en définitive, à quel point la comparaison avec ses devancières sur la colline sacrée est cruelle, qu’il s’agisse d’Eleanor Steber en 1953, de Leonie Rysanek en 1958 ou d’Elisabeth Grümmer en 1959.
Quand on sait qu’au cours de cet été 1960, Windgassen partageait Lohengrin avec Konya et que Nordmo Løvberg alternait en Elsa avec Grümmer (Konya et Grümmer ont été réunis pour 2 des 7 représentations, celles des 14 et 22 août), on se dit que les programmateurs du Bayerischer Rundfunk n’ont pas eu la main heureuse. Regrets éternels…
Fort heureusement, l’autre couple de la soirée offre de bien plus grandes satisfactions : avec l’Ortrud d’Astrid Varnay et le Telramund de Gustav Neidlinger, on renoue sans conteste avec la légende du chant wagnérien.
L’Ortrud bayreuthienne de Varnay existe à 4 reprises, en dehors de celle-ci : on la retrouve dans les témoignages de 1953, 1954, 1958 et 1962. Cette soirée ne nous apprend rien que l’on ne sache déjà. Elle confirme l’absolue adéquation au rôle : on est bien là en présence d’une incarnation wagnérienne majeure, d’un personnage vipérin, insinuant, hautain, conscient de son rang, mais aussi de sa déchéance. La voix est certes plus dure que pour les éditions précédentes : on rappellera que Varnay avait commencé sa carrière wagnérienne 19 ans auparavant, qu’elle en était à son dixième été bayreuthien d’affilée, et qu’elle chantait en outre cette année-là les trois Brünnhilde…. On n’en reste que plus admiratif devant le génie des mots et la puissance vénéneuse de la voix (« Entweihte Götter ! » est à faire se dresser les cheveux sur la tête). Chapeau bas.
Son partenaire la relance idéalement, notamment dans leur scène du début du II. Reste que Gustav Neidlinger est victime de son identification au rôle d’Alberich : dès qu’il chante, on se croirait au Nibelheim…
Avec Theo Adam (qui interprètait déjà le rôle en 1954), on tient un roi au timbre clair et bien chantant. Ce choix de confier le rôle à un baryton et non à une basse peut se défendre : il permet de rompre avec l’image traditionnelle d’un roi un peu barbon. Problème : le contraste entre les voix d’homme est par moment insuffisant, puisque l’on se retrouve avec 3 barytons et un ténor sombre…
Rien à dire du Héraut viril et crâne d’Eberhard Wächter, très convaincant, en dépit d’un cafouillage malencontreux dans son intervention à la scène 3 du I (le souffleur se retrouve bien seul…).
On a connu des directions plus inspirées que celle de Lorin Maazel : le prélude manque de souffle et de mystère, la fin du I est bien lourde, le duo d’amour au III est décousu (d’où des décalages entre la scène et la fosse). On note par ailleurs à plusieurs reprises des défauts de mise en place, notamment dans les fanfares en coulisse (et Dieu sait s’il y en a dans cette œuvre). Le chef d’orchestre n’est pas servi, il est vrai, par une prise de son un peu cotonneuse, qui ne permet pas, non plus, d’apprécier à sa juste valeur la prestation du chœur.
A signaler, enfin, des coupures difficilement admissibles à Bayreuth (notamment dans l’entrée de Telramund au II et à la fin du III).
Julien MARION