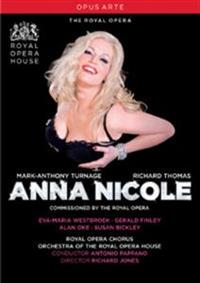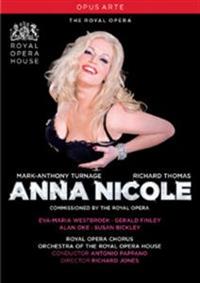D’Anna Nicole Smith (1967-2007), strip-teaseuse aux implants mammaires démesurés, élue Playmate de l’année 1993, ce que cet opéra retient, c’est la Mater Dolorosa qui tint sur ses genoux le corps de son fils mort à 20 ans d’une overdose, avant de décéder elle-même moins de six mois plus tard. Auteur de deux opéras, Greek (1988) et The Silver Tassie (2000), Mark Anthony Turnage a jeté son dévolu sur ce sujet a priori étonnant. Plein de calembours grivois et de gros mots, le livret mi-hilarant, mi-tragique de Richard Thomas s’en prend à une certaine vulgarité américaine, au voyeurisme de notre société consumériste, qui consomme surtout des images, les plus impudiques de préférence. En deux actes de longueur égale, l’opéra est construit comme un drame classique, avec ascension, puis déclin du personnage principal. Constamment escortée par sa maquilleuse, son costumier, sa coiffeuse, Anna Nicole se raconte aux micros brandis par les nombreux présentateurs (le chœur entier, très sollicité durant le premier acte), devant les caméras omniprésentes.
Dans sa mise en scène, Richard Jones s’en donne à cœur joie, dans une esthétique kitschissime à la Jeff Koons, avec notamment des animaux géants qui semblent sortis d’un dessin animé. Symbole de la société de consommation, le décor du deuxième acte inclut des poubelles à gauche, une cuvette de WC au milieu, un réfrigérateur et un téléviseur. Vers la fin, en un geste tout aussi symbolique de la Trash TV, on répand allègrement sur scène le contenu des poubelles d’Anna Nicole.
Eva-Maria Westbroek est ici transformée en vache blondasse mâchouillant un perpétuel chewing-gum. A partir de son apparition au tout début du premier acte, elle ne quitte plus la scène une seule fois. Le timbre crêmeux et les qualités dramatiques qu’elle met d’habitude au service de Wagner ou de Puccini sont ici exploitées à travers les différents airs ou ariosos qui parsèment la partition, notamment « You can pray, you can dream », juste après son opération mammaire, « Dreams », lors de son interview par Larry King, « Oh my Daniel, my baby boy », déploration à laquelle joignent leur voix la mère et l’avocat de l’héroïne, « Oh turn it off, turn it off », sorte d’air de la folie que lui inspire la télévision, et son ultime aria, qui reprend les contours mélodiques de « Wenn dein Mütterlein », des Kindertotenlieder. Dès la première partie, la narration est interrompue par les intrusions du « méchant » de l’affaire, l’avocat-meneur de jeu, Gerald Finley (déjà créateur du rôle principal de The Silver Tassie). L’excellent baryton canadien est moins bien servi par la partition puisqu’il n’a aucun véritable air, mais il campe avec une intelligence diabolique ce personnage sans scrupule. Dans le rôle de la mère, la mezzo Susan Bickley interprète avec brio quelques pages émouvantes, comme son air « Men, men, losers, idiots », le récit de la mort de Danny (rôle que l’on croit muet jusqu’à ce que le personnage interprète – post mortem ! – une cantilène où il énumère toutes les substances dont l’ingestion a causé sa mort), ou la reprise amère de « You can pray, you can dream » à la fin de l’opéra.
La musique de Mark Anthony Turnage est tissée de références au jazz, aux rythmes binaires de la danse et de la musique pop, et pas seulement pour la scène de la party au début du deuxième acte (il tenait notamment à obtenir la participation du batteur Peter Erskine, du guitariste John Parricelli et du bassiste John Paul Jones). Antonio Pappano dirige avec enthousiasme et conviction cette union réussie de la musique savante et de la musique populaire, lointaine descendante des œuvres de Leonard Bernstein, et l’on se réjouit de tenir là un opéra contemporain tout à fait réussi, à la fois drôle, intelligent et émouvant, comme les compositeurs ne nous en offrent pas si souvent.