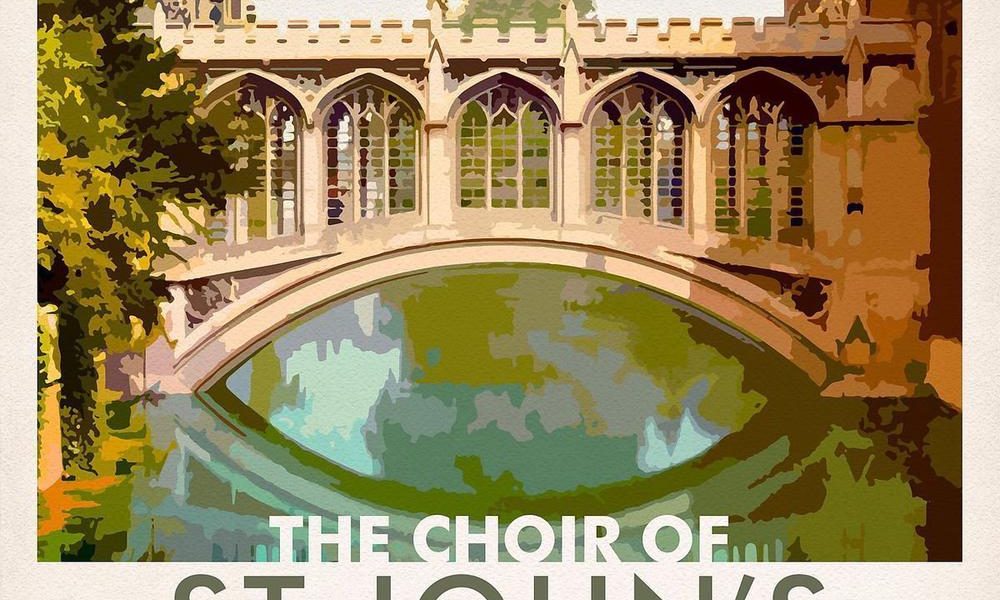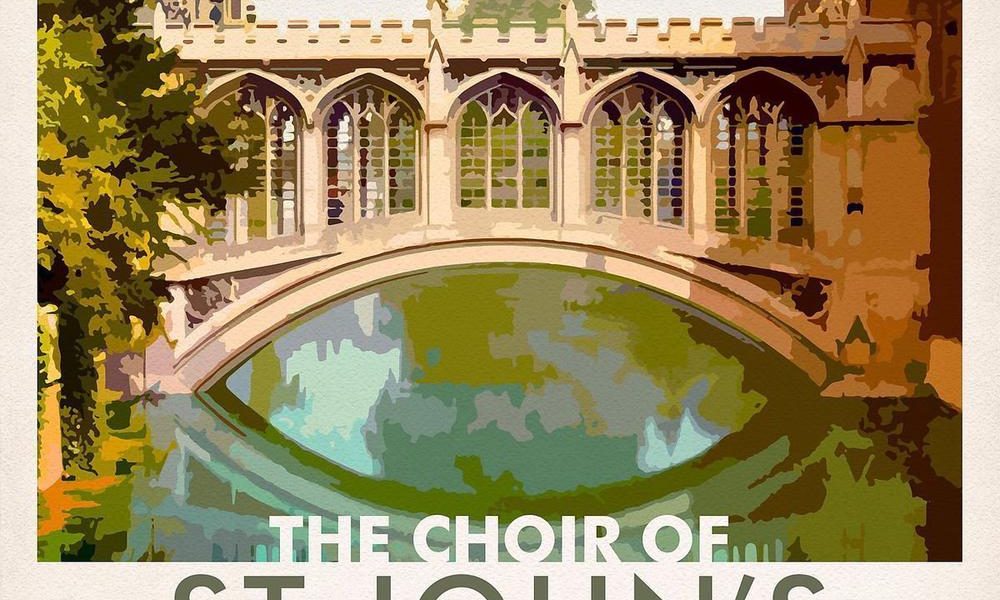Si on vous dit « maîtrise anglaise », il y a de fortes chances pour que vous songiez d’abord au Kings’ College Choir de Cambridge, à la pureté aérienne et désincarnée de ses trebles (sopranos) – perçue, à tort, comme emblématique des maîtrises d’outre-Manche. Sans pouvoir rivaliser avec le rayonnement international de son éternel rival (seule formation britannique sollicitée pour l’intégrale des cantates de Bach entreprise par Leonhardt et Harnoncourt), le St John’s College Choir n’en est pas moins prisé des connaisseurs, qui admirent à la fois ses couleurs latines et une approche plus passionnée, plus directe du discours musical.
La différence d’esthétique entre les deux maîtrises tient autant à la personnalité de leurs chefs qu’aux spécificités des lieux. Dominique Fernandez n’hésite pas à comparer l’office tel qu’il se déroule au King’s College à un véritable spectacle alors que celui du St John’s College s’apparente à « un rite presque secret, recueilli, intime » (La Rose des Tudor, Julliard, 1976). Les dimensions de la chapelle du King’s College, où la pierre nue abonde, y accentuent la réverbération et ont conduit David Willcocks à doser et à affiner les sonorités de son chœur. Au contraire, au St John’s College, « le son est beaucoup plus intime et immédiat », observe Geraint Lewis dans l’excellent livret qui accompagne le coffret de DECCA, mais en même temps « l’espace est suffisamment grand pour permettre la richesse et la puissance », les boiseries confèrent au chant « un focus plus clair et encouragent une émission plus retentissante et désinhibée ». Cette acoustique propice a conduit George Guest à se rapprocher de « la sonorité vigoureuse, continentale », d’où le vibrato n’est pas exclu, que George Malcolm avait explorée à la cathédrale de Westminster. Franchise de l’émission, mais aussi de l’expression avec une autre attention portée au texte quand la concurrence tend à se focaliser sur la plastique sonore. « Il nous montrait l’importance pour les chantres d’un chœur de communiquer les émotions », témoigne Andrew Nethsingha, actuel directeur de la formation, « et de traduire la signification intime des mots. »
Lui-même boyish treble à la cathédrale de Bangor, sa ville natale au nord du Pays de Galles, George Howell Guest (1924-2002) arrive au St John’s College en 1947, comme organiste, avant de succéder à son professeur, Robin Orr, à la tête du chœur en 1951. Trois ans plus tard, ce dernier fait partie des rares élus invités à se produire à la BBC. En 1958, Harley Usill propose à George Guest d’enregistrer un premier disque pour Argo Recording Company qui vient d’engager, deux ans plus tôt, le King’s College Choir. Néanmoins, l’éditeur s’efforcera d’éviter la confrontation et les doublons demeureront exceptionnels. Si, par exemple, David Willcocks dirige la Nelsonmesse pour les micros d’Argo avec le LSO (1962), George Guest grave sept autres messes de Haydn (de la Theresienmesse, en 1965, aux Kleine Orgelmesse et Cäcilienmesse, en 1977) avec l’Academy of St Martin in the Field, partenaire privilégié, à défaut d’être exclusif, du St John’s College Choir dès le premier des 42 vinyles publiés par le label britannique. Absentes du catalogue Argo, certaines pages célèbres où s’illustrent volontiers les maîtrises anglo-saxonnes seront gravées pour d’autres labels, notamment le Miserere d’Allegri (Meridian puis EMI).
Des traditionnels carols à Poulenc (les Litanies à la Vierge noire et surtout une magistrale Messe en sol) en passant par Victoria ou Liszt (Missa choralis), le répertoire de la maîtrise n’a cessé de s’élargir au fil des ans et les réalisations les plus abouties ne sont pas forcément celles auxquelles nous pourrions nous attendre. De fait, à l’instar de Haydn, Mozart (en particulier Les Vêpres K 321 (1980)), Beethoven (Messe en ut (1974)) et même Schubert (Messe en mi bémol majeur D 950), où les chanteurs de Cambridge soutiennent parfaitement la comparaison avec les Wiener Sängerknaben, nous enchantent littéralement quand le baroque, souvent, déçoit (Monteverdi, Scarlatti, Bononcini…) Toutefois, à l’exception d’un Stabat Mater de Pergolesi où Felicity Palmer, à contre-emploi, et Alfreda Hodgson leur cèdent deux duos et l’Amen, chaque programme ou presque recèle des trésors et vaut ainsi le détour. Ainsi, le premier album Purcell, gravé en 1964 et sur lequel Charles Brett fait ses débuts au disque (Music for the Chapel Royal), accuse quelques raideurs et pesanteurs, mais O sing unto the Lord nous révèle un quatuor poignant où se fond avec bonheur le jeune contre-ténor (« O worship the lord in the beauty of holiness »).
Autre plaisir et non des moindres pour le mélomane : à la faveur de certaines gravures, c’est parfois tout un chapitre de l’histoire de l’interprétation musicale au Royaume-Uni qui se rappelle à nous et le souvenir d’émotions oubliées qui resurgissent avec une étonnante vivacité. Lorsqu’un enregistrement réalisé en mars 72 nous permet de retrouver James Bowman, son timbre adolescent et doux-amer, idoine dans les dissonances de « Vouchsafe, o Lord » (Te Deum en ré majeur Z232), l’un des pages les plus personnelles de Purcell, nous nous remémorons immédiatement le David (Saul de Haendel) solaire et d’une plénitude inégalée que le contre-ténor incarnera deux mois plus tard sous la direction de Charles Mackerras (ARCHIV) puis ses débuts dans le Messie pour l’intégrale – la première exclusivement masculine – que David Willcocks, à la tête du King’s College, achèvera en juillet de la même année (EMI). Parmi les trebles solistes retenus par George Guest pour ce deuxième disque Purcell, comment ne pas relever la présence de Simon Keenlyside et de Robert King ? Vingt ans plus tard, c’est ce dernier qui dirigera Bowman dans le même Te Deum (Hyperion)… En 73, un splendide florilège de chants de Noël (Christmas at St John’s) réunit à nouveau les deux garçons, rejoints par Lynton Atkinson, le futur ténor, sur un joyau gallois arrangé par Guest (« Suo gãn »). L’année suivante, Robert King livre un Pie Jesu désarmant de candeur et de fragilité dans le Requiem de Duruflé, autre version de référence au sein de l’imposante discographie du St John’s College Choir, à côté de celle du Requiem de Fauré (1975).
Bien sûr, l’une ou l’autre démarche risque de surprendre, voire de diviser, aujourd’hui comme à l’époque, tels ces Gloria de Vivaldi exotiques, où boyish trebles et falsettistes se substituent aux voix féminines, ou cet air de soprano du Deutsches Requiem confié à Alastair Roberts (également vedette du Hear my prayer de Mendelsohn) et privé d’orchestre – péché de jeunesse, en l’occurrence, pour le disque inaugural de la maîtrise (1958). Toutefois, l’immense legs que Decca réédite aujourd’hui ne se laisse pas réduire à ces choix, certes discutables mais isolés et chacun, n’en doutons pas, y trouvera son compte, qui chez Palestrina, qui chez Britten, etc. En outre, l’aventure ne s’arrête pas là. D’abord, le St John’s College Choir a signé, parallèlement à sa collaboration avec Argo, plusieurs disques chez d’autres labels, à l’image, par exemple, d’A sequence for st Michael que Herbert Howells composa pour le 450e anniversaire de la fondation du collège en 1511 et qui fut immortalisé par Nimbus. De surcroît, après les décennies marquées par George Guest, Naxos, puis Chandos, qui avait déjà publié une messe de Minuit de Charpentier (H 9) et des motets de Poulenc, enregistreront de nombreuses galettes avec le chœur de Cambridge avant que celui-ci, en 2016, ne crée sa propre collection chez Signum.