Lewis : les anglophiles songeront probablement à l’auteur du Moine (Matthew Gregory Lewis), célèbre roman gothique ou au plasticien et fondateur du vorticisme, cet avatar insulaire du cubisme (Percy Wyndham Lewis), d’autres encore au héros d’une excellente série policière ayant pour cadre la ville et la faune passablement dérangée d’Oxford (Inspecteur Lewis). En revanche, il y a fort à parier que seule une poignée de baroqueux se souviendront de Sir Anthony Lewis, qui dirigeait la légendaire Didon de Janet Baker en 1961. Si la Phèdre déchirante incarnée quatre ans plus tard et toujours sous sa conduite visionnaire par la chanteuse britannique décidera de la vocation d’un jeune étudiant de Harvard, hésitant alors entre la musique, les lettres et l’histoire de l’art – vous aurez reconnu William Christie –, ce n’est pourtant pas à Rameau ni même à Monteverdi, dont il enregistra la première intégrale des Vêpres à la Vierge, mais bien à Purcell et à Haendel que son nom reste associé.
Après avoir étudié avec E. J. Dent à Cambridge puis avec Nadia Boulanger, Anthony Carey Lewis (1915-1983) rejoint la BBC en 1935. Directeur du Troisième Programme au sortir de la guerre, il dépoussière de nombreuses raretés et s’attèle à remonter plusieurs opéras de Haendel dont il cosigne également l’édition moderne ainsi que la traduction anglaise. Sur le plan discographique, les années 50 sont littéralement bénies des dieux et jalonnées de résurrections majeures dont, aujourd’hui, l’intérêt n’est pas que historique. Hormis les enregistrements déjà évoqués, Anthony Lewis réalise les premières gravures de Semele, avec la somptueuse Jennyfer Vyvyan, et de Sosarme, seul rôle complet du Saxon jamais gravé par Alfred Deller et le premier par un contre-ténor (disponible en CD chez Opera d’Oro). De Purcell, Decca avait déjà ressorti Dido & Aeneas (1961) et King Arthur (1958) et il ne manquait plus, dans sa musique de scène, que cette Fairy Queen (1957) dont il avait également édité la partition pour la Purcell Society.
Il ne faudrait pas s’arrêter à ce qui heurte, de prime abord, et trahit l’âge de cet enregistrement : le manque flagrant de couleurs et les timbres incongrus des instruments modernes (Boyd Neel Orchestra), car, dans le même temps, nous sommes aussi agréablement surpris par la souplesse des phrasés et le soin apporté à l’articulation. Inégalement inspiré dans les pages instrumentales, Anthony Lewis peut libérer l’ivresse rythmique d’une gigue puis priver d’élan et de motricité la symphonie d’ouverture du 4e acte, mais son geste n’est jamais empesé ni emphatique. En revanche, il se révèle un formidable créateur d’atmosphères : il faut entendre la Nuit répandre ses pavots assoupissants ou le Sommeil évoluer dans un climat de rêve éveillé (« Hush no more ») – la justesse, le pouvoir d’évocation de Trevor Anthony forcent déjà l’admiration, quelques mois avant qu’il n’immortalise un air du Froid à ce jour inégalé (King Arthur).
L’éloquence des St. Anthony Singers comme celle des solistes, hormis un contre-ténor défaillant et hors sujet qui déséquilibre d’ailleurs le duo de Corydon et Mopsa (Peter Boggis), leur intelligence du style, constituent le maître atout de cette interprétation qui, à cet égard, n’a pas grand chose à envier aux lectures ultérieures. Bien sûr, nous aurions aimé entendre davantage le soprano, autrement personnel et riche, de Jennifer Vyvyan, que celui d’Elsie Morison, d’autant qu’elle parvient à restituer l’ineffable mystère de « The Plaint » malgré un violon trop métallique et plutôt envahissant. En outre, s’il parvient à tirer son épingle du jeu dans « A thousand, thousand ways we’ll find », l’alto profond et chaleureux de John Whitworth se retrouve piégé par la tessiture trop basse de « One charming night » (tout le monde emboitait alors le pas à Michael Tippett et confiait systématiquement les parties de « countertenor » à des falsettistes). En revanche, la scène du poète ivre, parfaitement croquée et dosée par Thomas Hemsley, ne laisse pas de fasciner tant elle semble naturelle et jaillir dans l’instant – elle pourrait avoir été enregistrée hier, sur scène. La prestation de Peter Pears (Phoebus, Autumn, A Chinese Man), qui vient alors d’avoir quarante-six ans, frappe aussi par sa présence au texte et la précision des éclairages que module à l’envi ce maître du clair-obscur et des nuances melliflues.
Puisse DECCA poursuivre son exploration du legs d’Anthony Lewis et nous rendre également les ouvertures de Boyce, Venus and Adonis (Blow) et surtout le Comus de Arne (1738), un des plus grands succès du théâtre musical au XVIIIe siècle, dont les airs strophiques simplement accompagnés par les violons annoncent le genre éminemment britannique du ballad-opera.



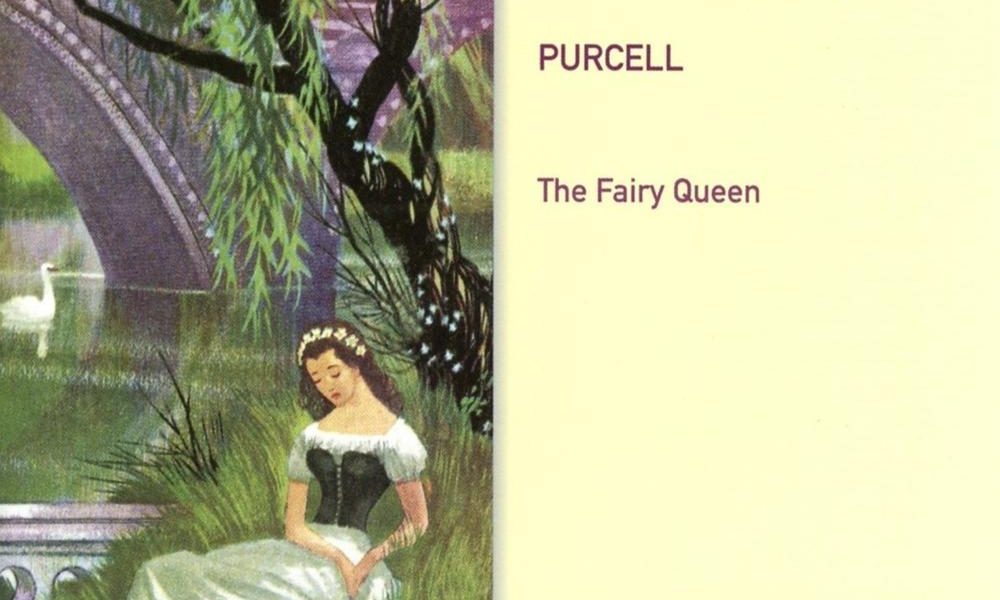
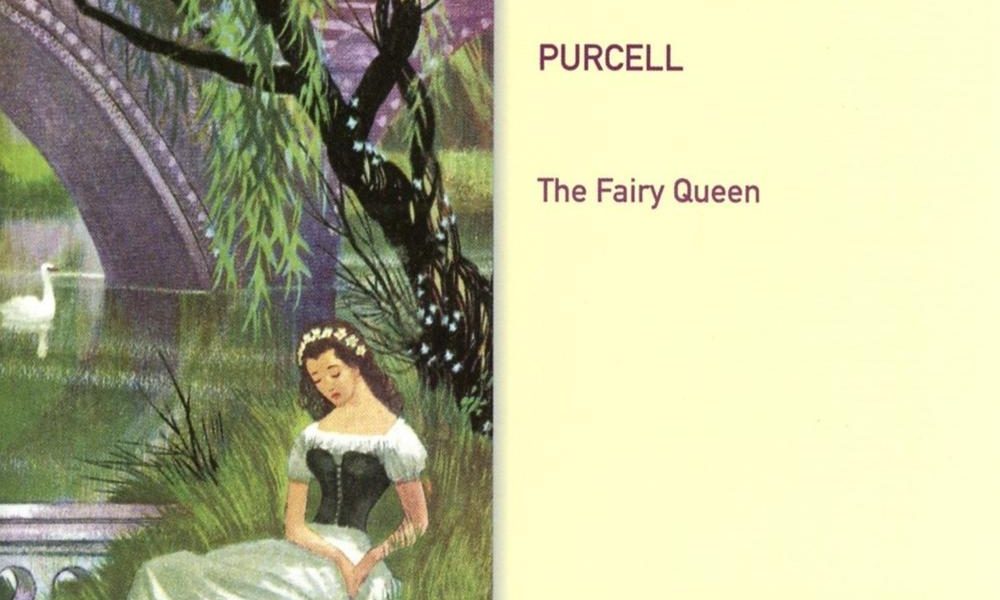
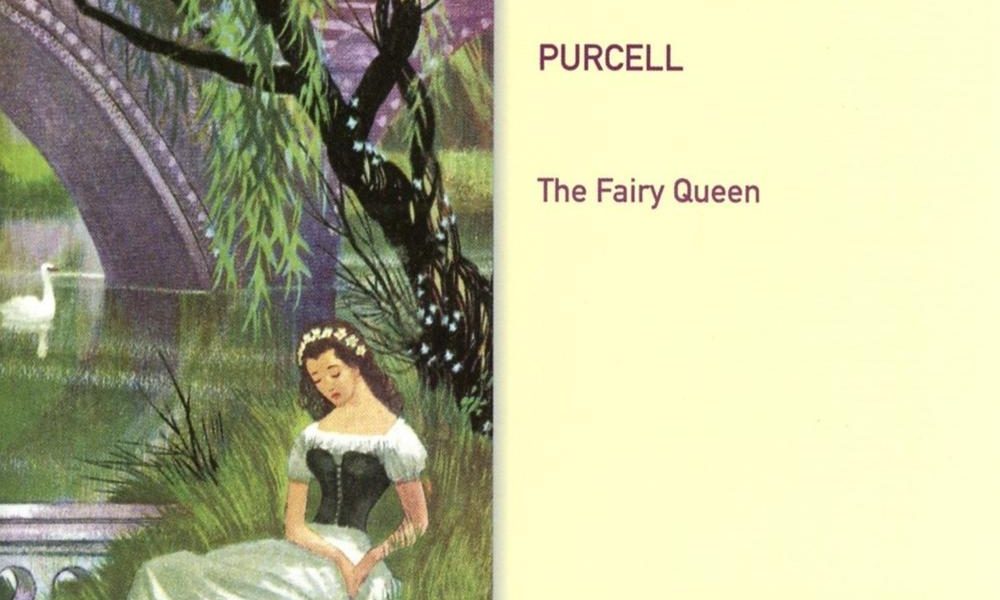




 : Supérieur aux attentes
: Supérieur aux attentes

