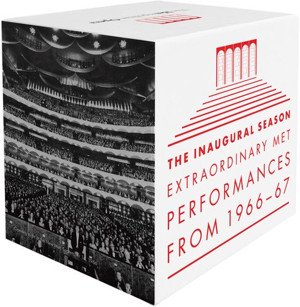C’était il y a 50 ans, le 16 septembre 1966 très exactement: la troupe du Metropolitan Opera de New York quittait ses vénérables locaux de Broadway, qui l’abritaient depuis 1883, pour gagner la salle flambant neuve construite au Lincoln Center. C’en était donc fini du old MET, et de son parfum de légende: Enrico Caruso, Nellie Melba, Geraldine Farrar, Rosa Ponselle, les frères de Reszké, Lawrence Tibbett, Giovanni Martinelli, Lauritz Melchior et tant d’autres y avaient connu leurs plus grands triomphes, sous les directions de Gustav Mahler, Arturo Toscanini, Bruno Walter, George Szell, Bruno Walter… On quittait donc Broadway avec ce qu’il faut de nostalgie, mais aussi cette dilection très américaine pour les nouveaux départs. Il faut dire qu’on gagnait au change: aux locaux vieillots du old MET succédaient des installations scéniques dernier cri, dans un écrin gigantesque (3975 places!). On se reportera, pour plus de précisions, à l’article thématique consacré à la salle dans ces colonnes.
Pour fêter dignement cet anniversaire, le MET publie très opportunément un coffret retraçant, à travers dix représentations, cette saison inaugurale du MET au Lincoln center. La retransmission radiophonique des représentations étant – pour le plus grand bonheur des discophiles – une spécialité ancienne du MET (la première retransmission intégrale date de 1931, c’était une représentation Hänsel et Gretel), l’exercice était donc aisé pour la maison d’opéra, à qui il a suffi d’aller piocher dans ses riches archives.
Avant de procéder à l’examen du contenu de ce coffret, il faut saluer avec enthousiasme l’exercice consistant, pour une maison d’opéra, à rendre compte de la réalité de sa production à l’échelle d’une saison entière. Peuvent ainsi apparaître, dans leur cohérence, les choix artistiques, les forces mais aussi les faiblesses d’une institution, bien plus qu’à travers la reproduction d’une soirée isolée.
Pour constituer ce coffret reflet d’une saison à bien des égards exceptionnelle, le MET avait donc l’embarras du choix. Evoquons donc cette matière première si généreuse: la saison 1966/1967 a vu à l’affiche 283 représentations de 25 titres différents. A deux exceptions près (Tristan et Ballo), toutes les oeuvres jouées ont fait l’objet d’une radiodiffusion. Le choix devait donc s’opérer entre 23 titres*. Seuls dix ont eu les honneurs du coffret, où ils apparaissent sous la forme de coffrets cartonnés séparés: Antoine et Cléopâtre, de Samuel Barber (retenu pour l’ouverture de la saison, et l’inauguration du nouveau MET), Turandot, Aida, Otello, Peter Grimes, Lucia di Lamermoor, Madame Butterfly, La Femme sans ombre, Rigoletto, La Flûte enchantée. Parce que choisir c’est renoncer, il faut inévitablement interroger le choix des dix heureux élus, d’autant que le livret qui accompagne le coffret est muet sur ce point. S’agissant du choix des répertoires représentés, le coffret accentue le déséquilibre de la saison: l’opéra italien se taille encore plus la part du lion, avec 6 opéras sur 10 dans le coffret (13 sur 25 pour l’ensemble de la saison), au détriment du répertoire allemand, présent avec 2 titres (7 pour la saison). On aurait ainsi volontiers troqué la Madame Butterfly du 18 mars 1967 contre le Lohengrin du 21 janvier de la même année, qui alignait une distribution flatteuse (Sándor Kónya, Ingrid Bjoner, Christa Ludwig, Walter Berry…) sous la baguette experte de Karl Böhm… De même, à une Flûte enchantée assez moyenne, faute d’une distribution adéquate, on aurait volontiers substitué le Don Giovanni alignant Cesare Siepi, Pilar Lorengar, Joan Sutherland, Nicolai Gedda et Ezzio Flagello, toujours sous la baguette de Karl Böhm. Cela renvoie à une autre observation, qui va au delà du contenu du présent coffret: le choix des dates retenues pour les radiodiffusions laisse parfois perplexe. Si l’on en reste à la Flûte enchantée, pourquoi avoir ainsi choisi la quatrième représentation, en date du 4 mars, à la distibution plus que moyenne, et non la première, datée du 19 février, qui proposait un casting autrement plus prometteur (Pilar Lorengar en Pamina, Nicolai Gedda en Tamino, Lucia Popp en Reine de la nuit, Hermann Prey en Papageno…) ? On se perd en conjectures.
Ces remarques préalables étant faites, considérons, sans faire la fine bouche, ce qui est et non ce qui aurait pu être. Et prenons-le pour ce que c’est : d’abord un reflet de la capacité inégalée du MET à aligner des castings imbattables. Quel festival ! Procédons à la revue de détail.
Ainsi, la représentation de Turandot, captée le 3 décembre 1966, offre grâce à Birgit Nilsson et Franco Corelli l’une des joutes vocales les plus insensées que l’on ait jamais entendue dans cette oeuvre. Lui, surtout, semble délivré de son trac légendaire et émaille la soirée d’aigus radieux. On sera plus nuancé sur la prestation de Mirella Freni en Liù.
La représentation d’Aïda, déjà commentée dans le cadre du coffret Verdi at the MET publié par Sony Classical à l’automne 2013. C’est vraiment, comme nous l’écrivions à l’époque, du chant « toutes voiles dehors ». Leontyne Price est, en Aïda, à son absolu sommet, insolente de beauté vocale pure, surclassée néanmoins (c’est possible !) par l’Amnéris renversante et juvénile de Grace Bumbry. Quant à Carlo Bergonzi, il administre comme à son habitude une leçon de chant verdien. Robert Merrill fait preuve de solidité et livre un acte du Nil très réussi.
On retrouve Leontyne Price pour la soirée d’ouverture de cette nouvelle saison, le 16 septembre 1966. Il fallait évidemment une création pour un tel événement: commande fut donc passée au compositeur Samuel Barber, qui composa pour l’occasion son opéra Antoine et Cléopatre. La partition devait notamment permettre de valoriser le satin vocal de Leontyne Price, pour qui elle fut écrite. A cet égard, la mission est accomplie, et la chanteuse fait merveille dans ces pages spécialement composées à son attention. Son entrée tout comme son air final (« Give me my robe ») sont de grands moments de glamour vocal. Le reste de la distribution ne dépareille pas, avec une mention particulière pour le César d’airain de Jess Thomas.
On retrouve Verdi avec le Rigoletto, capté le 8 avril 1967. Dans le rôle-titre, Cornell McNeill est solide. En Gilda, Roberta Peters minaude hélas plus que de raison. On retiendra surtout le Duc vif-argent de Nicolai Gedda (malheureusement privé de cabalette au III !), digne des meilleurs, et on oubliera aussi vite la direction lymphatique de Lamberto Gardelli, qui frôle le naufrage à plusieurs reprises, tout comme le Sparafucile fâché avec la justesse de Bonaldo Giaiotti.
Pour en finir avec Verdi, le Maure est mieux servi que le bouffon. La représentation d’Otello (le 11 avril 1967) permet en effet d’apprécier dans de bonnes conditions l’incarnation de James McCracken, par ailleurs si sujet à controverses. L’engagement frappe, d’emblée : un fauve est sur scène, cela se perçoit immédiatement, presque physiquement. Les moyens sont loin d’être minces, et on comprend, à l’écoute, la fascination qui a pu se dégager de cette incarnation. Pour autant, il est difficile de passer sous silence un relâchement stylistique quasi généralisé, dont le « Dio mi potevi » offre un redoutable condensé : difficile de faire plus caricatural. La Desdemone de Montserrat Caballé charme, mais on en attendait plus. Quant à Tito Gobbi, il parvient, non sans talent, à masquer par ses dons de comédien l’usure impitoyable de sa voix. Le trait est souvent grossi, mais le génie est là.
La Lucia di Lamermoor donnée le soir de la Saint-Sylvestre 1966 permettait au public new-yorkais d’apprécier une des principales attractions de la nouvelle saison : Joan Sutherland, qui faisait ses débuts in loco. Ce soir-là, la Stupenda méritait indéniablement son surnom, en se livrant à une démonstration impressionnante de virtuosité belcantiste. C’est, d’un point de vue strictement vocal, absolument irrésistible. Pour le théâtre, en revanche, on repassera… Autour d’elle, on joue les utilités. La plus-value de cette soirée par rapport aux enregistrements studio qui voient la même Sutherland mieux entourée, apparaît en définitive bien mince.
On en arrive à la même conclusion avec la Madame Butterfly captée le 18 mars 1967. Son intérêt principal, à l’évidence, réside dans la Cio-Cio-San de Renata Scotto. Jeune, vocalement radieuse (quoi qu’encore un peu acidulée…), elle séduit par son incarnation troublante et tout en subtilité. Mais la scène n’apporte rien, la direction indiffère, et le Pinkerton du ténor George Shirley ne se situe pas au même niveau, c’est un euphémisme… Là encore, le studio (Barbirolli, chez EMI, enregistré l’année précédente) est nettement préférable.
Pour ce qui est du répertoire allemand, on avouera une réelle frustration à l’écoute de La Flûte Enchantée (matinée du 4 mars 1967). A l’évidence, le chef est à sa place, et sa direction témoigne d’une réelle intimité avec l’oeuvre. Mais la scène n’égale pas la fosse, loin s’en faut, et cette Flûte pêche par une distribution trop inégale. Seule la Reine de la nuit de Roberta Peters et le Sarastro de John Macurdy tirent leur épingle du jeu. Le Tamino de George Shirley est bien lourd et la Pamina de Judith Raskin terne et superficielle. Quant au Papageno de Theodor Uppmann, s’il parvient manifestement à faire rire le public, il peine, réduit à ses seules qualités musicales, à emporter l’adhésion de l’auditeur aveugle… On regrettera, une nouvelle fois, que la distribution de la première, autrement plus allèchante, n’ait pas été préférée.
On retrouve en revanche avec un bonheur non dissimulé La Femme sans ombre dirigée par Karl Böhm, bien connue des discophiles. Certes, la partition est coupée, pour être plus accessible à un public considéré – à tort ou à raison – comme peu réceptif aux élucubrations métaphysiques de Strauss et Hofmannsthal. Mais la direction de Karl Böhm rend justive comme bien peu à cette partition si complexe. Et la distribution est imbattable: le couple impérial formé par Leonie Rysanek et James King n’appelle que des louanges (si l’on veut bien attendre que Rysanek se soit chauffée la voix : son entrée est en effet… déroutante). En miroir, Barak et sa femme, campés par Walter Berry et Christa Ludwig, vocalement somptueux, forment un couple bouleversants d’humanité. Une très grande soirée straussienne, à l’égal des témoignages dirigés par Herbert von Karajan à Vienne en 1964, ou par le même Karl Böhm à Salzbourg dans les années 70.
On reste sur des hauteurs peu communes avec le Peter Grimes dirigé le 11 février 1967 par Colin Davis. C’est l’affinité évidente du chef avec l’oeuvre qui frappe d’abord, et sa capacité à en restituer les climats si prenants. Il est difficile, par ailleurs, de rester insensible à l’incarnation du rôle-titre par Jon Vickers, assurément une des plus abouties, tous répertoires confondus, de la seconde moitié du vingtième siècle. Voilà un portrait déchirant, servi par des moyens vocaux inentamés : une leçon, qui n’en finit pas de hanter. Le reste de la distribution se montre à la hauteur, ce qui n’est pas peu dire.
Si l’on ajoute au dix intégrales le disque bonus, composé d’extraits d’autres représentations (Don Giovanni, Lohengrin ou Elektra attisent bien des regrets…), ce coffret retraçant la saison inaugurale du MET dans ses nouveaux locaux cumule, en définitive, les pépites musicales. On remarquera qu’il s’agit d’abord et avant tout de pépites vocales, conformément à une tradition non démentie dans cette maison. Des directions d’orchestre de qualité sont bien présentes (Böhm, Mehta, Krips…) mais on a presque envie d’écrire « par accident ». Si on en avait le loisir, on arriverait sans doute à la même conclusion s’agissant des mises en scène. C’est bien la voix qui est d’abord mise à l’honneur au MET, le reste (direction, mise en scène) n’ayant pour finalité que de lui fournir le cadre le plus propice. De ce primat de la voix, ce coffret offre donc un reflet fidèle. Dès lors, on comprendra que le tout vaut bien mieux que la somme des parties : prises isolément, les versions des 10 oeuvres présentes ici sont toutes confrontées à des prestations plus convaincantes ailleurs dans la discographie. Mais peu importe en définitive : l’objet de ce coffret n’est pas de proposer dix versions de référence, mais bien d’offrir un reflet fidèle de l’activité du MET au sommet de sa gloire. C’est, à cet égard, une réussite indéniable.
*Antoine et Cléopatre, La Gioconda, La Traviata, Turandot, La Femme sans ombre, Rigoletto, Don Giovanni, Faust, Elektra, Aïda, Tristan et Isolde, Tosca, Lohengrin, Lucia di Lamermoor, Les Maîtres chanteurs de Nurenberg, La Chauve-souris, La Bohème, Peter Grimes, Le Trouvère, La Dame de Pique, La Flûte enchantée, Otello, Madame Butterfly, Mourning becomes Electra, Un Bal masqué.