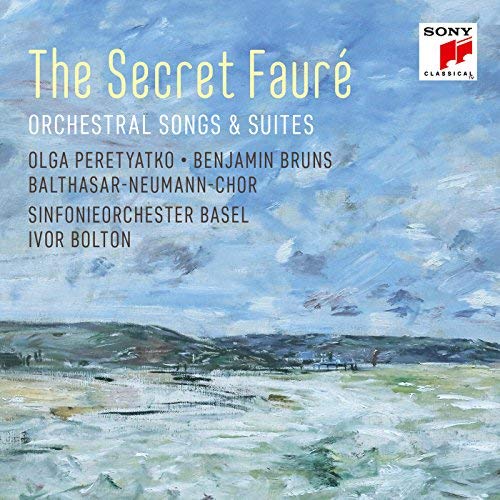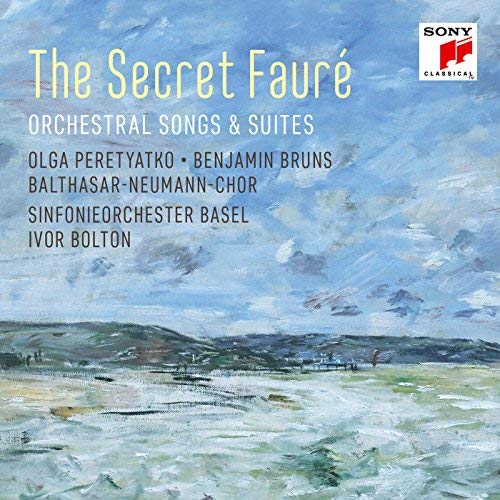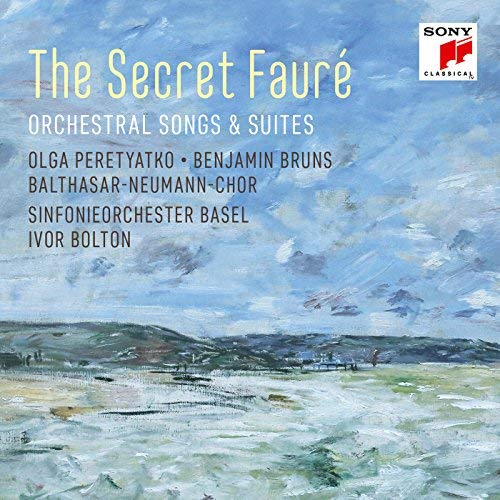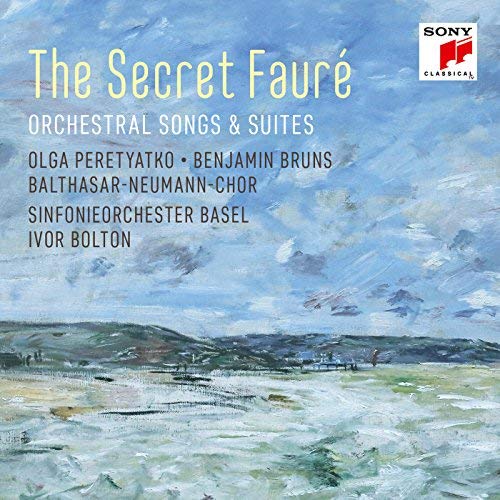C’est l’histoire d’une dame du meilleur monde, dont le public pense qu’elle se consacre au répertoire italien, interprétant Rossini et Verdi, alors qu’en cachette, elle s’adonne à son vice favori : elle chante du Fauré. Comme la Susanna de Wolf-Ferrari, Olga Peretyatko nourrirait-elle un secret coupable que jusqu’ici nul n’avait percé à jour ? Pas tout à fait, quand même… Certes, la soprano russe n’est pas indifférente à la musique française, puisqu’elle campait récemment les quatre héroïnes des Contes d’Hoffmann et qu’elle inscrit de temps à autre la Leïla des Pêcheurs de perles à son agenda, mais ces incursions restent assez rares, et il y a encore loin de l’opéra-comique à l’univers feutré de la mélodie fin de siècle. On pourrait donc s’étonner de voir figurer son nom sur la pochette d’un disque théoriquement destiné à révéler la musique méconnue de Fauré. En fait, la contribution de madame Peretyatko se borne ici à ce qu’il y a sans doute de moins secret chez ce cher Gabriel, puisqu’elle chante quatre de ses mélodies les plus célèbres. Bien sûr, la rareté tient ici au fait que lesdites mélodies aient été orchestrées, alors qu’on les donne presque exclusivement accompagnées au piano. Orchestrées par le compositeur en personne, en ce qui concerne Clair de lune et Les Roses d’Ispahan, par Henri Büsser pour Après un rêve, par Louis Aubert pour Soir. Il n’est pas certain que ces orchestrations ajoutent grand-chose à la gloire de Fauré, ni qu’Olga Peretyatko en soit nécessairement l’interprète la plus idoine. Même si son français est dans l’ensemble acceptable, on le trouvera inévitablement moins naturel que celui de Karine Deshayes, qui a gravé à peu près le même programme avec l’orchestre de l’Opéra de Rouen. La soprano revient ensuite pour la Chanson de Mélisande (en anglais), dans la suite d’orchestre la plus connue de Fauré, conçue à partir de la musique de scène commandée par Mrs Patrick Campbell pour monter la pièce de Maeterlinck à Londres.
Jusque-là, le titre du disque est donc assez mensonger, puisque ce Fauré-là n’a rien de bien secret. Le Prélude de Pénélope n’arrange rien, car il n’appartient pas à la catégorie « Orchestral Songs & Suites » définie par le sous-titre du CD. Mais admettons que cette page constituera une découverte pour beaucoup de mélomanes, y compris en France, où l’on donne trop peu l’unique opéra de Fauré.
On entre enfin dans le vif du sujet avec les deux autres œuvres au programme, Shylock et Caligula. Pour la première, il s’agit là encore de musiques de scène, composées en 1889 pour une adaptation du Marchand de Venise, où un ténor intervient deux fois. Shylock n’en est pas à sa première gravure, et bien des artistes s’y sont essayés (Michel Sénéchal, Nicolai Gedda, Henri Legay…). La prestation de Benjamin Bruns est tout à fait honorable, le ténor se montrant assez stylé dans les deux mélodies qui lui reviennent.
Caligula est un peu moins fréquenté. Notons au passage une jolie bourde dans le livret d’accompagnement, signé Nicolas Southon : l’institution dotée d’un « ensemble instrumental chétif » pour laquelle fut commandée à Fauré une musique de scène lors de la reprise du Caligula de Dumas père, ce n’est évidemment pas « l’Opéra-Comique », comme indiqué par erreur, mais l’Odéon, que Paul Porel dirigea de 1884 à 1892 (sous son mandat, Jean-Paul Laurens peignit pour la salle un plafond dont on espère qu’il existe encore sous la nouvelle décoration commandée à André Masson par André Malraux). Pas de soliste, cette fois, mais de nombreuses interventions d’un chœur de voix féminines. Les dames du Balthasar-Neumann-Chor tirent fort bien leur épingle du jeu, dans un français bien articulé et avec une appréciable pureté de ligne.
Hélas, c’est du côté de la direction que le bât blesse. Les mélodies orchestrées manquent cruellement d’allant : sous la baguette d’Ivor Bolton, les roses de Perse semblent bien pesantes, le rêve bien lourd, et le clair de lune bien languissant. Somme toute, un disque qui ne saurait réellement prétendre à détrôner l’enregistrement des œuvres orchestrales de Fauré réalisé par Michel Plasson au début des années 1980.