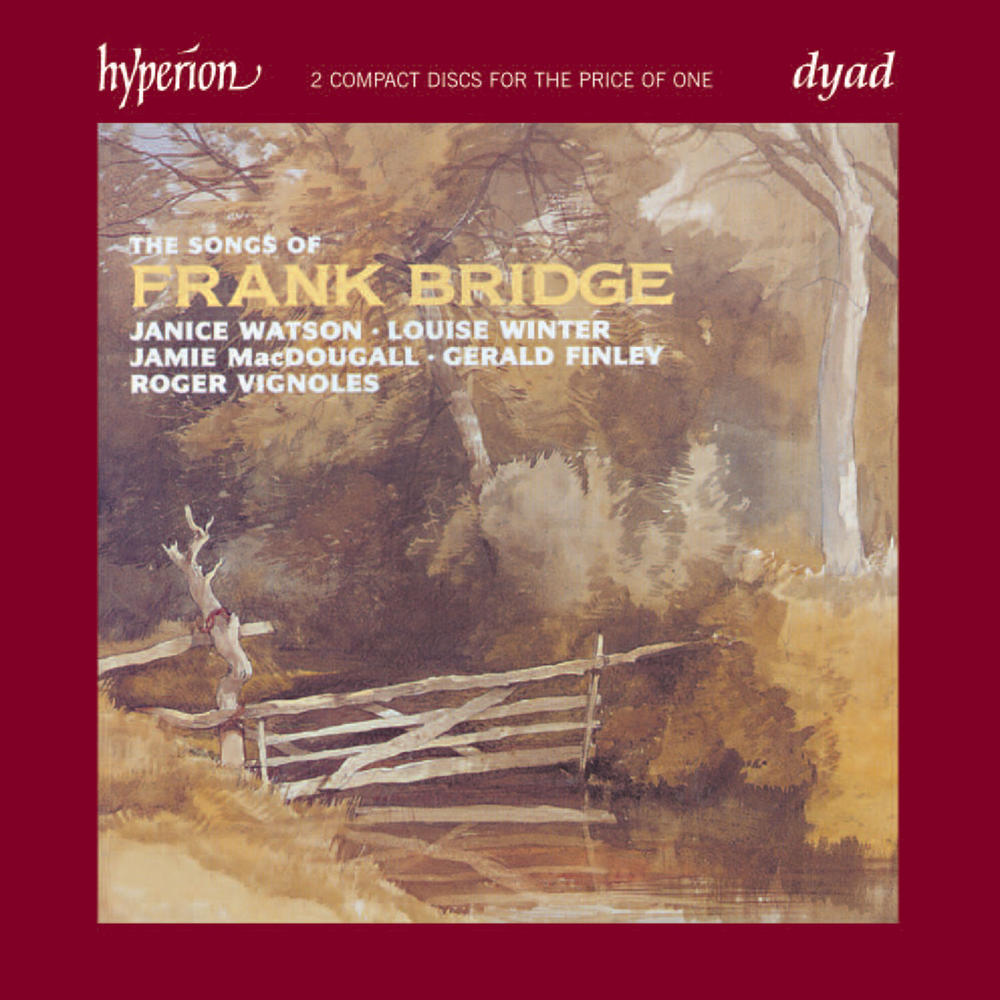Si les mélomanes français connaissent le nom de Frank Bridge (1879-1941), c’est en général parce qu’il fut le professeur de composition de Benjamin Britten. Ne serait-ce qu’à ce titre, sa production mériterait qu’on lui prête une oreille attentive. Mais il y a mieux : longtemps adepte d’une esthétique très traditionnelle, voire rétrograde, Bridge changea radicalement de style après la Première Guerre mondiale et se mit à s’intéresser à l’avant-garde la plus audacieuse. Si vous avez du mal à vous représenter comment Massenet peut se changer en Alban Berg, écoutez ce disque et vous comprendrez.
Les mélodies des années 1900 ne sembleraient pas déplacées dans un de ces music-halls londoniens que peignait Sickert à la même époque : interprété par Gerald Finley, « If I could choose » sonne comme une de ces mélopées par lesquelles les matinee idols envoûtaient les âmes sensibles. Certains songs ont un faux air de chant populaire, chanson de marin ou berceuse. Les Trois mélodies avec alto de 1908 ne sortent pas vraiment du domaine de l’aimable salonnard. Pourtant on en vient très vite aussi à des choses beaucoup plus sérieuses : « A dirge » pose d’emblée un climat infiniment plus dramatique ; « Night lies on the silent highways » explore avec une finesse lugubre une psychologie torturée, sur un texte de Heinrich Heine, poète chez lequel Bridge trouva (en version anglaise) l’inspiration de quelques-unes de ses plus belles mélodies, outre ses Two Heine Songs de 1903. Le très mélancolique Tennyson est lui aussi bien représenté – et mis en musique avec un dépouillement qui arrache « Tears, idle tears » à toute sensiblerie victorienne – ainsi que Shelley, Keats et Coleridge. Dans les années 1920, on voit apparaître Rabindranath Tagore (qui, au même moment, inspirait à Zemlinsky sa Symphonie lyrique), et même James Joyce !
Musicalement, il faut attendre 1918 pour voir timidement poindre la modernité (mais l’on en est déjà à la plage 35 sur les 45 que compte le disque !). Avec les trois compositions sur des textes en vers libres de Tagore (« Day after Day »1922, « Speak to me, my love », 1924, « Dweller in my deathless dreams », 1925), libérées de la tyrannie de la rime, de la strophe et de la scansion, les mélodies se font plus longues, moins prévisibles dans leur déroulement et plus audacieuses dans leurs harmonies. Le pianiste Roger Vignoles y trouve enfin un peu plus de quoi exercer ses grands talents. Couronnement de l’œuvre de Frank Bridge mélodiste : « Journey’s End », ultime composition au titre prédestiné (« Fin du voyage »), avec laquelle on entre réellement dans le XXe siècle, au point même que l’on croirait avoir affaire à un air tiré d’un opéra de Britten.
Des quatre chanteurs réunis il y a près de vingt ans pour cet enregistrement, seul Gerald Finley a pris son envol pour rejoindre le firmament des plus grands. Celle qui était alors son épouse, la mezzo Louise Winter, brillait à cette époque au festival de Glyndebourne, en Sesto dans une Clémence de Titus avec Philip Langridge ou en Eduige d’une mémorable Rodelinda, après quoi on ne l’y verrait plus ; les promesses de ses débuts ne semblent pas s’être tout à fait concrétisées par la suite. Le ténor Jamie MacDougall, nasillard et limité, aurait pu faire carrière dans certains personnages de Britten. Quant à Janice Watson, sa voix était encore fraîche en 1996, loin du vibrato envahissant qu’elle a contracté par la suite à force de rôles lourds, wagnériens notamment (voir compte rendu de A Mass of Life de Delius).