Un soir, un ami amène Gérard Mannoni, en voyage à New York, dans un club de jazz où chante une de ses amies. Voix magnifique et interprétation remarquable suscitent une légitime admiration. « Tu sais, chéri », lui glisse-t-elle à l’oreille, « Ce n’est rien du tout, il faut seulement raconter une histoire ». Ce principe, le critique musical et chorégraphique dit ensuite l’avoir appliqué tout au long de sa carrière, à ses articles dans la presse écrite – Le Quotidien de Paris, Classica, Opéra International, etc. –, à ses interventions radiophoniques, à ses conférences et à ses livres dont Une vie à l’opéra, son dernier ouvrage, recueil de souvenirs et galerie de portraits dont chacun s’efforce justement de narrer plutôt que de dépeindre.
C’est qu’en plus de soixante ans de fréquentation des salles de concert et d’opéra, il en a vu du beau monde, Gérard Mannoni. De 1957, l’année d’un premier Bayreuth où officiait encore Wieland Wagner, entouré d’une armada d’artistes entrés depuis dans la légende – André Cluytens, Birgit Nilsson, Wolfgang Sawallisch, Elisabeth Grümmer, Astrid Varnay, Ramón Vinay… – à nos jours, défile l’essentiel du gotha lyrique (et chorégraphique) : Germaine Lubin, « la Maestra » ; Galina Vichnevskaia qui avec son époux, Vladislav Rostropovich, collectionnait dans un très bel appartement avenue Paul-Doumer à Paris des objets tsaristes ; Renata Tebaldi dont les premiers « Mario ! Mario » chantés dans Tosca à Paris en 1960 étaient « d’une beauté au-delà des possibilités d’une voix humaine » ; Maria Callas applaudie en 1958 lors de ce fameux récital au Palais Garnier, rare témoignage filmé de l’art incomparable de la Divine ; Régine Crespin, fumeuse de petits cigares malodorants ; Luciano Pavarotti dont le tabouret s’effondra sous le poids un soir lors d’une représentation de Tosca à Paris ; Jonas Kaufmann à l’aube de sa gloire, et tant d’autres encore.
Moultes anecdotes sans souci de chronologie composent l’essentiel d’un récit où il est finalement plus question de coulisse que de spectacle. L’art lyrique est aussi – sinon d’abord – art de vivre. De ces figures magnifiques, la mieux croquée n’est pas une diva mais Suzy Lefort, chargée de relations publiques et belle-sœur de Bernard Lefort, femme-panthère excentrique, « resplendissante égérie d’un univers englouti » dont on sent que Gérard Mannoni a l’inévitable nostalgie.
Ah ces dîners d’après-première à l’Espace Cardin où l’« on côtoyait Saint Laurent, Paloma Picasso et quelques autres célébrités », où « journalistes, attachés de presse, artistes constituaient une joyeuse et amicale société ». Nostalgie encore lorsqu’à Aix-en-Provence, des « gradins sans âme » se sont substitués au premier théâtre en bois de l’archevêché et que l’on a détruit Le Roy René, un « vieux palace un peu décadent » où l’auteur avait ses habitudes. Nostalgie pour le lecteur aussi de percevoir la lumière morte d’un monde d’hier dont finalement, en refermant le livre, il ne reste que d’infimes poussières d’étoiles. Abrité derrière ses souvenirs, Gérard Mannoni raconte et oublie de se raconter, tribut du critique musical habitué à s’effacer derrière un art dont il est, lui aussi à sa manière, l’humble serviteur.



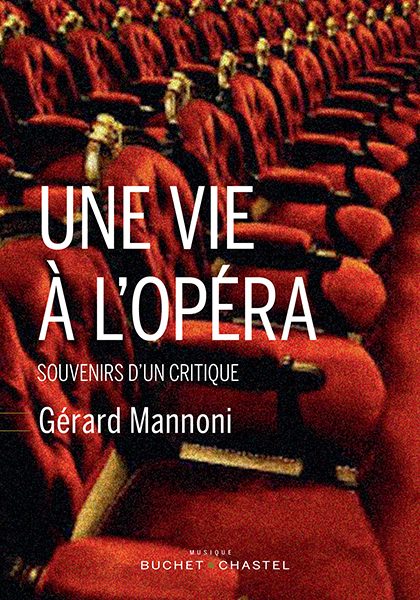
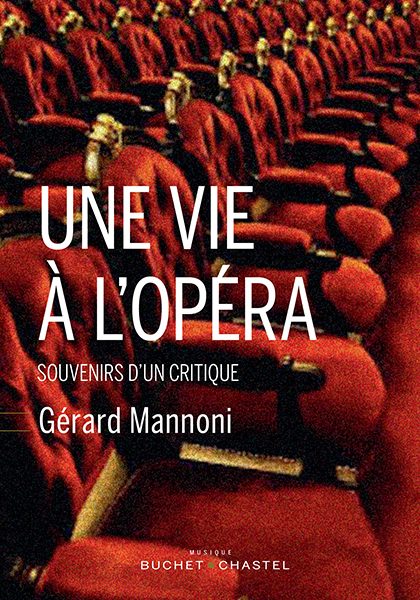






 : Supérieur aux attentes
: Supérieur aux attentes

