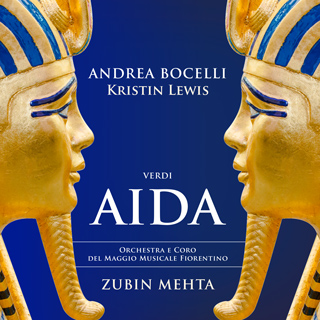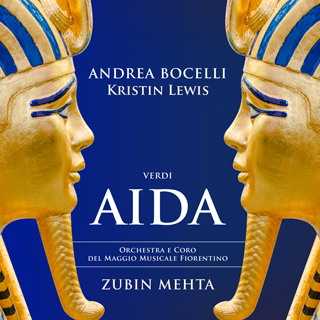Les précédentes incursions d’Andrea Bocelli dans le domaine de l’opéra avaient été saluées dans ces colonnes. Son Calaf de Turandot avait ému, son Des Grieux de Manon Lescaut avait impressionné. Et on avait tiré son chapeau face aux efforts d’une vedette de variété obligeant sa maisons de disque à le programmer dans un répertoire lyrique auquel il a été formé, et dont il se revendique fièrement. Avec cette Aida, on se demande si le ténor n’a pas visé trop haut. Radamès est un rôle lourd, qui requiert de la vaillance, de l’héroïsme et du métal dans la voix. Si Bocelli, flatté par des micros très adroitement placés, pouvait affronter Puccini sans trop s’en faire, il y a chez le Verdi de la maturité une droiture qui ne laisse rien passer en termes de technique. A ce stade de sa carrière, notre sympathique ténor n’est tout simplement plus en mesure de remplir le contrat musical. Le vibrato atteint des proportions catastrophiques, dès les toutes premières mesures – « Celeste Aida » est d’emblée instable. La suite de l’œuvre verra les choses s’aggraver : Bocelli ouvre les sons d’une façon caricaturale, au point que toutes ses voyelles finissent par ressembler à de longs « Aaaaa », s’époumone, semble se battre avec une tessiture qui lui échappe irrémédiablement, se fâche avec la justesse et paraît de plus en plus désemparé. Le tempérament de l’artiste fait qu’il ne déclare jamais forfait, et on sent l’effort mis à se dépasser. Certains admireront cette façon de se consumer en studio, de tout donner. D’autres trouveront ce festival de « malcanto » insupportable.
Trouvera-t-on, dans le reste de la distribution, des motifs de satisfaction plus affirmés ? Hélas, la réponse est plutôt négative. Si le vibrato de Bocelli est problématique, que dire de celui de Kristin Lewis ? L’oscillation autour du son est telle qu’on ne peut plus vraiment parler de note atteinte, mais de note approchée. Là aussi, les choses s’enveniment au fur et à mesure du déroulement de l’action, et l’acte III est un naufrage complet, avec un « O patria mia » qui donne le mal de mer et un duo Radamès/Aida qui ressemble au hululement de deux vieilles chouettes. Le texte parle de « déserts inhospitaliers », et c’est à une bien aride traversée que l’auditeur est convié. Les problèmes techniques de la chanteuse ne sont pas compensés par un quelconque engagement personnel, et la caractérisation du rôle reste proche de zéro. Dans la même veine, le Ramfis de Carlo Colombara offre une voix usée, bougonnante, à l’émission comme encombrée. Le volume peut parfois impressionner, mais tout cela reste terriblement fruste, poussif et presque hurlé. Face à une telle suite de déceptions, on attend comme une rédemption l’apparition d’Amonasro, au II. C’est qu’Ambrogio Maestri est un baryton à la technique éprouvée, qui a su donner du style à tous les rôles qu’il abordait. Hélas, il semble subir la mauvaise influence du reste du plateau : son Roi d’Ethiopie est constamment forcé, chanté sans aucune nuance, et ressemble à un méchant de cinéma.
Tout est-il donc à jeter dans cette nouvelle Aida ? Non pas. Il y a d’abord l’Amnéris très correcte de Veronica Simeoni. Son chant droit, sans affectation est une jouvence après tant d’errements. Toutes les embûches du rôle sont affrontées sans trembler, sans chercher à gonfler la voix ou à en rajouter dans un vérisme hors de propos. Tout cela est bel et bon, mais on ne trouvera dans cette honnête incarnation rien qui sorte du lot, qui dépasse la bonne routine des scènes italiennes de qualité. Pour trouver ce « je-ne-sais-quoi » qui différencie les honnêtes interprètes des génies, il faudra écouter le Roi de Giorgio Giuseppini qui offrira à pleine main le luxe le plus somptuaire, avec un timbre de bronze, qui s’impose sans chercher à en faire trop, une noblesse de ton et un style dans la déclamation qui le hissent à des années-lumière au dessus du reste du plateau. Mais qui achètera une Aida pour son Roi ?
Reste à aborder la question de la direction d’orchestre. Les amateurs de Verdi savent que, dans ce répertoire, Zubin Mehta est capable du meilleur comme du pire. Il est ici dans un bon jour, tirant de l’Orchestre du Mai musical florentin une énergie dramatique du plus bel effet. Cela tonne, claque et rutile avec allure (et le concours d’un chœur très investi), mais l’exercice atteint vite ses limites : on est impressionné davantage que touché, et rien de tout cela n’émeut. De plus, le déséquilibre avec les insuffisances du plateau devient vite gênant. La scène du triomphe signe un contresens total, avec des solistes qui s’égosillent et un orchestre qui semble faire de la musculation. Tout cela finit par faire très « barnum », ce qui est une injustice faite à l’œuvre. Le discophile reviendra donc bien vite à sa version Solti mainte fois rééditée chez Decca, et à Pappano, chez Warner. Les cinquante ans qui séparent ces deux références sont jonchés d’Aidas ratées (Abbado, Maazel, Levine, Harnoncourt, …), que cette nouvelle parution va rejoindre dans leur prestigieux cimetière.