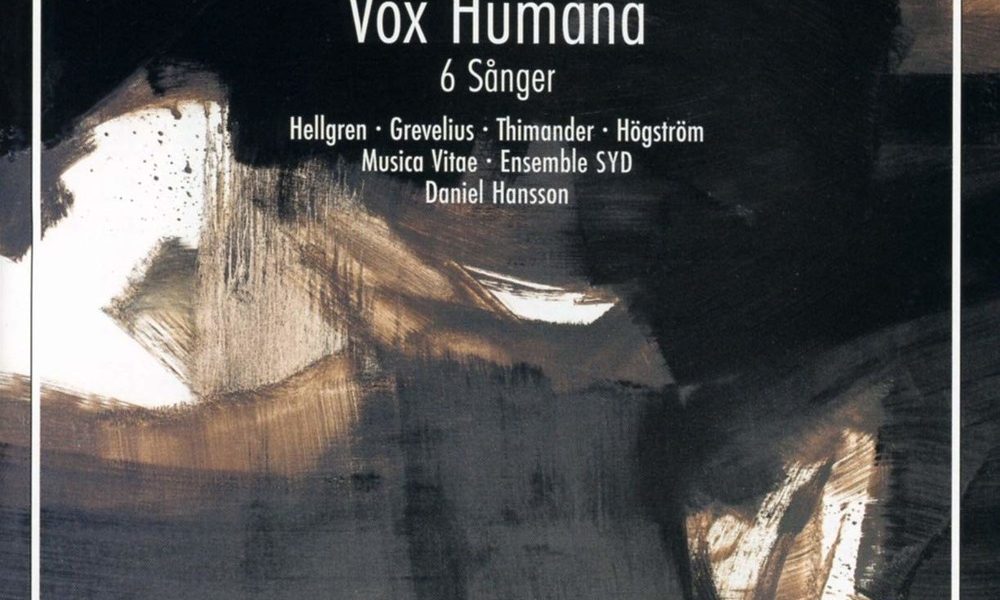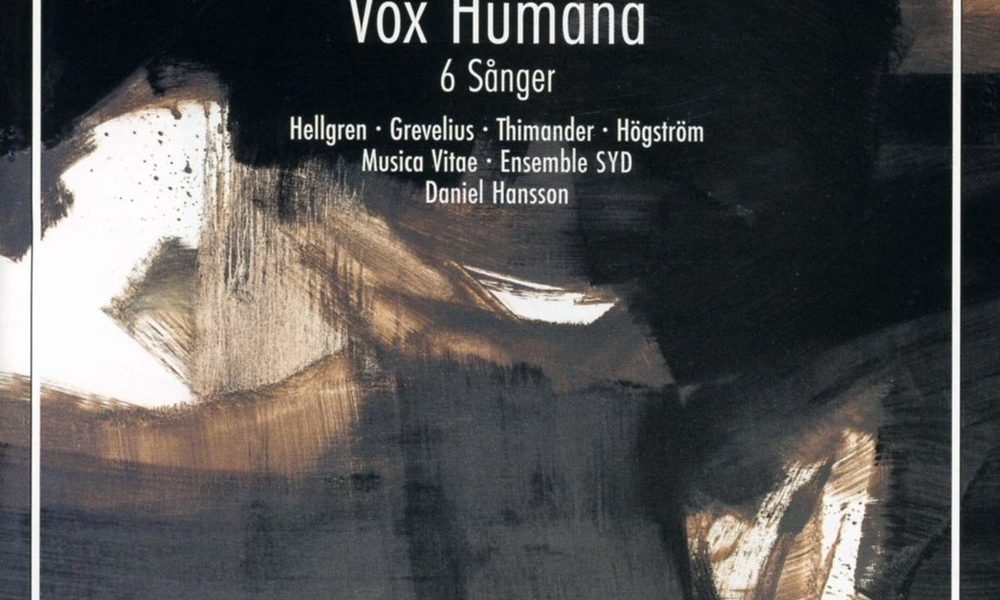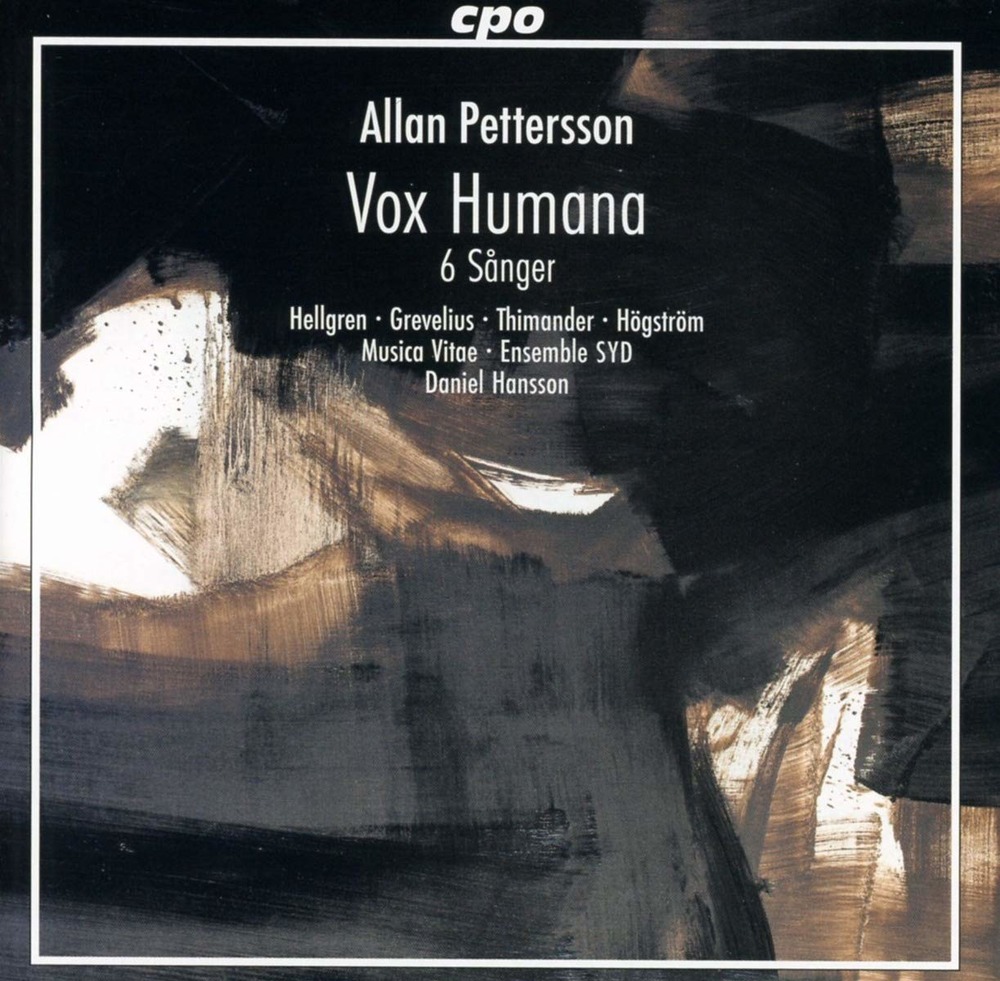Pourquoi certains compositeurs du XXe siècle n’ont-ils jamais atteint la renommée qui aurait pu être la leur ? Pourquoi, en musique comme pour d’autres arts, l’histoire s’est-elle écrite selon des critères étroits ou partiaux ? En dehors d’un petit cercle d’admirateurs, le nom de Gustav Allan Pettersson (1911-1980) est à peu près inconnu. Cet altiste suédois semble avoir eu un parcours semé d’embûches : après une enfance douloureuse, il commença à composer une décennie avant la Deuxième Guerre mondiale, puis vint à Paris à l’aube des années 1950 étudier auprès d’Arthur Honegger et de René Leibowitz. Frappé à quarante ans par la polyarthrite, il eut la triste surprise d’apprendre en 1975 que, suite à un désaccord artistique, sa musique était « définitivement » exclue du répertoire du Stockholm Philharmonic, orchestre dans lequel il avait travaillé de 1939 à 1952.
Si son catalogue compte surtout des œuvres orchestrales, dont seize symphonies plus une laissée inachevée, il inclut aussi deux cycles de mélodies et surtout une grande cantate qui est le morceau de résistance du disque publié par le label CPO.
Si les Six Lieder de jeunesse de 1935 risquent de peiner à retenir l’attention de l’auditeur, car on n’y entend pas encore une personnalité véritablement affirmée, l’écoute de Vox Humana ne laissera probablement pas indifférent. Datant de 1974, on y distingue au contraire une voix personnelle, résolument opposée à la modernité atonale, mais non passéiste. Cette cantate d’une cinquantaine de minutes, pour quatre solistes, chœur et orchestre, est constituée de dix-huit chants répartis en trois groupes. Reflet de certaines utopies sociales typiques des années 1970, les quatorze chants de la première partie (37 minutes) sont composés sur des textes écrits par des travailleurs sud-américains – et traduits en suédois ; ils reflètent l’humeur d’un moment, expriment des doléances relatives aux inégalités du quotidien, s’inspirent de faits divers évoqués dans les journaux, ou prennent un tour plus politique, comme le poème n° 12, intitulé « Che »… La deuxième partie (4 minutes) réunit trois chants « d’après l’ancienne poésie indienne », trois textes évoquant la mort, dont un très macabre « Jugement sur un traître » où l’on boit dans le crâne du coupable et où l’on porte un collier fabriqué avec ses dents. Retour à l’Amérique latin pour la dernière partie, composée d’un seul poème de Pablo Neruda (10 minutes).
Indépendamment de la qualité et du contenu de ces textes, force est de reconnaître que Pettersson écrivait admirablement pour les voix. On est d’emblée envoûté par la manière dont il savait mettre en valeur les chanteurs, avec notamment une écriture chorale particulièrement efficace, les lignes vocales s’entrelaçant avec force et élégance, a cappella ou par-dessus des lignes instrumentales tantôt incisives, tantôt sinueuses, en une polyphonie très dense. Les solistes alternent, le chœur intervient parfois seul, les styles varient pour éviter toute monotonie.
Le privilège de prendre l’auditeur par la main pour entrer dans l’œuvre revient à la mezzo Anna Grevelius, Chérubin de la dernière reprise de la production Strehler des Noces de Figaro à Bastille, Annio à Bruxelles, Elvire à Rouen, Zerline au TCE : son timbre chaud caresse l’oreille. Pour le dernier chant de la première partie, elle s’exprime en duo avec le baryton Jakob Högström, à la voix particulièrement porteuse d’émotion. Moins sollicités (à raison de deux plages chacun contre quatre pour leurs camarades), le ténor Conny Thimander a toute la délicatesse souhaitable, tandis que la soprano Kristina Hellgren distille des aigus impalpables. Indispensable protagoniste, les chanteurs de l’Ensemble SYD fascinent eux aussi par la précision de leurs interventions et par la transparence aérienne qu’ils conservent dans l’enchevêtrement des voix. Dirigeant le chœur et l’orchestre à cordes Musica Vitae, le chef Daniel Hansson sait éviter tout pathos superflu dans cette partition à laquelle on souhaite la plus large dfifusion.