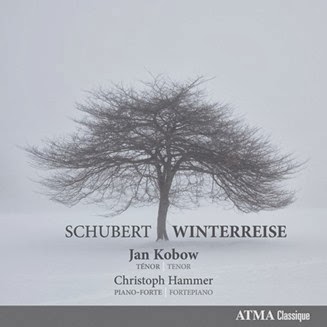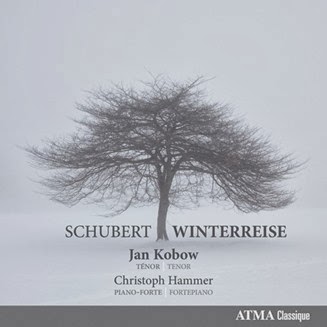Rares sont les œuvres qui ont autant suscité de lectures différentes, parfois radicalement opposées. Lorsqu’il écrit Winterreise, au sommet de sa puissance créatrice, Schubert n’a pas 32 ans. Son épanouissement est manifeste, ses créations plus importantes que jamais, les soirées joyeuses fréquentes, les projets nombreux. Et les ennuis de santé apparus en septembre 1828, ne s’aggravent qu’en novembre alors qu’il a écrit la plupart des lieder du cycle. Aussi, leur lecture sombre, désespérée n’a-t-elle d’autre fondement objectif que les poèmes de Wilhelm Müller. Suite de la Belle meunière, du même poète ? Beaucoup le soutiennent, et l’écoute de « Frühlingstraum », par exemple, l’accrédite. Loin des versions sombres, pessimistes, le plus souvent confiées à des barytons, voire à des basses, Jan Kobow, familier des répertoires baroques comme du lied germanique (dont il a déjà gravé plusieurs CD), ose ici une interprétation qui ne peut laisser indifférent. Dynamique, non exempte de gravité, fraîche, quasi juvénile, spontanée, c’est l’élan qui la caractérise : les tempi sont souvent assez rapides (vingt minutes de moins que Vickers !). Une pierre de choix, remarquablement taillée, à l’édification du temple schubertien.
Dès le « Gute Nacht », la marche avance, résolue, dépourvue de l’accablement traditionnel, poursuite manifeste de l’histoire narrée dans Die schöne Müllerin. La conduite et les inflexions de la voix de Jan Kobow sont exemplaires, une sensibilité totalement dépourvue de la moindre affectation. Son legato et son articulation sont au service du texte, de la narration comme de la confidence. La fluidité, la limpidité et le naturel caractérisent son chant. La voix est fraîche, légère, égale dans tous les registres, et le sens dramatique constant. Le splendide piano-forte de Christoph Hammer (instrument viennois des années 1810) est accordé selon les pratiques du temps, et l’inégalité donne aux tons éloignés une couleur singulière. Il sonne superbement, ici avec des graves charnus (« Der Lindenbaum », les batteries de « Einsamkeit »), là avec nervosité et tension (la fuite de la ville, et du passé obsédant de « Rückblick »). Chaque lied mériterait un commentaire : malgré la familiarité que l’on a de l’œuvre, la redécouverte est permanente. « Die Post » est d’une vérité stupéfiante: le cœur bat la chamade au rythme des chevaux, piano nerveux, juvénile, ô combien expressif. Le vol tournoyant de la corneille (« Die Krähe ») est superbement rendu, et la longue phrase chantée, dans son apparente simplicité, suscite une émotion profonde. « Der Wegweiser » s’inscrit aussi dans la continuité des deux cycles. La démarche est la même que dans le premier lied, la gravité et la lassitude en plus. On s’achemine vers la fin de la route. « Die Nebensonnen », énigmatique, lent récitatif fantomatique. Et l’ultime « Leiermann », sobre jusqu’à l’épuisement, rengaine au bourdon hypnotique, marque le dépouillement final.