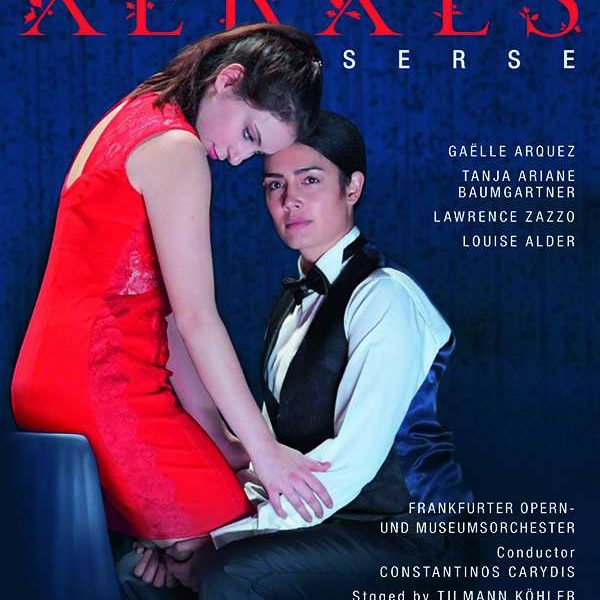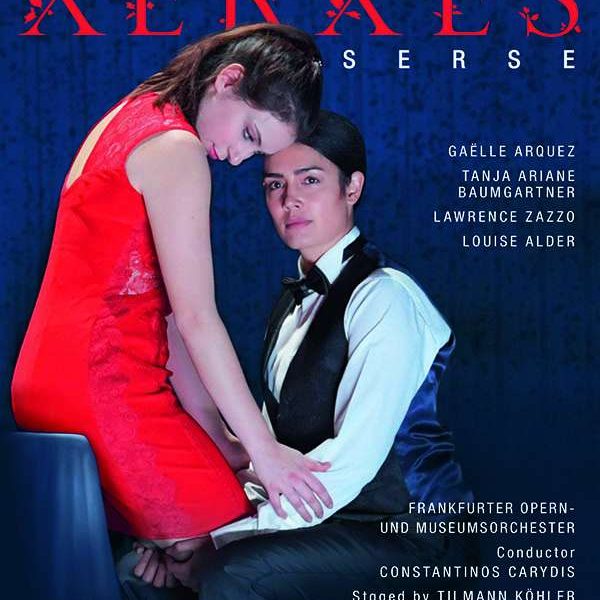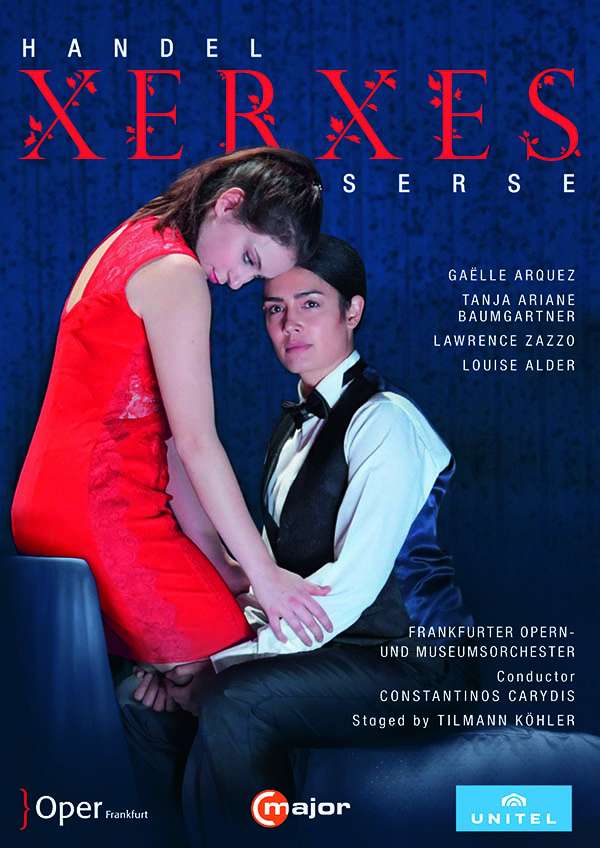Evidemment, il faudrait être bien naïf pour croire que Serse est un document historique sur l’empire perse en 480 avant notre ère. Le livret déjà vieux de près d’un siècle sur lequel Haendel composa en 1738 l’un de ses derniers opéras est avant tout une série d’amours contrariées, sur un ton badin qui n’a guère à partager avec Eschyle ou Hérodote. Autrement dit, la transposition vers un lieu ou une époque quelconque ne pose aucun problème. Encore faut-il qu’elle ait un sens, qu’elle aide à suivre l’intrigue et à comprendre les personnages. Avec la production présentée en janvier 2017, l’opéra de Francfort ne remplit pas tout à fait ces conditions. Toute la première partie du spectacle – soit les deux premiers actes donnés sans solution de continuité – se déroule autour d’une vaste table de banquet ; les protagonistes en tenue élégante s’y assoient, montent dessus, ou en font le tour. Les aliments disposés sur la nappe sont victimes de leur humeur : Arsamène, puis Xerxès écrasent des agrumes dans leurs poings pour traduire leur colère, Atalanta répand sel, poivre et spaghettis pour se calmer les nerfs. Mais ce meuble s’avère surtout encombrant et sans grand intérêt – il disparaît après l’entracte, et il ne reste plus que les chaises éparses –, et l’on pourrait imaginer bien des opéras montés avec un semblable décor (cela a d’ailleurs souvent été fait, surtout en Allemagne). Donc, un résultat assez passe-partout, qui réduit l’œuvre à une suite de chamailleries dans le grand monde, entre des gens dont on ne sait pas trop qui ils sont, avec Ariodate-Cupidon descendu des cintres et Xerxès au bord du suicide quand tombe le rideau final. Encore un DVD pour rien, où les images semblent bien vaines, alors qu’un CD aurait suffi.
Et le CD n’aurait pas été mauvais, la distribution réunie à Francfort méritant qu’on y prête attention. On sait qu’à défaut de toujours trouver en France les rôles qu’elle mérite, notre compatriote Gaëlle Arquez fait outre-Rhin une belle carrière. Xerxès convient bien à la souplesse cette voix formée au baroque et devenue mezzo après des débuts de soprano. En Arsamène, Lawrence Zazzo trouve un personnage haendélien beaucoup plus adapté à son tempérament que le Jules César qu’il persiste à vouloir incarner ici et là : par les couleurs et la délicatesse de son chant, le contre-ténor américain semble plus fait pour les héros malheureux que pour les conquérants. Curieusement, le boîtier du DVD met en avant quatre chanteurs parmi lesquels ne figure pas la titulaire du rôle de Romilda, qui devrait pourtant être la prima donna : est-ce parce que Elizabeth Sutphen est une artiste en troupe à Francfort, où elle interprète régulièrement de petits rôles (elle fut pourtant, à Glyndebourne l’été dernier, Sophie du Chevalier à la rose) ? La voix est agile et légère, mais sans personnalité encore très affirmée, alors que l’Atalanta de Louise Alder, également en troupe à Francfort, brûle les planches et marque les esprits par une incarnation déchaînée, notamment dans la virtuosité de l’air qui conclut le premier acte. Par un curieux hasard, cet été à Glyndebourne, les deux sopranos incarnaient en alternance Sophie du Rosenkavalier, et lors de la reprise de ce Serse à Francfort en janvier prochain, elles échangeront leurs rôles, ce qui confèrera sans doute à Romilda le relief dont elle manquait un peu quand fut créée cette production. L’Amastre enflammée de Tanja Ariane Baumgartner mérite de figurer juste après Gaëlle Arquez sur le boîtier : très appréciée dans Les Bassarides de Henze à Salzbourg l’été dernier ou dans Le Château de Barbe-Bleue à Toulouse en 2015, la mezzo est aussi parfaitement capable de plier son instrument à la discipline baroque. Les deux basses de Serse jouent plus que jamais les utilités, car la mise en scène ne s’intéresse guère à eux : Elviro peu comique de Thomas Faulkner et Ariodate physiquement trop jeune de Brandon Cedel.
Chef polyvalent, Constantinos Carydis se montre assez convaincant à la tête d’un orchestre moderne heureusement complété par les indispensables clavecins et luth. Les tempos semblent ici et là un peu trop sages, mais on remarque quelques choix instrumentaux qui viennent judicieusement colorer le discours, notamment dans l’air d’Atalanta, « Dirà che amor per me ».