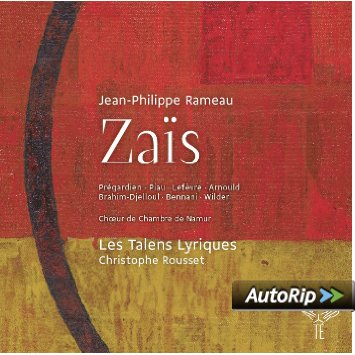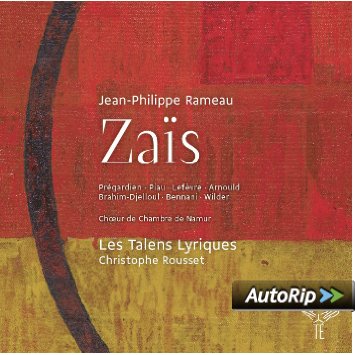Avec le recul, loin de l’exaltation où des Talens lyriques survoltés nous avaient plongé, un soir d’été, il nous faut quelque peu déchanter : Zaïs n’est pas un chef-d’œuvre – inconnu ou méconnu – pas plus d’ailleurs que Les Fêtes de l’Hymen et de l’Amour ressuscitées par Hervé Niquet à l’occasion du deux cent cinquantième anniversaire de la mort de Rameau. En vérité, le disque surexpose le déficit dramatique d’un livret dont le compositeur ne réussit pas, sinon fugacement, à transcender la médiocrité ; à l’impossible, nul n’est tenu, pas même un musicien aussi doué que le Dijonnais.
Dans la notice qui accompagne cette parution, Graham Sadler a beau éluder le problème et se focaliser sur la symbolique maçonnique qui émaille l’ouvrage, il n’en reste pas moins que Cahusac néglige « l’importance de l’épaisseur psychologique des personnages », observe Sylvie Bouissou dans l’imposant volume qu’elle vient de consacrer à Rameau (Fayard), et « ce qui fait le suspense d’une action, c’est-à-dire la mise en danger des héros ». Les épreuves que le roi des Sylphes, Zaïs, inflige avec une délectation sadique à la bergère Zélidie, amoureuse mélancolique et championne de la constance (« Jugez si je l’aimais, je l’adore infidèle » !), peinent à éveiller l’intérêt de l’auditeur. Passé le choc de l’ouverture qui peint le débrouillement du chaos primordial, seule page régulièrement jouée de nos jours et dont la modernité, la force d’évocation n’ont de cesse d’éblouir, le prologue s’enlise et l’invention musicale, inégale, n’atteindra plus jamais de telles cimes. Zaïs, dont nous découvrons ici la première gravure réellement exhaustive, aligne quelques joliesses – des danses, en particulier celles du Ballet des Plaisirs (prologue), des numéros solistes (« Règne amour lance tes traits », IV, 4) ou des ensembles (l’onirique « Descends des cieux dieu de nos âmes », I, 4 ) –, mais ces grâces éparses et fugitives ne peuvent suppléer les carences d’une trame inconsistante où sont réduits à peau de chagrin « les événements spectaculaires qui pourraient permettre à Rameau de développer son génie symphonique » note encore Sylvie Bouissou.
L’émergence, au coeur de cette oeuvre de demi-caractère, d’une figure presque tragique ne laisse pas d’étonner. Si son timbre a perdu de sa fraîcheur et cette lumière que nous prisions tant hier, par exemple dans Les Fêtes de Paphos de Mondonville, Sandrine Piau exalte l’ardeur et la noblesse de Zélidie avec une économie de moyens exemplaire (« Coulez mes pleurs », III, 2). La chanteuse partage avec le fondateur des Talens lyriques cette compréhension intime de la rhétorique ramiste qui, en revanche, échappait totalement à Gustav Leonhardt, artisan scrupuleux d’une exhumation où Zaïs demeurait, hélas, figée dans l’ambre. Bien sûr, les tempi de Christophe Rousset ne feront pas l’unanimité et sa direction paraîtra quelquefois excessivement nerveuse, mais elle se révèle d’une précision imparable et le chef imprime à l’ouvrage un élan, une motricité salutaires. En outre et n’en déplaise à ses détracteurs, il sait troquer la pointe sèche contre la tendresse du pastel, la finesse des coloris le disputant à celle du trait. A Versailles, où le disque fut enregistré, comme à Beaune quelques mois plus tôt, la performance, éminemment virtuose, des Talens lyriques, s’avère de bout en bout électrisante et constitue l’autre atout de cette version.
La Zélidie farouche et déterminée de Sandrine Piau offre un contraste pour le moins singulier avec le Zaïs frêle et doucereux de Julien Prégardien, qui sous chante et dont la voix semble constamment sur le point de se briser ou de s’évaporer, affadissant un personnage qui n’a vraiment pas besoin de ça. Amaury Lefèvre succède fort heureusement à Konstantin Wolff, souvenir douloureux et point noir de la distribution beaunoise, conférant à Oromazès la plénitude et la majesté, sans pesanteur, qui siéent au roi des génies. Benoît Arnould sonne un peu court (« Aquilons rompez votre chaîne ! », II, 4) et ne possède pas les ressources nécessaires pour embrasser la diversité des intentions qui nourrissent le rôle, ambigu et retors, de Cindor. Même s’il ne prend que timidement son envol, l’Amour de Haasna Bennani a du charme à revendre et le Sylphe de Zachary Wilder affronte avec une assurance renouvelée l’air le plus difficile de cette pastorale (« Dans nos feux prenons pour modèle », III, 4), éclipsant les aigreurs de René Jacobs livré à lui-même chez Leonhardt. L’excellent Choeur de Chambre de Namur tire son épingle du jeu dans les trop rares passages qui le sollicitent et comptent parmi les plus aboutis de la partition (« Unissez vos chants », l’air avec choeur en rondeau de la Grande Prêtresse, I, 4 ou celui de Cindor, déjà cité, « Aquillons rompez votre chaîne », brillant et puissamment expressif). Indisponible, le premier enregistrement de Zaïs souffre irrémédiablement de la comparaison avec cette véritable intégrale, certes perfectible, mais autrement recommandable.