Si Palestrina est une œuvre relativement austère, au moins par son sujet, il est regrettable qu’aux yeux de la postérité, Hans Pfitzner se réduise à cette seule facette. Il y a donc tout lieu de se réjouir que le label Capriccio publie enfin un enregistrement de sa deuxième œuvre lyrique, La Rose du jardin d’amour, réalisé en 2009, dans la foulée des représentations donnée à l’Opéra de Chemnitz. Pourquoi a-t-il fallu attendre près de dix ans pour que cette intégrale soit commercialisée ? Mystère, mais l’essentiel est que le résultat soit là.
Bien qu’assez rarement programmé, même en terres germaniques, Die Rose vom Liebesgarten n’a jamais tout à fait quitté l’affiche. Créé au tout début du XXe siècle dans ce qui est aujourd’hui Wuppertal, l’opéra fut très bien accueilli à Vienne en 1905 ; Pfitzner lui-même le dirigea à Strasbourg lorsqu’il fut placé à la tête de l’opéra et du conservatoire de cette ville. Après la guerre, on en recense notamment une interprétation en 1950, avec Wolfgang Windgassen dans le rôle-titre, personnage que Francisco Araiza campa en 1998 à l’Opéra de Zurich.
Pourquoi cette relative désaffection ? Le livret y est sûrement pour quelque chose. James Grun, condisciple de Pfitzner, l’élabora à partir d’une œuvre de Hans Thoma, peintre symboliste allemand qui, par les sujets qu’il traitait, apparaît un peu comme un sous-Böcklin, avec sirènes, harpies et autoportrait au squelette (le Musée d’Orsay possède de lui une Siesta, et l’on recommande une visite au musée de Karlsruhe pour admirer les panneaux formant son incroyable Chapelle). Symbolisme, le mot est lâché, mais n’est pas Maeterlinck qui veut, et le livret de Grun est surchargé de tableaux plus ou moins vivants, avec un prologue qui représente un tiers de la durée totale de l’œuvre ! Trop de paroles et pas assez d’action, et l’on ose à peine parler d’intrigue devant cette resucée de Parsifal où le beau chevalier Siegnot (!) s’éprend de Minneleide qu’il tente de ramener au pays du printemps. Capturé en même temps qu’elle par le Sorcier de la Nuit, Siegnot invoque la déesse de l’amour pour faire s’écrouler le royaume souterrain du sorcier…
Revisitée par un metteur en scène particulièrement ingénieux, cette histoire aurait peut-être des chances de fonctionner au théâtre. Au disque, l’essentiel est que la musique soit d’une belle hauteur d’inspiration, avec notamment de superbes moments orchestraux, d’une somptuosité toute post-wagnérienne que traduit fort bien la Robert-Schumann-Philharmonie dirigée par Franck Beermann, chef habitué aux raretés de toutes sortes, comme les opéras de Schreker, dans un univers esthétique assez proche.
Quant à la distribution, elle repose sur au moins un interprète tout à fait à sa place : le ténor Erin Caves. Si des prestations récentes ont fait apparaître des problèmes techniques, peut-être liés à la soudaine fréquentation de rôles lourds comme Tristan, cela ne s’entendait pas encore en 2008, et son Siegnot séduit dans les grands monologues que Pfitzner destine à son héros. La voix semblait alors de belle étoffe, et aux dimensions requises pour un rôle assez wagnérien. A ses côtés, la Minneleide d’Astrid Weber affronte vaillamment une partition exigeante, mais le timbre n’est guère plaisant, et l’aigu a quelque chose de désagréablement tranchant qui rend le personnage encore plus antipathique que ne le prévoyait le livret. Quant au troisième pilier, Kouta Räsänen, il a en fait beaucoup moins à chanter que les deux autres, et on ne peut guère lui reprocher qu’une voix pas tout à fait aussi terrifiante qu’on pourrait s’y attendre. Autour d’eux, on signalera surtout le baryton Andreas Kindschuh, qui livre une fort belle prestation dans le prologue. Et il faut souligner la qualité des chœurs de l’Opéra de Chemnitz, qui rend possible une telle entreprise : bien peu de maisons d’opéra de nos régions françaises seraient capable de mener à bien une entreprise aussi lourde que la résurrection d’une œuvre aussi ambitieuse.


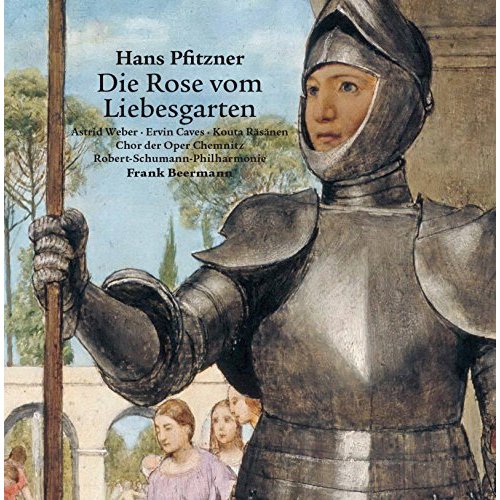
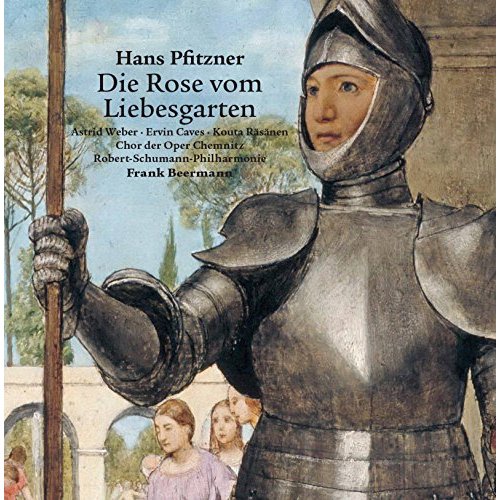


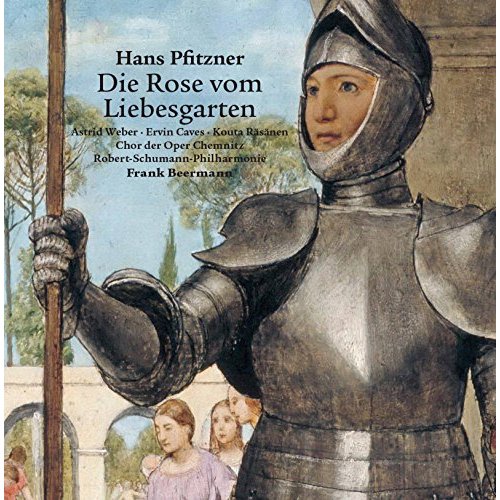

 : Supérieur aux attentes
: Supérieur aux attentes



