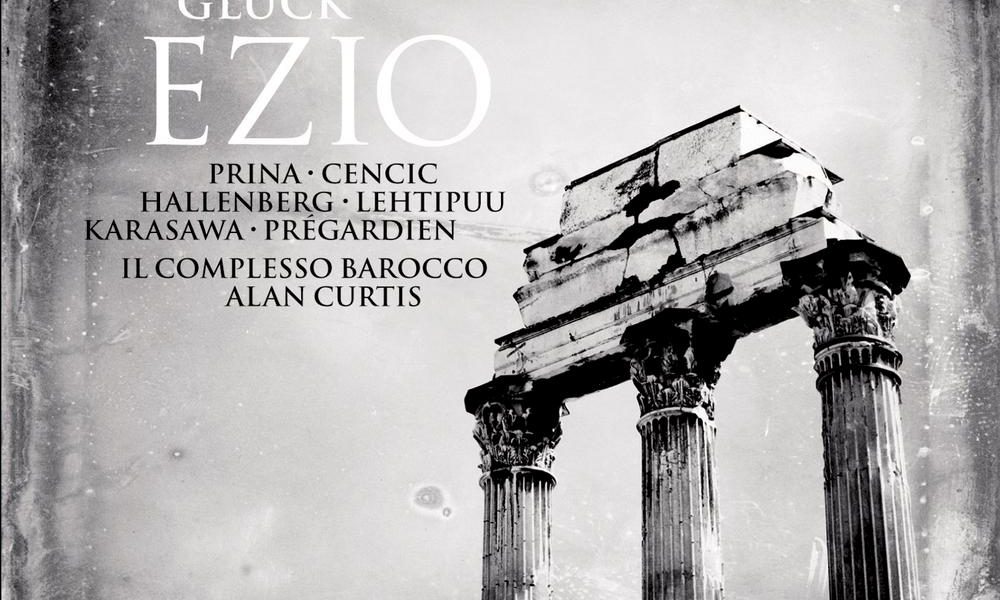A ceux qui ne verraient en Christoph Willibald Gluck que l’artisan d’une des réformes les plus célèbres de l’opéra, cet enregistrement d’Ezio, un dramma per musica composé en 1750, apporte un démenti catégorique. Douze ans avant Orfeo e Euridice, qui mettra les pendules à la nouvelle heure, le compositeur allemand sacrifiait comme ses contemporains aux rites de l’opéra seria. Le livret d’Ezio est d’ailleurs signé de Métastase, féroce partisan du drame musical à l’ancienne, que l’on oppose souvent à Calzabigi, le librettiste d’Orfeo, attaché davantage à la recherche de vérité théâtrale.
Il existe pourtant au moins un point commun entre les deux œuvres : le sublime arioso d’Orphée « Che puro ciel » provient d’Ezio où comble de l’ironie, il est interprété par le méchant de l’histoire : Massimo. D’un timbre dont on connait l’amertume Topi Lehtipuu sait comme nul autre verser le fiel sur cette musique qui ailleurs exprime la félicité céleste. Un air de fureur (« Va’ dal furor portata ») et l’agitation du terzetto (« Passami il cor tiranno ») à l’acte suivant offrent au ténor l’occasion d’exposer une autre facette de son art : l’agilité, le mordant, tout ce qui ajouté à cette douceur saumâtre dont « Se povero il ruscello » apportait la preuve, compose un chant immédiatement identifiable, égal et habité, qui dans ce répertoire se pose aujourd’hui en référence.
Ce terzetto d’une durée notable (plus de 7 minutes), où l’on sent déjà poindre la griffe placentaire de Mozart, n’est qu’un joyau parmi d’autres au sein d’une partition ruisselante : airs contrastées qui balayent d’une écriture inspirée la palette des sentiments, mélodies plaisantes, orchestration recherchée, le tout sur un des livrets les moins manichéens de Metastase. Massimo veut se venger de l’Empereur Valentiniano en instrumentalisant l’amour que sa fille Fulvia porte au général Ezio, celui-là même qui barytonne dans l’Attila de Verdi.
Ecrit à l’origine pour un castrat (Nicola Reginelli), le rôle est crânement interprété ici par Sonia Prina dont le contralto n’aime rien tant que rouler des mécaniques. Timbre profond d’une rondeur rassurante et virtuosité à toute épreuve (il en faut pour venir à bout du « Se fedele mi brama il regnante », un air de fureur hérissé de vocalises), l’énergie de la chanteuse tranche avec le tempérament paradoxalement moins viril de Max-Emmanuel Cencic. En Valentiano, le contre-ténor a pourtant droit lui aussi aux montagnes russes et ce dès son aria di sortita, un « Se tu la reggi al volo » qu’il saisit à bras le corps d’une voix dont apprécie autant le naturel que l’agilité. Un peu plus loin, la partition dépose à ses pieds un bouquet d’airs, dont l’inquiet « dubbioso amante », qui souligne davantage la capacité à exprimer et à émouvoir.
Troisième voix médiane de l’affiche, Ann Hallenberg, encore plus investie que ses partenaires, livre ici un témoignage absolu de son art. Un seul numéro suffit pour faire de Fulvia une des grandes héroïnes de l’opéra, ce « Ah non son io che parlo » que Cecilia Bartoli s’est empressée d’inscrire au programme de son album Gluck. La mezzo-soprano suédoise, d’un timbre plus substantiel que celui de sa consœur, montre un même sens des couleurs et un même à-propos dans l’ornementation. Ebloui par ce tour de force, comme l’œil est aveuglé par le soleil, on en perdrait presque de vue ses autres interventions. Le « Finché un zeffiro soave », par exemple, encore plus redoutable vocalement et tout aussi mémorable par la façon dont, sur un balancement agité, il oblige le chant à explorer toutes les humeurs et toutes les figures imaginables. Rien cependant d’impossible pour Ann Hallengerg qui là encore affirme sa supériorité.
En arrière plan, le soprano de Mayuko Karasawa est suffisamment nourri pour donner du relief au personnage d’Onoria et Julien Prégardien (le fils de Christoph) fait montre en Varo d’un talent prometteur.
Autant l’affiche inspirait peu de crainte, ce que l’écoute confirme au-delà de toutes espérances, autant on ne donnait pas forcément cher de la direction d’Alan Curtis, auquel on doit déjà, au disque et en concert, plusieurs accès de narcolepsie. Pourtant, sans faire d’étincelles, le chef d’orchestre se réalise davantage avec Gluck qu’avec Haendel et son Complesso Barocco n’en parait que plus épanoui. Question de caractère sans doute, le Palatin, en ses jeunes années, est moins tortueux que le Saxon. En ce sens le choix de la version de 1750 est bienvenu. Pas sûr que la partition de 1763 réécrite par Gluck pour le Burgtheater de Vienne, avec ses ajouts de flûtes, de trompettes et de claviers, serait aussi bien convenue au tempérament pacifique d’Alan Curtis. Mais ici, tout est en place et fonctionne plutôt bien. La distribution aidant, parions qu’il faudra même attendre longtemps avant de trouver mieux.