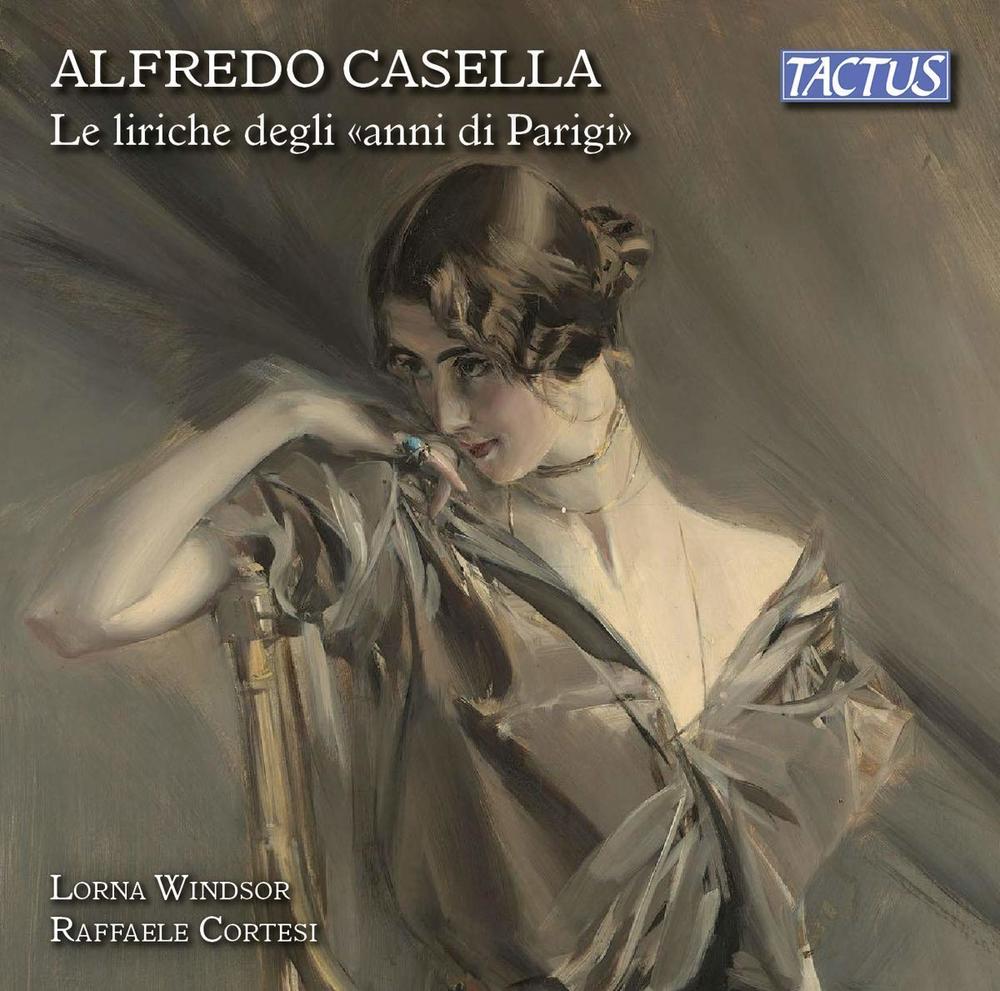L’an dernier, la Fenice a commémoré les 70 ans écoulés depuis le décès d’Alfredo Casella en mettant à l’affiche son opéra de chambre La favola d’Orfeo. A part Venise, d’autres villes de la péninsule avaient pris les devants en coproduisant son opéra La donna serpente d’après Carlo Gozzi (1932), seule œuvre scénique de grande ampleur, à l’exception des divers ballets que conçut le compositeur italien : Martina Franca en 2014, puis Turin en 2016. S’est-il écoulé assez de temps pour que l’on surmonte les réticences que suscite l’adhésion de Casella au fascisme ? Au moins peut-on s’efforcer de prêter à sa musique une oreille attentive, d’autant que le jeune Alfredo séjourna à Paris pendant tout le début de sa carrière : envoyé en France en 1896, alors qu’il n’avait que 13 ans, il étudia la composition auprès de Gabriel Fauré et eut pour condisciples Georges Enesco et Maurice Ravel. Il devait rester à Paris jusqu’à l’éclatement de la Première Guerre mondiale, et la musique qu’il produisit durant toute cette période montre combien il était sensible aux différentes tendances alors représentées en Europe. Pour un jeune Italien soucieux de composer des mélodies en français, sur les poètes alors à la mode – Jean Richepin, Albert Samain, Jean Lorrain, plus une incursion chez Verlaine et une autre chez Baudelaire – difficile de faire l’impasse sur Debussy, dont l’influence est ici incontestable.
Entre 1902 et 1915 se situent toutes les œuvres enregistrées sur le disque que fait paraître le label italien Tactus, et c’est durant cette période que Casella trouve peu à peu une voix personnelle. L’écriture pianistique est d’emblée remarquable – le compositeur se fera d’ailleurs comme soliste de concert de réputation internationale – et la mélodie « Nuageries » qui conclut le recueil Cinq Lyriques se révèle particulièrement frappante de ce point de vue, avec ses suites d’accords chromatiques. La Cloche fêlée est également une belle réussite, et il faut signaler les effets obtenus dans les « Trois Lyriques » de 1905. A l’autre extrémité de ce parcours, L’Adieu à la vie, sur des textes de Rabindranath Tagore, dont l’humeur sombre correspond sans doute à celle du conflit mondial, laisse éclater une personnalité totalement affirmée, qui ose la dissonance et l’atonalité.
Sur le plan de la découverte musicale, la parution de ce disque serait donc à marquer d’une pierre blanche, si sa réalisation était tout à fait à la hauteur de ces ambitions. A en croire son site, la soprano britannique Lorna Windsor a eu un beau début de carrière à Paris et dans d’autres villes de notre pays : c’est sans doute ce qui explique la grande qualité de son français, à peine entaché par quelques T un peu trop « anglophones ». Elle se produit désormais exclusivement en Italie, d’où son intérêt pour l’exploration d’un répertoire méconnu lié à son pays d’adoption.
Avec les premières plages du disque, on découvre une voix corsée – une soprano, vraiment ? On la croirait d’abord mezzo – ce qui nous change agréablement de tant de chanteuses anonymes, incapables de donner vie à la musique. Les poèmes sont compris et réellement interprétés. L’artiste est capable de jolis sons filés, avec en fin de certaines mélodies des notes tenues qui semblent ne jamais devoir se terminer. Là où le bât blesse néanmoins, c’est quand il faut s’élever sur la portée, et dans la nuance forte : le timbre se durcit, s’acidifie, et devient franchement pénible à entendre. Un seul exemple : le contre-ut sur la deuxième syllabe du mot « soleil » dans « Nuageries ». Comme si, démentant l’impression de fraîcheur juvénile communiquée par la photographie de Lorna Windsor reproduite dans le livret d’accompagnement, l’auditeur avait affaire à une chanteuse vieillissante qui s’aventure dans des territoires qu’elle ferait désormais mieux d’éviter.
Et la complicité qui unit la soprano à son pianiste, Raffaele Cortesi, n’y change rien, hélas : il s’agit ici d’un de ces disques que l’on voudrait aimer, mais dont il serait criminel de ne pas signaler les défauts.