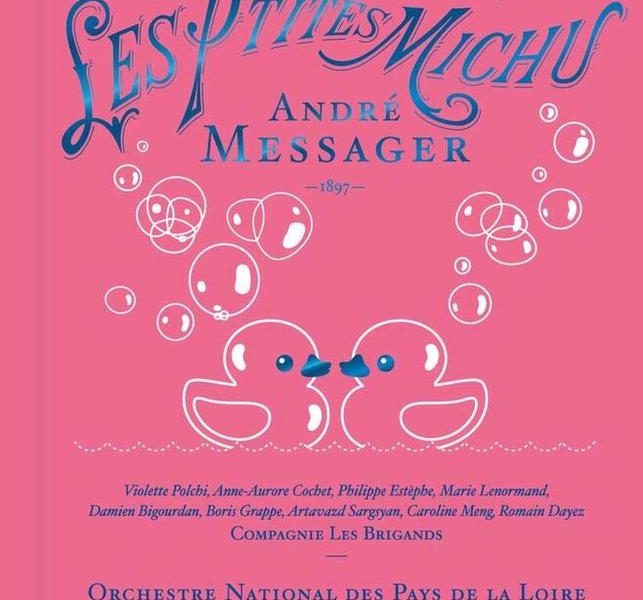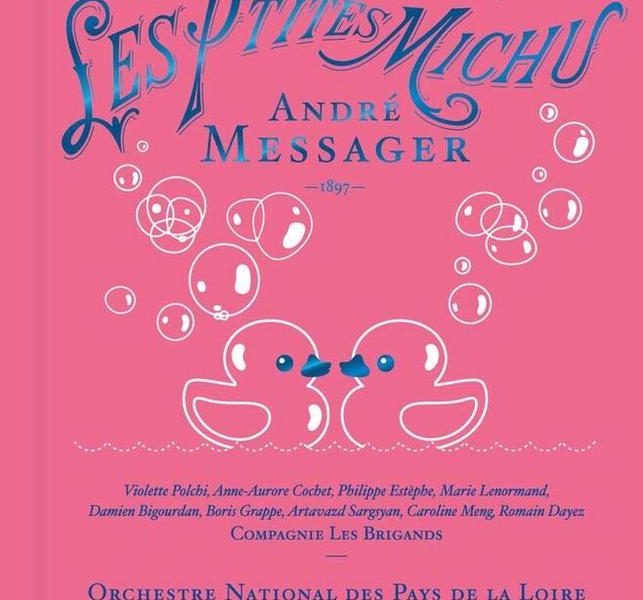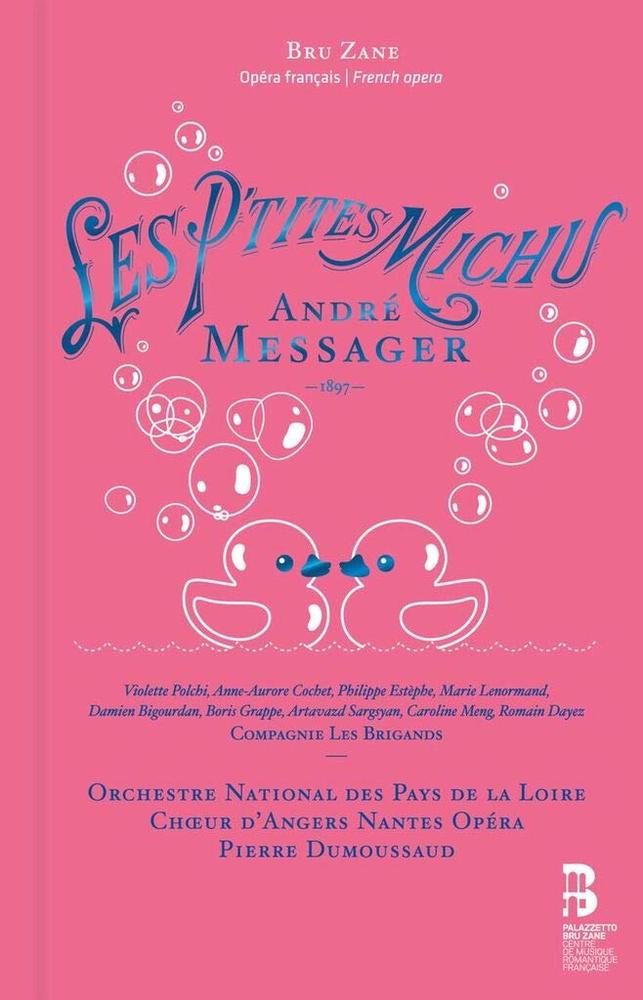Délicate, très délicate opération que de dépouiller l’opérette de la gangue de ringardise qui ne lui est que trop étroitement associée… Il y a pourtant des trésors musicaux qui ne demandent qu’à ressurgir, et si même Véronique tend à sombrer dans la torpeur, c’est peut-être le moment de révéler d’autres petites merveilles d’André Messager. C’était donc une excellente idée – une de plus – qu’eut le Palazzetto Bru Zane en redonnant vie à un titre qui précéda de très peu la susdite Véronique. Avec Les P’tites Michu, il y avait matière à redécouverte, car on n’en connaissait guère que de larges extraits enregistrés il y a un demi-siècle. Fidèle à une habitude prise depuis Les Chevaliers de la table ronde, le Centre de musique romantique française a donc fait subir à l’œuvre un traitement de choc, dont Forum Opéra a rendu compte lors de la création en mai dernier : un spectacle enlevé, porté par une actualisation qui oubliait le prétexte historique (le livret situe l’action en 1810) pour le rapprocher de nous d’un siècle et demie, vers l’époque et l’esthétique des Demoiselles de Rochefort. Voici qu’en est maintenant commercialisé l’écho, mais sans image à l’appui, ce qui est peut-être dommage.
Quand on n’a que le son pour unique repère, la perception s’en trouve nécessairement modifiée, et ce qui pouvait fort bien passer à la scène ne fonctionne pas toujours aussi bien. Quand on a en tête l’exquis duo formé naguère par Liliane Berton et Nadine Renaux, ou si l’on a écouté, plus près de nous, Renée Fleming et Susan Graham interpréter « Blanche-Marie et Marie-Blanche », l’air le plus connu de l’œuvre, on sursaute en découvrant les seules voix de mesdames Polchi et Cochet. Quand on n’a que le son privé de toute image, ce ne sont plus deux souriantes jeunes filles, mais deux viragos que l’on croit entendre. Que l’une des deux « jumelles » ait un timbre plus sombre pour la distinguer de l’autre, cela s’admet, mais fallait-il que toutes deux aient une voix aussi corsée et un ton aussi péremptoire ? C’est bien dommage, car les couleurs de ces deux chanteuses transforment les « p’tites » Michu en terribles matrones. Et comme la mise en scène semble avoir forcé le côté turbulent et populaire des deux héroïnes, on finit par s’étonner que le pensionnat où elles sont élèves ne les ait pas un peu mieux dégrossies. Cela dit, quand on entend les cris suraigus et hystériques de leurs camarades (dans les dialogues parlés seulement, par bonheur), on se dit que ce n’est pas le pire. Les titulaires – anonymes, sans doute des artistes du chœur dont le nom n’est nulle part précisé – des interventions de Claire, Palmyre, Ida et Francine dans le premier morceau font une fois de plus regretter un âge d’or où les chanteurs, sans avoir des voix toujours renversantes, savaient au moins faire comprendre le moindre mot de ce qu’ils interprétaient. Par comparaison avec leurs filles, les parents Michu sembleraient même par trop distingués : quand on n’a que le son pour se faire une idée, Marie Lenormand s’exprime presque comme une grande dame, et Damien Bigourdan, malgré des airs ahuris, donne lui aussi un côté quasi sophistiqué à son personnage.
On s’étonne aussi que Bagnolet, soldat dont Alexandre Dratwicki signale lui-même l’appartenance aux classes laborieuses, soit ici transformé en une sorte de robot : cela marchait peut-être à la scène, mais quand on n’a que le son, on a un peu de mal à comprendre pourquoi le personnage sur-articule comme un automate un texte qui cherche au contraire à imiter un parler populaire et, trait qu’il partage avec le Général, la manière dont les militaires mangeaient les mots en début de phrase… En Mademoiselle Herpin, Caroline Meng récupère la Ronde des Halles, normalement dévolue à Marie-Blanche ; elle la chante avec panache mais avec une diction qui manque un peu de clarté, et ce changement d’attribution a surtout pour résultat de faire s’exprimer la directrice de la pension dans le même idiome que les personnages de la Halle. Finalement, ceux qui s’en tirent le mieux sont le ténor Artavazd Sargsyan, dans le rôle du benêt Aristide, et le baryton Philippe Estèphe en Gaston, Boris Grappe étant sans doute encore un peu jeune pour camper une vieille ganache comme le général des Ifs.
C’est évidemment l’attrait de cet enregistrement que de restituer un certain nombre de morceaux jusque-là négligés par les sélections jusqu’ici disponibles au disque (27 minutes de musique avec l’orchestre Radio-lyrique dirigé par Roger Ellis en 1953, deux faces de 33-tours dirigées par Jules Gressier en 1954). On remarque néanmoins des coupures (la reprise de « Je n’y comprends rien » à la fin du sextuor du troisième acte, par exemple). Pierre Dumoussaud dirige cette partition avec tout l’esprit qu’on en attend, mais un peu plus de moelleux dans l’ouverture n’aurait pas été de refus.