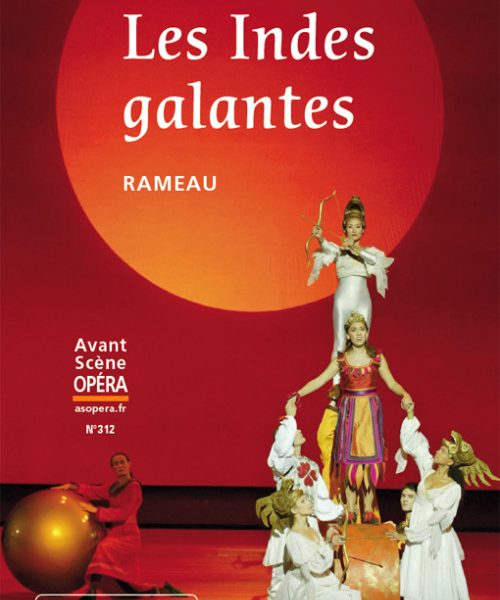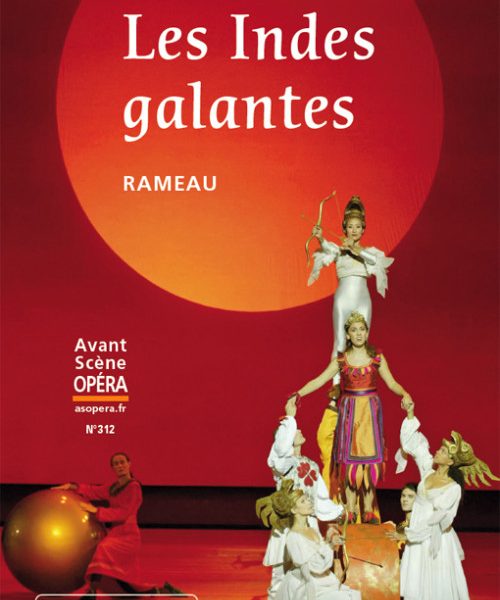Pour fêter ses 350 ans d’existence, l’Opéra de Paris met à l’affiche, à partir du 26 septembre, Les Indes galantes dans une nouvelle production signée Clément Cogitore, dirigée par Leonardo García Alarcón. L’Avant-Scène Opéra en profite pour proposer une version actualisée du volume qu’elle avait consacré il y a plus de 35 ans au chef-d’oeuvre de Rameau : depuis le 11 septembre, le numéro 312 s’est ainsi substitué au numéro 46, sorti en décembre 1982.
Un genre post-lullyste
Fondateur de la tragédie en musique, Lully meurt en 1687, laissant un grand vide qu’il paraît presque impossible de combler. Dix ans après, le salut viendra de l’invention d’un nouveau genre : en 1697, avec L’Europe galante, Campra crée l’opéra-ballet, forme plus souple, avec ses « entrées » distinctes, vaguement reliées par un thème unificateur. Le Prologue n’est plus un hommage obligé à la gloire du monarque, mais fournit l’explication, le prétexte aux actes qui suivent. L’exotisme des sujets stimule l’ingéniosité des décorateurs et parfois l’imagination des compositeurs. Les livrets devant surtout servir de prétexte à la danse, leur faiblesse éventuelle est moins gênante que dans une tragédie lyrique. Louis Fuzelier, librettiste des Indes galantes, collaborait depuis déjà une vingtaine d’années avec des compositeurs, et avait même théorisé l’art d’écrire pour l’opéra-ballet, en favorisant la danse expressive et non plus simplement décorative. Quand Rameau propose son « ballet héroïque » en 1735, il s’inscrit donc dans le prolongement des Destouches, Montéclair, Mouret, Colin de Blamont et Dauvergne. Pour son deuxième ouvrage scénique, il se range dans une catégorie bien établie, qu’il pratiquera finalement bien davantage que la tragédie. Il existe aussi des ballets à intrigue suivie, genre que le Dijonnais adoptera aussi, notamment avec Zaïs (1748). Même Platée est considéré en 1745 comme un « ballet bouffon ».
Postmoderne avant l’heure
La souplesse du genre opéra-ballet est appréciée par les directeurs de l’Opéra parce qu’elle leur permet de relancer l’attention du public, en ne conservant que les actes à succès, et d’introduire diverses innovations. Cette structure très modulable favorise les reprises sous des formes légèrement modifiées. Les Indes galantes sont la parfaite illustration de cette géographie variable : la partition de Rameau apparaît en effet comme une sorte d’œuvre ouverte, comme un collage postmoderne avant l’heure, en partie fondé sur la réutilisation de pièces antérieures. L’on en dénombre pas moins de six versions, six états d’une partition en constante évolution. En août 1735, à la création (la première reflétant déjà diverses transformations survenues durant les répétitions), le Prologue n’est suivi que de deux entrées, « Le Turc généreux » et « Les Incas du Pérou » ; s’y ajoute, dès la troisième représentation, « Les Fleurs, fête persane », et il faut attendre mars 1736 pour qu’arrive « Les Sauvages ». Rameau modifiera son œuvre en mars 1743, en juin 1751 et enfin en 1761, réécrivant, développant, retranchant, supprimant puis rétablissant des airs, simplifiant certains passages jugés trop difficiles d’exécution. Pour l’acte des Fleurs, il existe même deux versions entièrement différentes. Et l’on ne parle même pas des changements posthumes…
L’imposture française ?
Dans le Prologue, la jeunesse de France (tout comme celle d’Espagne, d’Italie et de Pologne) ne s’intéressant plus qu’à la guerre, Cupidon emmène ses amours aux quatre coins de la planète, pour voir si l’on pratique mieux, loin de l’Europe, cette galanterie qu’on prétendait alors typiquement française. Dans l’acte des Fleurs, on est entre Persans, loin de toute influence occidentale. Au Pérou, le conquérant espagnol vient détourner Phani de « la criminelle erreur qui séduit les Incas ». Enfin, c’est ce qu’il dit, car Huascar a une autre vision des choses : « C’est l’or qu’avec empressement, / Sans jamais s’assouvir, ces barbares dévorent. / L’or qui de nos autels ne fait que l’ornement / Est le seul dieu que nos tyrans adorent ». Deux Français captifs sont les héros du « Turc généreux », et leur seul souci est de revoir les « Rivages fortunés de l’empire des lys ». Quant aux « Sauvages », l’Amérique est le théâtre d’un conflit armé opposant Espagnols, Français et Premiers Habitants, la France apparaissant sous les traits du ridicule Damon, chantre de l’inconstance et avant tout soucieux de se distraire. Musicalement, l’opéra français passait pour une imposture aux yeux de beaucoup d’étrangers, formés à l’école italienne. Rameau ne se montre pourtant pas toujours aussi français qu’on pourrait le croire : s’il met la danse à l’honneur et reprend certaines formes lullistes, comme la grande chaconne finale, récupérée de Samson, projet avorté sur un livret de Voltaire, s’il privilégie l’art de la déclamation dans un récitatif toujours mouvant et attentif aux moindres nuances, il déploie aussi une virtuosité assez italienne dans les « airs de divertissement », l’ariette brillante, truffée de vocalises où le chant est roi (apparemment, l’air en italien, « Fra le pupille di vaghe belle » qui figure dans l’une des versions des « Fleurs », avait été supprimé par Rameau avant la première).
Rameau vu par la postérité
En 1773, l’Opéra de Paris affiche la dernière reprise des Indes galantes. Au siècle suivant, Rameau survivra à travers d’autres œuvres, plus ou moins remaniées ou amputées, Casto et Pollux, surtout. Le compositeur devient bientôt une bizarrerie archaïque ; on ne le connaît plus guère qu’à travers de rares fragments donnés en concert (en janvier 1840, Habeneck met le chœur des Sauvages au programme de la Société des concerts du Conservatoire), mais il est défendu par quelques admirateurs qui retiennent surtout les passages préfigurant Gluck et la tragédie lyrique des années 1780 : Berlioz d’abord, puis Adolphe Adam, qui arrange pour chœur un menuet de Castor. A partir de 1855, le chanteur François Delsarte publie les Archives du chant, qui propose notamment trois fragments des Indes galantes. En 1880, l’éditeur Théodore Michaëlis lance la collection « Chefs-d’œuvre de l’opéra français », où Les Indes galantes figureront très vite en bonne place. Quand Sait-Saëns prend la direction d’une édition des Œuvres complètes de Rameau, c’est Paul Dukas qui établit en 1902 la partition des Indes galantes. En 1908, on peut voir Hippolyte et Aricie au Palais Garnier, en 1918 vient le tour de Castor, programmée par anti-germanisme militant. En 1925, l’Opéra-Comique propose enfin l’Acte des Fleurs, et il faudra attendre 1952 pour que l’œuvre retrouve la scène parisienne dans son intégralité, même si elle est affublée de dialogues parlés et d’une orchestration signée Henry Busser. Avec ses costumes somptueux, ses décors impressionnants et sa diffusion de parfum dans la salle pour l’acte des Fleurs, le grand spectacle réglé par Maurice Lehmann connaîtra 286 représentations jusqu’en 1965.
Les Indes post-coloniales
Pour sa nouvelle production, l’Opéra de Paris promet des Indes galantes « comme on ne les a jamais vues – ni peut-être même pensées », tout étant parti du court-métrage réalisé par Clément Cogitore pour la 3e Scène. Le pari consiste à étendre à l’ensemble de l’œuvre le principe de « Forêts paisibles » dansé sur le mode krump, danse de rue issue du hip-hop, par des jeunes en sweat à capuche. Loin de célébrer la réconciliation entre sauvageons et Occidentaux, c’est plutôt la battle qui est donnée à voir, contre cette « idéologie impérialiste et nationaliste » qu’incarnerait la partition de Rameau. La chorégraphie de ces Indes galantes sera assurée par Bintou Dembélé, « figure emblématique des ‘esthétiques du marronnage’ », et il reviendra à Leonardo García Alarcón d’adapter la musique aux ambitions affichées. En dehors de l’extrémisme revendiqué de cette « prise de la Bastille » par les cultures urbaines, il faut néanmoins reconnaître que ces positions ne sont peut-être pas aussi neuves qu’elles en ont l’air : au printemps 2004, la production signée José Montalvo et Dominique Hervieu confiait déjà Les Paladins à des danseurs hip-hop. Et en remontant un peu plus loin, le spectacle monté par Alfredo Arrias à Aix-en-Provence en 1990 nous présentait Zima en émule de Tina Turner entourée de punks, la Danse du grand calumet de la paix adoptant un rythme étonnamment moderne aux oreilles de bien des festivaliers.