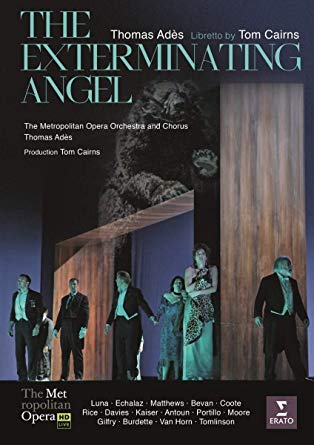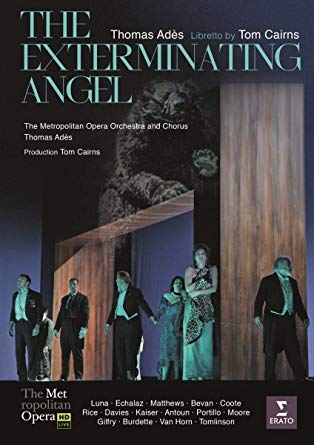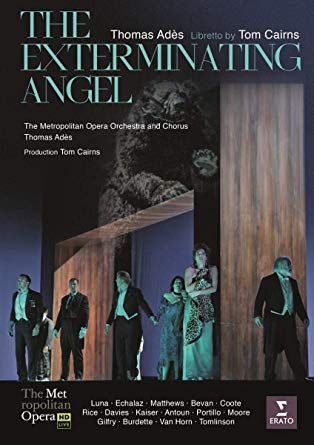« Nous ne sommes pas victimes d’un enchantement. Nous ne sommes pas dans la maison d’un magicien », s’exclame le docteur Carlos Conde au milieu du deuxième acte de The Exterminating Angel. Et pourtant si : grâce au dernier opéra de Thomas Adès, nous sommes bien chez un magicien, puisque nous avons affaire à un compositeur d’aujourd’hui qui ne pratique pas l’art lyrique simplement parce que c’est la mode, mais bien parce qu’il sait écrire pour les voix ! Chez Thomas Adès, contrairement à ce qui est trop souvent le cas aujourd’hui, nous n’avons pas affaire à un compositeur qui écrit d’abord pour l’orchestre et qui y superpose un discours confié à quelques chanteurs, mais bien à une dramaturgie qui repose sur les voix et qui avance grâce à elles. The Exterminating Angel ne se limite pas à une conversation en musique, mais offre réellement aux chanteurs autre chose qu’un vague dialogue mis en notes. Thomas Adès n’a pas peur de réunir les voix en grand nombre – quinze personnages principaux, presque constamment en scène, et une dizaine de figures secondaires, sans oublier le chœur – et il n’a pas peur non plus de ce que l’opéra contemporain semble parfois considérer comme une maladie honteuse, c’est-à-dire le fait de marier les voix pour des duos et des ensembles. Il y a même des airs dans cet opéra-là, justifiés par le livret (quand on demande à un personnage de « chanter » pour divertir l’assemblée, ou quand tel autre exprime son humeur par une « chanson »).
En matière de livret, Thomas Adès a aussi visé juste : dans la grande vogue des opéras inspirés par des films célèbres, The Exterminating Angel serait presque l’exception qui confirme la règle, dans la mesure où c’est l’une des très rares réussites en la matière. Peut-être le film de Bunuel se prêtait-il mieux que d’autres à ce travail d’adaptation, même si le huis-clos est ici aéré par des scènes nous montrant l’extérieur de la maison où les invités de la señora de Nobile sont mystérieusement retenus prisonniers. Sur trois actes se déploie un cauchemar surréaliste qui ne trouvera aucune explication quand interviendra finalement la libération des convives, non sans qu’ils aient eu l’occasion de basculer dans la démence et la barbarie. Même s’il faut espérer que cet opéra connaîtra d’autres productions de par le monde, la collaboration avec le metteur en scène Tom Cairns dès la rédaction du livret a dû porter ses fruits, et l’œuvre possède une vraie cohérence, sans jamais pâtir de ses origines cinématographiques. Les costumes évoquent les années 1960 – le film est sorti en 1962 – et les légères variations du décor tournant évite toute monotonie. La direction d’acteur permet judicieusement à chacun des protagonistes d’affirmer sa personnalité. A l’inquiétante étrangeté de la situation montrée sur scène, la partition répond par une magie tout aussi surprenante, à travers le recours aux ondes Martenot, ou par le biais d’effets frappants sans pour autant relever de l’acrobatie ou du gadget, sans oublier l’humour qui détourne malicieusement l’ouverture de La Chauve-Souris au moment où la réception tourne au vinaigre.
Evidemment, la réussite tient aussi à la distribution de rêve rassemblée par les coproducteurs (Salzbourg, Londres, New York et Copenhague). A quelques noms près, les artistes sont les mêmes au Met que lors de la création mondiale à l’été 2016 (pour la dernière étape, au Danemark, c’est en revanche une équipe entièrement différente qui prit la relève). Citons en premier lieu celle qui fait désormais figure d’égérie de Thomas Adès, la soprano Audrey Luna, reine du suraigu, mais dont l’aisance dans ce registre est ici employée de façon bien plus agréable à l’oreille que dans The Tempest ; à son personnage de cantatrice revient le pouvoir de dissiper le maléfice qui empêchait les invités de sortir, lorsqu’elle chante le grand air final, sur un texte de Yehuda Halevi, rabbin espagnol du XIIe siècle. L’autre grand moment mélodique revient logiquement à un autre personnage de musicienne, la pianiste Blanca Delgado, superbement interprétée par Christine Rice. Tout aussi dignes d’éloges se révèlent Sally Matthews, Amanda Echalaz ou Sophie Bevan ; remplaçant Anne Sofie von Otter présente à Salzbourg et Londres, Alice Coote se glisse sans mal dans la peau de Leonora Palma et en traduit fort bien les obsessions. Autre abonné du répertoire baroque, Iestyn Davies trouve lui aussi une occasion de faire rire, ce dont il a peu l’habitude sur les scènes. Parmi les messieurs, Joseph Kaiser paraît un peu effacé en maître de maison, alors que, dans la même tessiture, Frédéric Antoun et surtout David Portillo profitent de tous les moments où la partition les met en valeur. John Tomlinson impose sa présence magistrale et son art de la déclamation. Dans le rôle du majordome Julio, on reconnaît Christian Va Horn, le beau Narbal des récents Troyens parisiens.
Maintenant, la question se pose : pourquoi aucun des trois opéras de Thomas Adès n’a-t-il été monté sur une scène parisienne ? Le quatrième sera-t-il plus heureux ?