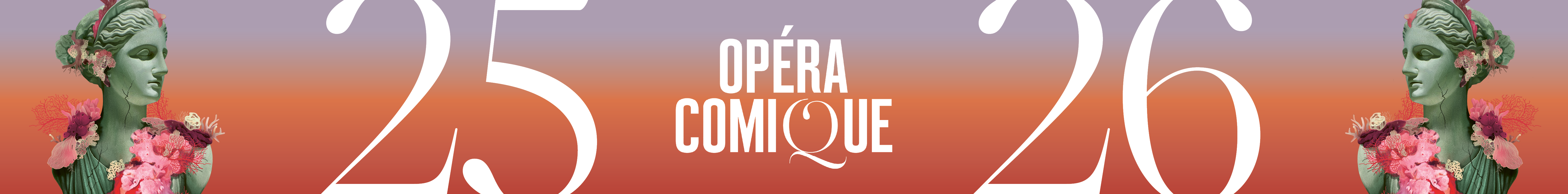Ce portrait de Georgette Leblanc, incomplet au regard d’un destin hors du commun, a été réalisé à partir de sa biographie par Maxime Benoît-Jeannin (Le Cri, 1998), ouvrage à lire absolument si l’on veut mieux appréhender une personnalité trop souvent réduite au rôle refusé de Mélisande.
« Quand on m’annonça, tous les regards se tournèrent vers moi. J’arborais pour ce grand soir un costume très mélisandesque et d’un ridicule harmonieux. Plus que jamais brillait sur mon front, le diamant qui déjà scandalisait Bruxelles. Mes cheveux, en copeaux dansaient autour de ma tête et ma robe de velours à fleurs d’or me prolongeait indéfiniment. Ainsi parée, telle Cléopâtre s’embarquant sur sa galère, j’entrais à la conquête de mon destin, tremblante au-dedans, orgueilleuse au-dehors »*. Ce destin évoqué par Georgette Leblanc dans ses Souvenirs (Bernard Grasset, 1931) a pour nom Maurice Maeterlinck (1862-1949). Lorsque la cantatrice rencontre l’écrivain le 11 janvier 1895 dans un salon bruxellois, l’homme, déjà auteur de Pelléas et Mélisande, est célèbre ; la femme a fait quelque bruit dans le monde.
Les chemins qui montent à la gloire
Née à Rouen le 8 février 1869, Georgette s’est affranchie jeune de l’emprise étouffante d’un milieu bourgeois. Un premier mariage en 1891 lui a offert l’émancipation souhaitée. Que cette union fût malheureuse importe peu puisqu’elle lui a permis de quitter sa Normandie natale et d’envisager la carrière lyrique défendue par sa famille.
Paris bruisse alors du triomphe Salle Favart du Rêve d’Alfred Bruneau. Ce succès a incité le compositeur à renouveler sa collaboration avec Emile Zola. Ce sera L’Attaque du Moulin. Léon Carvalho, le directeur de l’Opéra Comique, veut distribuer sans attendre les rôles principaux. Une seule audition en présence des auteurs suffit pour que le rôle de Françoise échoie à Georgette Leblanc – « complètement inconnue alors, qui captiva notre attention en nous chantant au lieu d’un air du répertoire, des lieder de Schubert et de Schumann, l’Adelaïde de Beethoven, et atténua ainsi la vague frayeur que nous causait l’originalité exagérée de ses robes, de ses chapeaux et ses allures », raconte Bruneau dans son recueil de souvenirs A l’ombre d’un grand cœur.
L’extravagance est une composante de la personnalité de Georgette Leblanc. « Sa jeunesse s’amuse à troubler le décorum des cérémonies officielles par le préraphaélisme étonnant de ses toilettes », s’émerveille Camille Mauclair, son amant de l’époque, avant de vanter « sa nature véhémente et passionnée ». La consonnance de son patronyme n’est pas assez italienne. Elle aurait voulu s’appeler Claire. Sa voix est encore mal assise ; elle manque d’expérience – grinchent quelques critiques. Mais son tempérament de tragédienne l’impose. L’interprétation de Françoise dans L’Attaque du Moulin est remarquée. « Ils parlent tous du triomphe de Georgette » s’ébaudit Maurice, son frère, également en quête de célébrité (Arsène Lupin ne verra le jour qu’en juillet 1905).

A la conquête de Maeterlinck
En proie au wagnérisme qui ravage l’époque, la jeune cantatrice étudie le rôle d’Yseult. En France, les théâtres boudent encore la musique de l’avenir. Une représentation – en français – de Tristan l’attire à Bruxelles en mars 1894. L’effet est foudroyant. « Il est impossible d’avoir une sensation d’art plus intense que celle que j’ai eue », écrit-elle. A Paris, Carvalho tente de tempérer son exubérance scénique en lui proposant Les Noces de Jeannette. Erreur de casting. Elle quitte la troupe de l’Opéra Comique et accepte un contrat à l’année à La Monnaie bruxelloise dans l’intention d’y chanter Wagner – mais aussi de rencontrer Maeterlinck dont la lecture des poèmes et des pièces l’a subjuguée, avance Maxime Benoît-Jeannin.
A défaut d’Isolde, s’ensuit autour de la création in loco de La Navarraise de Massenet puis d’une série de représentations de Carmen, un chassé-croisé amoureux entre la chanteuse française et le dramaturge belge dans lequel Mauclair joue le rôle du cocu. Ses aventures sentimentales relèguent au second plan son interprétation survoltée de Carmen – « une gitane qui aurait pris du haschisch », selon sa propre expression. Pourtant, sa présence scénique est telle qu’un soir, lors de la scène finale, le ténor qui chantait Don José, jaloux de son succès, aurait vraiment tenté de la poignarder. Reynaldo Hahn, des années plus tard, regrettera « de n’avoir pas eu l’occasion de l’y observer, étant persuadé que son talent hardi devait lui fournir d’étonnantes trouvailles ».
Certains comparent alors Georgette Leblanc à la Duse, considérée comme l’une des plus grandes comédiennes de son temps, bien que d’autres jugent l’instinct théâtral de l’Italienne sans commune mesure avec l’« originalité factice » de la Française.
Au-delà du tempérament dramatique, se pose la question d’une voix qui, après Carmen, aborde – en français – Fidelio puis Thaïs, des rôles aujourd’hui classés dans des catégories différentes. Est-ce la raison pour laquelle Bruxelles ne renouvelle pas son contrat ? Retour à la case France.

L’affaire Pelléas
1897. Georgette Leblanc est plus ou moins installée à Paris avec Maeterlinck qu’elle surnomme « Bébé ». Maîtresse et muse, la chanteuse se préoccupe autant de l’homme que de l’œuvre dont elle est la première inspiratrice. « L’amour n’a donc pas de limites, Maurice ? Quand donc le nôtre se lassera-t-il de monter ? », lui écrit-elle de Bordeaux où elle court le cachet. Contrairement à ce que certains affirment, leur relation ne sera jamais officialisée, même s’il arrive à Georgette de signer « Mme Maeterlinck ».
Le tournant du siècle est occupé par ce qui deviendra l’affaire Pelléas, avec en guise de préambule une Carmen scandaleuse Salle Favart. Sapho de Massenet, en mai 1898, où elle remplaçait Emma Calvé, la créatrice du rôle-titre, avait initié sous les meilleurs auspices les relations de Georgette Leblanc avec Albert Carré, le nouveau directeur de l’Opéra-Comique. Engagée pour interpréter l’héroïne de Bizet, elle part en Espagne à la recherche de la vérité originelle du personnage. Accompagnée de Maeterlinck, elle visite Madrid, Séville, Grenade et revient avec une vision renouvelée de la gitane, provocante et outrancière, à laquelle l’inauguration de la nouvelle Salle Favart le 7 décembre 1898 offre une publicité dont Carré aurait préféré se dispenser. En présence du Président de la République Félix Faure et de son épouse, Georgette Leblanc dépasse d’après les échotiers les limites de la vulgarité. Charivari, huées, sifflets dans la salle. Vocalement, la proposition n’est pas moins discutable. « Georgette Leblanc a l’aphonie des grandeurs », raille Jean Lorrain. Son contrat est suspendu.

Voilà qui augure mal, comme on peut l’imaginer, d’une Mélisande envisagée depuis plusieurs années. La mise en musique de Pelléas avait été évoquée par Debussy et Maeterlinck dès 1893, avant même la rencontre de ce dernier avec Georgette. La genèse de l’opéra fut longue mais jamais la cantatrice n’imagina que le rôle de Mélisande pût être confiée à une autre. Il y eut même en 1901 cinq séances durant lesquelles elle travailla la partition avec le compositeur. C’est par les journaux qu’elle apprit l’engagement de Mary Garden. Contrairement à Georgette, la soprano écossaise n’aurait pas fait l’affront à Carré de refuser ses faveurs, affirme Maxime Benoît-Jeannin. #metoo n’interviendra qu’un siècle plus tard. En dépit d’un accent britannique peu compatible avec la prosodie française magnifiée par la partition, le directeur de l’Opéra-Comique réussit à convaincre Debussy et Messager (alors directeur de la musique de l’Opéra-Comique, et chef d’orchestre de la création) d’engager sa protégée. Stupéfaction puis fureur de Maeterlinck s’estimant trahi, tandis que Georgette, très digne, adopte une attitude inverse et tente d’apaiser la situation. Sans succès. L’affaire fut portée en février 1902 devant les tribunaux, mais la plainte jugée irrecevable. De rage, l’écrivain s’en prit au compositeur qu’il tenta de provoquer en duel. Debussy esquiva les insultes. En désespoir de cause, Maeterlinck manifesta son opposition par voie de presse. Une déclaration, publiée par Le Figaro le 14 avril 1902, tenta de tuer l’opéra dans l’œuf : « Le Pelléas en question est une pièce qui m’est devenue étrangère, presque ennemie ; et dépouillé de tout contrôle sur mon œuvre, j’en suis réduit à souhaiter que sa chute soit prompte et retentissante ». Faut-il ajouter que son vœu ne fut pas exaucé ? Un siècle après sa création, le drame lyrique de Debussy demeure un fleuron du répertoire.
Une fois la séparation avec Georgette consommée, Maeterlinck révisera sa position avec un aplomb proche de la goujaterie. Le 28 juin 1920, il écrivit à Mary Garden : « Je m’étais juré de ne jamais voir le drame lyrique Pelléas et Mélisande. Hier, j’ai violé mon serment, et je suis un homme heureux. Pour la première fois, j’ai entièrement compris ma propre pièce, et cela grâce à vous. ». Souvent homme varie… Quant à Georgette, il lui restera la satisfaction d’avoir finalement pu chanter un rôle qu’elle estimait sien dix ans plus tard à Boston lors d’une tournée américaine.
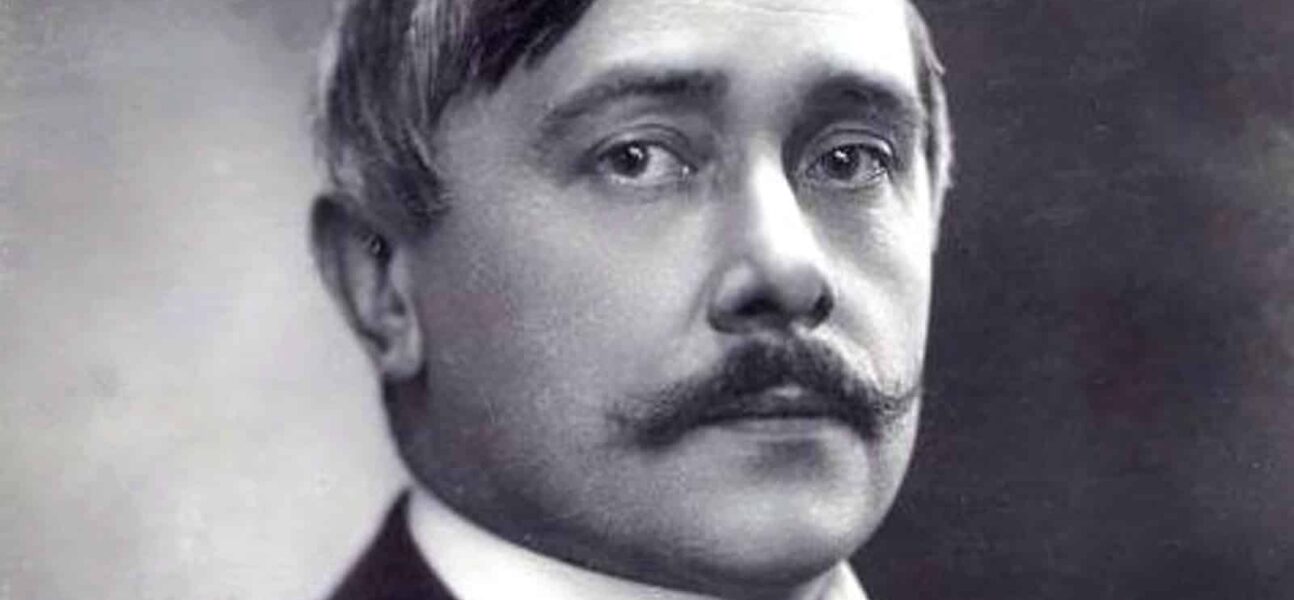
La revanche lacunaire d’Ariane
Si indigne puisse sembler son éviction, Georgette Leblanc était-elle la mieux à même d’incarner ce courant d’air qui s’appelle Mélisande ? La tragédienne aurait su, n’en doutons pas, apaiser un tempérament de feu, extraverti voire impudique, pour revêtir le voile diaphane de la princesse d’Allemonde. Mais la femme, alors trentenaire, pouvait-elle masquer une sensualité que trahissent les photographies de cette époque, une silhouette sculpturale admirée par Rodin, une poitrine généreuse, un port de tête altier, des airs de reine ou de déesse, c’est selon, une superbe à mille lieux de l’héroïne insaisissable de Maeterlinck.
Réduire cependant la personnalité artistique de Georgette Leblanc à ce refus en forme de désaveu apparaît comme une injustice dont le poids pèse encore sur sa postérité. En dépit de l’hostilité dont elle fut victime, la cantatrice poursuivit une carrière qui appartient à l’histoire de l’art lyrique.

Tandis que Debussy tissait des harmonies liquides autour du texte de Pelléas et Mélisande, un autre compositeur fameux s’appliquait à poser des notes sur la prose de Maeterlinck. Destiné initialement à Grieg, offert à Chausson, Ariane et Barbe-Bleue occupa Paul Dukas près d’une dizaine d’année, de 1898, date à laquelle il découvrit la pièce, jusqu’au jour de la création du conte lyrique à l’Opéra-Comique, le 10 mai 1907. Face à l’insistance du compositeur envouté par Georgette, Carré n’était pas parvenu cette fois à ce que le rôle fût confié à une autre. Fidèle à son caractère entier, la soprano se jeta à cœur et corps perdu dans les répétitions. « Je la chante, elle se dessine à mes yeux et je suis éblouie […] On ne peut rêver une musique plus lumineuse, c’est fou, c’est aveuglant […] », écrivait-elle au compositeur. Las, des ennuis de larynx compliquèrent les répétitions. Surtout, Georgette, enceinte, se vit contrainte d’avorter pour ne pas interrompre sa carrière.
Reportée à plusieurs reprises, la première représentation eut lieu sans qu’elle fût tout à fait rétablie, ce que ne manqua pas de relever la critique. « Le rôle d’Ariane fut interprété par Georgette Leblanc de façon admirable au point de vue du jeu et de la plastique, d’une manière moins satisfaisante du point de vue vocal. J’entends qu’elle chante fort juste et fort bien, le volume de sa voix ne suffit pas toujours à faire parvenir jusqu’aux auditeurs un texte qu’il est indispensable qu’on entende mot à mot », jugea Gabriel Fauré dans Le Figaro. Alfred Bruneau, moins indulgent, l’estima « délicieusement décorative et légèrement compliquée ». Dans le Guide musical, Henri de Curzon admit qu’elle était « l’incarnation même de son personnage, qu’on ne peut concevoir sans elle » et constata que « les défaillances de sa voix, où d’ailleurs vibrent encore de charmantes sonorités, sont souvent rachetées par une diction pleine de poésie et une articulation qui ne laisse rien perdre… ».

Vaincre les pièges de la beauté
En l’absence de témoignages sonores, ces quelques avis ajoutés à l’écriture d’un rôle conçu à son intention aident à dessiner le profil vocal de Georgette Leblanc : soprano que l’on qualifierait aujourd’hui de dramatique, corroboré par un authentique tempérament de tragédienne, qu’une technique insuffisante privait de l’impact traditionnellement associé à ce genre de voix. Ce même défaut de bagage technique l’éloigna des grands rôles du répertoire, tant italien que français et allemand, au profit de l’opéra vériste ou post-wagnérien. Mozart, Verdi, Wagner ou ses contemporains, Puccini et Strauss, lui furent inconcevables. D’où peut-être l’avis du Courrier musical à propos de son Ariane, admirant l’artiste tout en assénant qu’elle ne fut jamais une « cantatrice ».
En revanche, l’égérie de Maeterlinck, amoureuse de littérature et poésie, possédait un sens du mot et de la prononciation qui explique la fascination qu’elle exerçait, notamment dans la mélodie (souvenons-nous de Bruneau disant l’avoir engagée dans L’Attaque du Moulin après l’avoir entendue en audition chanter des lieder de Schumann et Schubert). Dans ce répertoire, Stéphane Mallarmé lui-même succomba à ce que le Guide Musical décrivait comme « un charme très subtil mêlé d’on ne sait quelle très délicate perversité un peu décadente » et que le dramaturge et féministe français, Léopold Lacour, résumait en un oxymore : « magnifique monstruosité ».
Car évoquer Georgette Leblanc, c’est aussi côtoyer le gotha intellectuel et artistique de son époque : Maeterlinck donc, Mallarmé, Lacour mais aussi Montesquiou, Renard, Wilde, d’Annunzio ou plus tard Jean Cocteau qui préfacera son dernier livre, La machine à courage : « Son but est la gloire profonde, la terrible bataille de l’ange : vaincre les pièges de la beauté ». De ces grands hommes, Georgette parvint à gagner la considération, souvent l’admiration. Sa liberté, en des temps qui concédaient peu de droits au genre féminin, force le respect. Liberté d’être en tant qu’artiste, en tant que femme, elle qui, après sa rupture avec Maeterlinck, forma un drôle de ménage à trois avec sa secrétaire particulière, Monique Serrure, et l’écrivaine libertaire américaine Margaret Anderson. Toutes trois reposent sous la même stèle au cimetière du Cannet dans les Alpes Maritimes.

Cantatrice ? Peut-être pas mais artiste
Liberté d’écrire aussi, même si son amour pour Maeterlinck l’obligea longtemps à mettre entre parenthèses ses ambitions littéraires. La dédicace de La Sagesse et La Lumière, un essai de l’écrivain belge publié en 1898, tenta de la dédommager de son sacrifice : « Je vous dédie ce livre, qui est pour ainsi dire votre œuvre. Il y a une collaboration plus haute et plus réelle que celle de la plume ; c’est celle de la pensée et de l’exemple. Il ne m’a pas fallu péniblement imaginer les résolutions et les actions d’un sage idéal, ou tirer de mon cœur la morale d’un beau rêve forcément un peu vague. Il a suffi que j’écoutasse vos paroles. Il a suffi que mes yeux vous suivissent attentivement dans la vie ; ils y suivaient ainsi les mouvements, les gestes, les habitudes de la sagesse même ». Elle n’en est pas moins l’auteure de plusieurs ouvrages, des souvenirs essentiellement, mais aussi une étude sur le cinéma que Wikipedia nous dit finement observée et deux publications en anglais destinées à mieux faire connaître en Europe l’histoire d’Helen Keller.
Georgette Leblanc fut aussi comédienne, interprète privilégiée du théâtre de Maeterlinck, notamment de Monna Vanna qu’elle créa à Paris en 1902 avant qu’Henri Février ne transmute la pièce en drame lyrique sept ans plus tard au Palais Garnier (Lucienne Bréval interprétait le rôle-titre. Qu’il ne fût jamais question de le confier à Georgette est assez révélateur). Dans L’Oiseau bleu à Moscou en 1908, puis à Paris en 1911, elle joue La Lumière en même temps qu’elle dirige le spectacle. Retirée l’été à Saint-Wandrille, une abbaye en Normandie (devenue propriété privée à la suite de la loi du 1er juillet 1901, rendue au culte depuis 1931), elle mit à profit en 1909 le décor gothique pour représenter Macbeth de Shakespeare, révisé par Maeterlinck. Elle interpréta devant une poignée de privilégiés (une soixantaine de personnes, elles-mêmes déguisées) une Lady « admirable de naturel et de vérité » d’après le journaliste belge Louis Piérard. Cette expérience théâtrale que l’on qualifierait aujourd’hui d’immersive fut réitérée l’année suivante avec Pelléas et Mélisande (la pièce, non l’opéra).

Au cinéma, Georgette Leblanc apparaît en 1924 dans un film d’avant-garde de Marcel Lherbier : l’Inhumaine, dont elle avait inspiré le scénario. Considéré comme un des chefs-d’œuvre français du muet, ce film qu’elle interpréta habillée par Poiret fut tourné dans des décors cubistes de Mallet-Stevens.
Muse, chanteuse, comédienne, metteuse en scène, actrice, écrivaine, conférencière, « être de légende » (comme la décrivait Suzanne Normand dans un hommage publié dans Les Lettres Françaises en novembre 1945). En un mot, artiste, ainsi qu’elle-même se considérait : « Quand je dis artistes je parle de quelque chose de périmé ; de cette race romantique destinée à disparaître dans un monde que j’appelle le monde matière. Je fais partie de cette espèce. C’est un malheur et c’est tous les bonheurs. C’est avoir mille palais pour goûter l’infini des délices de la vie… ».
Aujourd’hui, alors que le « monde matière » est advenu, il est de notre devoir d’entretenir la mémoire d’une telle artiste.