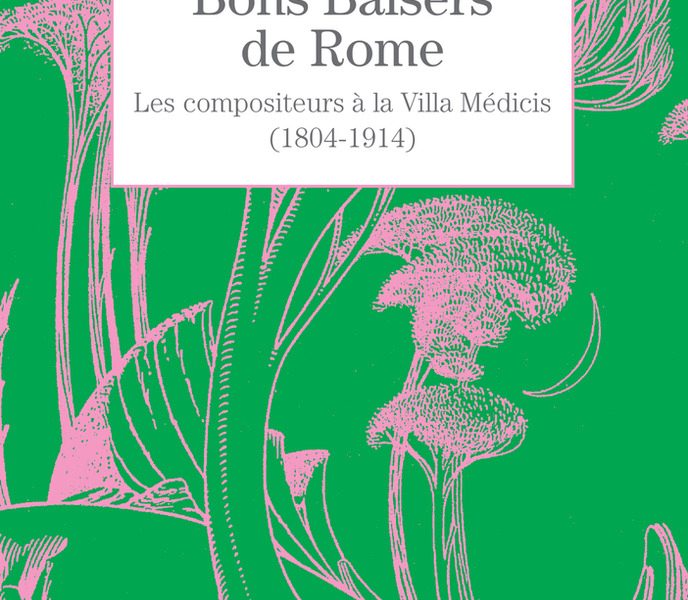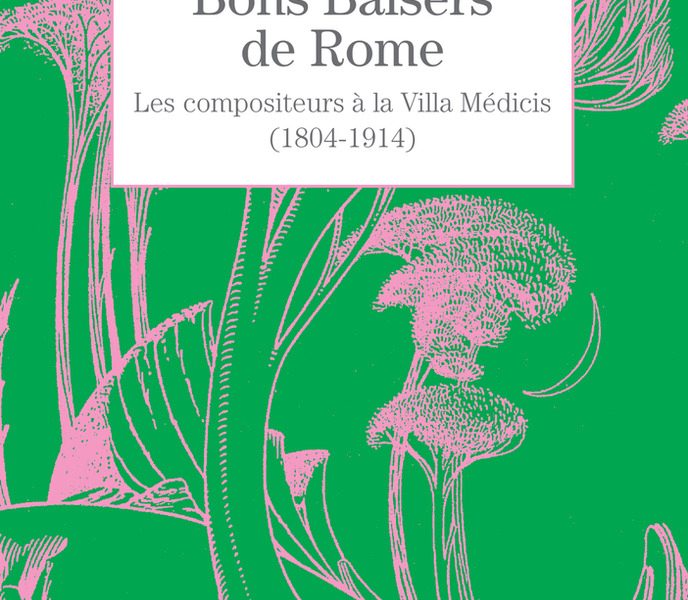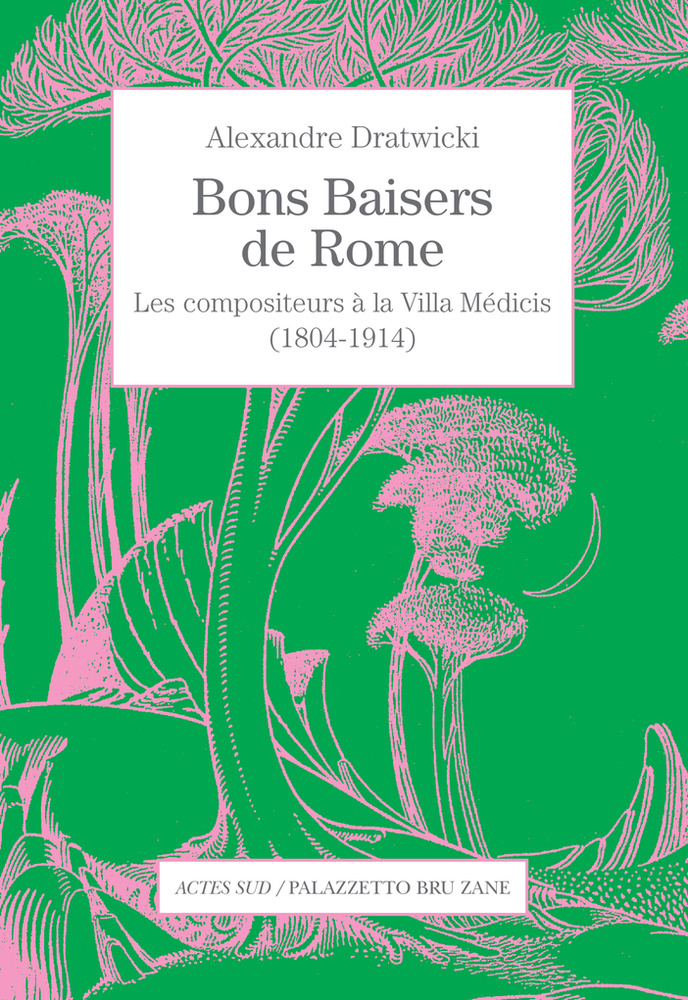Graal au 19e siècle – et au-delà – de tout apprenti compositeur en quête de gloire, le Prix de Rome a fait l’objet d’une série d’enregistrements, initiée en 2009, qui donne à découvrir les cantates avec lesquelles Charpentier, Debussy, Dukas ou encore Gounod ont forgé leurs jeunes armes. A cette somme discographique, il manquait un pendant littéraire, un ouvrage abondamment documenté qui aborderait le sujet sous plusieurs angles – historique, musicologique, sociologique… – de manière à donner un aperçu aussi complet que possible de ce qui ne saurait se résumer à une simple distinction honorifique.
Pour relever ce défi, nul autre que le Palazzetto Bru Zane, en la personne de son directeur artistique Alexandre Dratwicki, déjà à l’origine de la collection discographique évoquée plus haut. Sur une période allant de 1804 à 1914, l’auteur, lui-même ancien pensionnaire de l’Académie de France à Rome, explore les arcanes de la villa Médicis. Pourquoi 1804 ? Parce que le Prix, créé en 1663, brièvement interrompu durant la Révolution, attendit l’année 1803 pour ajouter la composition musicale à son palmarès et que le séjour des lauréats débutait habituellement l’année suivant l’obtention de la récompense. 1804 correspond donc à l’arrivée à Rome du premier compositeur médaillé, Albert Auguste Androt, qui n’en repartit jamais, mort d’avoir bu l’eau du Tibre (si l’on en croit les sources officielles, les non-dits autour de sa disparition prématurée laissent davantage penser à un suicide sentimental). Quant à l’année 1914, elle marque une rupture tant artistique qu’administrative consécutive à la déclaration de guerre.
Entre ces deux extrémités calendaires, que de bouleversements, notamment esthétiques ! L’évolution du langage musical fait l’objet d’un chapitre à part entière où, sur une cinquantaine de pages, est démêlé l’écheveau des influences jusqu’à ce que « le romantisme relativement uniforme des années 1860 rongé par les tendances wagnériennes explose tout à fait sous la pression de plusieurs écoles expérimentales : symbolisme, naturalisme, vérisme, expressionisme, etc. », ce qu’Alexandre Dratwicki appelle « le temps des ismes ».
Evolution d’écriture, évolution des genres aussi. Le répertoire religieux – Messes, Requiem, Te Deum… – demeure une constante mais l’opéra italien est peu à peu supplanté par son homologue français et, au milieu du 19e siècle, l’opérette, fraichement émoulue des boulevards parisiens, s’immisce dans le répertoire maison, non sans grincements de dents. Ainsi ce rapport de 1874 à propos d’un ouvrage de Gaston Serpette, compositeur primé en 1871, qui « appartient à un genre très en faveur aujourd’hui auprès d’un certain public, mais qu’il est véritablement déplorable de voir adopter par un pensionnaire de l’Académie. »
Insipide reflet de l’art officiel, faut-il souhaiter la disparition du Prix de Rome, s’interroge le 20e siècle naissant ? Le bilan peut paraître sévère lorsqu’il s’attache aux compositeurs célèbres. Ravel, Chausson, Saint-Saëns : recalés en dépit de tentatives répétées. Berlioz, Debussy : gaspillés si l’on considère le peu d’intérêt des partitions composées durant leurs années italiennes. A la question de l’utilité d’une telle institution, Alexandre Dratwicki refuse cependant toute position définitive : « Dans ce monde hors du temps, tout n’est pas resté figé selon une posture classique ou réactionnaire ». Et l’auteur, en une séquence émotion conclusive, d’opposer la « caserne académique » vilipendée par Berlioz (dont les fameux appels à l’Italie dans Les Troyens ne doivent rien à son séjour romain) au désarroi de Bizet qui pleura « six heures sans désemparer » lorsqu’il dut quitter la Villa Medicis.