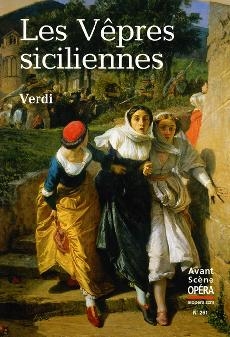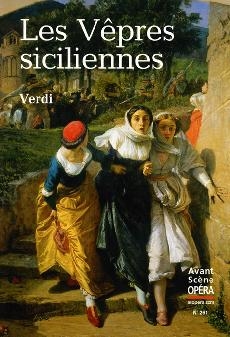Au contraire de l’hirondelle qui, rappelons-le, ne fait pas le printemps, une réédition d’un ancien numéro de l’Avant-Scène Opéra est souvent de bon augure pour l’œuvre qui en fait l’objet. Alors, en ce mois de mars 2011, Les vêpres siciliennes reviendraient-elles sur le devant de la scène ? Deux nouvelles productions dans les semaines à venir, à Genève et Turin, auxquelles s’ajoutent des extraits en version de concert au Théâtre des Champs-Elysées laissent à penser que oui. A vrai dire, Les Vêpres siciliennes, ou I Vespri siciliani, sa traduction italienne réalisée dans la foulée de la création parisienne, n’ont jamais vraiment quitté l’affiche. La liste des représentations établie par Elisabetta Soldini pour cette nouvelle édition de l’Avant-Scène en apporte la preuve : pas moins de quatorze maisons d’opéra dans le monde, dont Paris en 2003, l’ont inscrit à leur programme depuis le début des années 2000. Certains signes pourtant ne trompent pas. Si le rideau se lève encore sur la première œuvre lyrique composée en français par Giuseppe Verdi pour l’Opéra de Paris, le disque ne compte que deux intégrales supplémentaires depuis 1985, date de la première publication d’un numéro de l’Avant-Scène consacré aux Vêpres Siciliennes, et la vidéographie n’est pas beaucoup plus généreuse. Jean Cabourg, 26 ans après, continue d’attendre un enregistrement en français digne de ce nom de l’opéra de Verdi ; la seule version studio jamais enregistrée, en italien – Domingo, Arroyo, Levine – conserve le maillot jaune.
Comment expliquer pareil désamour ? Avec Les Vêpres siciliennes, Giuseppe Verdi cède aux sirènes du grand-opéra français, un genre en vogue au milieu du XIXe siècle dont Daniel-François-Esprit Auber mit au point la formule avec La Muette de Portici en 1828 et dont Giacomo Meyerbeer popularisa ensuite la recette. Une intrigue amoureuse doublée d’un événement historique dramatique, prétexte à débordement scénique, vocal et orchestral. En ces années 1855 qui voient la création des Vêpres siciliennes, Giuseppe Verdi auréolé du triomphe de sa trilogie populaire – Rigoletto, Traviata, Trovatore – cherche un nouveau souffle. C’est à Paris, alors capitale incontestée de l’art lyrique, qu’il espère le trouver. Mais, en voulant se libérer des triples liens de la convention, de la censure et du succès qui l’emprisonnaient en Italie, le compositeur va tomber dans d’autres filets. Les pièges d’un genre alors sur le déclin, qui en fait ne correspond pas à « la sensibilité de Verdi pour la psychologie intime des personnages de son époque »1, se referment sur lui comme les mâchoires de la dionée autour de l’insecte. De cette inadéquation entre le fatras décoratif du grand-opéra et le désir d’un théâtre plus psychologique, nait une œuvre transitoire dont les qualités ne compensent pas les défauts. Livret mal ficelé, soprano en quête d’identité vocale, ténor en mal de personnalité… Le personnage le plus attachant de l’opéra est finalement Montfort, méchant de l’histoire mais aussi baryton, une tessiture qui chez Verdi explique la force de la caractérisation.
Voilà, parmi d’autres, quelques uns des points qu’étudie cette nouvelle publication de l’Avant-Scène. Une artériotomie particulièrement inspirée dans son contenu et équilibrée dans sa répartition entre les différents aspects de l’œuvre – historique, littéraire, musical –, le tout sans qu’aucun article n’apparaisse inutile. La plupart d’entre eux sont différents d’ailleurs de l’édition précédente. En ce sens ils la complètent plus qu’ils ne la remplacent. Le guide d’écoute, même, a changé de plume (c’est Bruno Poindefert qui, en appréciations à peu près équivalentes, commentait l’opéra en 1985)
Pour terminer, il est amusant de comparer le regard critique que nous portons aujourd’hui sur Les Vêpres Siciliennes et la façon dont l’ouvrage fut accueilli à l’époque. « Un succès étourdissant » titre Le Messager des théâtres et des arts. Tous les journaux bruissent ainsi d’éloges. Le plus bel hommage relevé par Hervé Gartioux reste celui de La Presse : « En entrant à l’Opéra, la musique de Verdi a pris l’allure mesurée et réfléchie du génie français, sans rien perdre de sa flamme et de sa chaleur italienne ». Pourquoi ce décalage entre l’enthousiasme manifesté alors et le jugement beaucoup plus mesuré de notre époque, surtout chez un compositeur dont la popularité ne s’est jamais démentie et dont la plupart des ouvrages, mal jugés au début du XXe siècle, ont depuis été réhabilités ? La réponse tient, à notre avis, en deux mots qui, 14 ans plus tard, à partir du même postulat que Les Vêpres siciliennes – grand-opéra français, commande de l’Opéra de Paris –, renvoient cette dernière œuvre à tout jamais dans l’ombre. Deux mots disions nous : Don Carlos.
Christophe Rizoud
1 Anselm Gerhard : Verdi face au grand opéra français