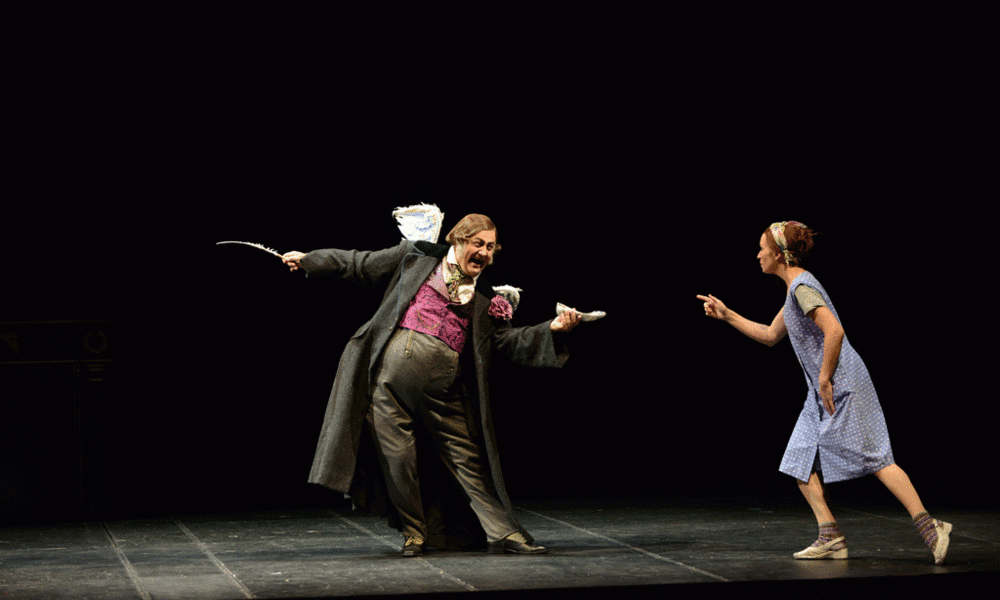Le prétexte de cette longue conversation avec Michèle Losier, c’est l’Oktavian du Rosenkavalier qu’elle chante à La Monnaie de Bruxelles à partir de ce 28 octobre.
On le verra, elle est aussi franche, directe, authentique, quand elle parle de son métier qu’elle l’est en scène. On verra aussi qu’elle ne cache rien quand elle évoque le travail vocal, les notes qu’il faut conquérir ou affermir. C’est au prix de ce travail qu’on devient le magnifique mezzo qu’elle est, au métier sûr, libre d’exprimer ce qu’elle ressent parce que la voix est là, assurée par une technique impeccable, à laquelle s’ajoutent une présence en scène, une énergie, une sincèrité formidables. La voici telle qu’en elle-même, à la fois modeste et sûre de soi. Et ayant accompli une bonne partie de ses rêves d’enfance…
On a commencé évidemment en lui demandant si elle était heureuse de retrouver Oktavian.
Oui, c’est un rôle que j’ai beaucoup chanté et que je chanterai beaucoup encore, et je suis vraiment fière d’avoir la responsabilité de ce répertoire.
C’est un rôle que vous aimez ? Christa Ludwig disait qu’elle ne l’aimait pas beaucoup…
J’aime beaucoup Christa… Je pense qu’elle a dû le chanter très jeune. Elle a été très jeune obligée de chanter des tas de choses. Mais quand on est très jeune et qu’on aborde un rôle alors qu’on n’a pas encore les moyens techniques, on en garde un mauvais souvenir… Alors que pour moi aujourd’hui c’est un bel accomplissement, j’ai les moyens techniques, vocaux, physiques et mentaux, donc ça devient, je ne dirais pas facile parce qu’Oktavian musicalement me demande de travailler tout le temps – et je ne parle pas allemand, donc je dois toujours travailler sur mon allemand –, mais c’est la consécration des rôles que je voulais faire dans ma vie. Quand on me demandait il y a vingt ans quels rôles je rêvais de chanter, c’était Oktavian et Componist [d’Ariadne auf Naxos], j’avais hâte de les chanter. Comme j’étais francophone, j’ai fait beaucoup de rôles en français, on m’a classée chanteuse du répertoire français, j’ai beaucoup chanté les rôles de Mozart aussi, et maintenant je suis arrivée à Oktavian ou au Componist et j’en suis très heureuse.

Oktavian à Berlin (avec Nadine Sierra) © Ruth Walz
Vous parliez de moyens techniques. Quels sont-ils pour ces deux rôles particulièrement ?
Il faut une homogénéité de la tessiture du grave à l’aigu. Pour le Componist il faut des aigus très solides. Moi par exemple, j’ai envie de pouvoir chanter doux, piano, même les notes de passage. J’ai un passage assez aigu, un passage de soprano sur le fa et le sol, et c’est agréable de chanter doux les aigus, que ce soit les la bémol, les la bécarre, et le si bémol aussi dont j’ai besoin dans le Componist…
Pour moi c’est important de pouvoir chanter pianissimo et même triple piano. Ça prend des années, ça a pris des années dans mon cas. Dans ma vingtaine, je n’avais pas du tout l’aigu facile. Même si ma voix était clairement un mezzo-soprano lyrique aigu, je n’avais pas les aigus faciles, ils étaient là, il fallait seulement apprendre à les faire, à les solidifier, faire confiance au corps et à la voix, il fallait faire confiance à la psychologie.
A mon âge, dans la quarantaine, je suis beaucoup plus à l’aise et confortable, que ce soit dans ma peau ou dans ma vie, et cela fait que le chant est beaucoup plus fluide. C’est cette fameuse fluidité dont on a besoin dans Strauss, pour toutes les voix, pour les sopranos aussi, ce legatissimo qui est nécessaire à cause du langage parlé : on n’est pas dans le Sprechgesang, mais on est quand même dans beaucoup de déclamation chez Strauss, et si on n’a pas cette fluidité musicale et ce legato, du coup, on galère un peu et ça devient plus hachuré.
Si on veut que notre allemand soit compréhensible, et sentir du chant, il faut être complètement à l’aise avec sa voix chantée pour entrer dans cette déclamation, pour être en même temps déclamative (si ça peut se dire) et lyrique. Ce sont les années de chant, et de confort, qui m’ont amenée à ces rôles aujourd’hui, je le dis en toute humilité.
Vous êtes évidemment la mieux placée pour sentir de l’intérieur l’évolution de votre voix et le parcours, le travail, qu’il a fallu accomplir…
J’ajoute que je ne suis pas un mezzo verdien, je ne chanterai jamais Verdi, je le sais depuis longtemps. Peut-être qu’il y aura des Wagner accessibles, mais ma voix n’est pas dramatique, elle a besoin de porter bien, d’être bien conduite pour aller jusqu’au bout de la salle. J’ai beaucoup travaillé là-dessus avec une professeure. Ce n’est pas une grosse voix, pour moi chanter Verdi ce serait trop lourd.
Maintenant que je suis dans la quarantaine, ma voix est restée fraîche et jeune parce que je ne chante pas beaucoup dans l’année, je ne fais pas soixante-quinze ou quatre-vingt performances. Du coup, je peux encore me permettre des rôles légers, lyriques. Le répertoire plus lourd ne me viendra pas, et je ne veux pas l’aborder. C’est pour ça que je suis contente et fière d’avoir atteint cette technique qui me permet chanter Strauss avec aisance, confort, et aussi avec plaisir.

Dorabella à Paris (avec Philippe Sly) © Anne Van Aerschot
Vous vous dites mezzo, mais est-ce qu’on ne pourrait pas dire soprano dramatique ? Vous avez chanté Mozart, Dorabella par exemple, qui n’est pas vraiment mezzo…
Oui, et il y a aussi tous les Berlioz que j’ai chantés, qui sont assez tendus aussi. En fait, il y a un terme en France, qui est Falcon. Et je me mettrais volontiers dans cette catégorie qui aujourd’hui n’est plus définie. Dans le vocabulaire moderne on parle de « soprano 2 », je suis la tierce en dessous de la soprano, j’ai étonnamment un passage de soprano, mais je n’ai pas le confort pour aller chanter Mimi ou Marguerite, même si je peux extraire un air de Puccini ou un air de Faust et dire que je peux le chanter. Mais je ne peux pas soutenir cette tessiture pendant une soirée. C’est ce qui détermine que je sois ce mezzo lyrique, qu’on entend chez Susan Graham ou Sophie Koch, que j’admire. Sophie Koch a une voix puissante, mais elle reste dans un répertoire très sopranisant. L’avantage, c’est qu’il y a de beaux rôles pour nous, écrits par Berlioz, Massenet ou Strauss…
Des rôles intéressants vocalement et humainement, des rôles à habiter, de par leur richesse…
Vous savez, il y a toujours le mythe Carmen, on est mezzo, on veut chanter Carmen… Je l’ai chantée, peut-être que je la rechanterai. Pour moi Carmen reste dans un mezzo, même si des sopranos l’ont abordée. On demande aujourd’hui des voix très sulfureuses et très sombres pour faire Carmen. Je peux avoir du plaisir à chanter Carmen dans de petites salles ou dans des productions très physiques avec le décor approprié, mais j’ai beaucoup plus de plaisir à chanter Mozart ou Strauss parce que je suis disons une quinte au-dessus de Carmen et c’est plus confortable.`

Carmen, Mise en scène par Barrie Kosky © D.R.
C’est une voix que vous avez eue d’emblée ou que vous avez conquise ?
Les deux… Je ne suis pas du tout une « Natursängerin ». Pour moi, ce n’est pas « J’ai ouvert ma bouche et tout s’est fait tout seul » ! J’ai fait beaucoup de concours dans ma vingtaine et je me rappelle avoir été en compétition avec des mezzos qui savaient chanter Komponist et moi je n’arrivais pas à le chanter en concours parce que je n’avais pas encore les aigus, ils étaient là, mais je n’étais pas confortable.
J’ai eu la chance de rencontrer les bons professeurs de chant, l’une d’elles avant tout, Marlena Malas, mais surtout des bons professeurs de respiration. Je me souviens aussi d’un ténor que j’ai rencontré aux Etats-Unis qui m’a aidée sur les notes de passage, parce que c’est particulier aussi pour les voix de ténor. Je ne peux pas dire que ç’a été un travail ardu, plutôt un travail de longue haleine, il fallait persévérer, faire confiance à la voix.
Ç’aurait pu ne pas marcher, j’aurais pu arriver à trente-deux, trente-trois ans, sans que ça se soit débloqué dans le bon sens, mais ça a fait son chemin, et je dois admettre – et beaucoup de femmes l’admettent – que l’arrivée de mon enfant à trente-sept ans m’a permis, non pas de découvrir de nouveaux horizons avec la voix, mais d’être beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie, de me concentrer sur d’autres choses dans la vie que la carrière, et du coup mon chant est devenu plus épanoui, et donc l’aigu est devenu plus confortable à la fin de ma trentaine, ce qui est tard pour un mezzo lyrique de ma nature.
J’ai eu la chance d’être au bon endroit au bon moment, de rencontrer les bonnes personnes, et d’avoir mon petit garçon, ce qui m’a permis d’avoir cette belle carrière et de continuer à l’avoir.

Dorabella, ROH 2012 © Johan Persson
C’est curieux, vous dites que d’avoir un enfant vous a permis de consolider vos aigus, alors que naturellement on penserait que cela fait plutôt descendre la voix…
C’est vrai si la chanteuse avant sa grossesse est très à l’affût de sa respiration et de son appui. J’ai travaillé mon souffle depuis un très jeune âge, l’adolescence même, pour du théâtre. Je respire beaucoup mieux en chantant que dans la vie, beaucoup mieux qu’en parlant par exemple. Il y avait donc des paramètres qui étaient là avant ma grossesse, alors que d’autres femmes découvrent des trucs avec la grossesse.
Moi, ç’a été vraiment psychologique, ça m’a décentralisée de ce métier, de la solitude où ce métier m’enfermait. Avoir un enfant m’a enlevé certains stress, certaines angoisses, certaines craintes, certaines limites qui se répercutaient dans ma tessiture…
Cela a ouvert votre voix, en même temps que votre horizon…
C’est ça. Ces aigus, que j’avais, ils sont maintenant toujours là et confortables, je n’arrive pas en me disant « Oh la la, est-ce que je vais réussir mon si bémol ? », au contraire je me dis « Est-ce que je vais réussir à chanter aussi doux que je veux, est-ce qu’aujourd’hui avec mon rhume je vais arriver à le faire aussi beau que je veux ? »… Je ne suis jamais dans la galère… Si j’ai un rhume et que je chante Carmen, ça ne va pas bien, mais si j’ai un rhume et que j’ai un rôle aigu, je m’en sors ! C’est aussi pour ça que je choisis ou que je prends des rôles où je suis confortable : pour pouvoir les chanter dans toutes sortes de conditions, fatiguée ou enrhumée ou asséchée…

L’Heure espagnole à Paris. MeS Laurent Pelly © Svetlana Loboff
Vous avez parlé de théâtre… Qu’est-ce qu’il y a eu d’abord, l’envie de la scène ou l’envie de chanter ?
Mon histoire est très typique : j’étais une petite fille qui allait à l’église dans un petit village, au Canada, vraiment isolé, loin de toute grande ville, je chantais à la chorale, et puis le dimanche, sur Radio-Canada, il y avait « Les beaux dimanches », une série où on entendait de l’opéra, et puis j’avais réussi à voir des opéras à la télévision et ça m’avait fascinée, on avait aussi quelques disques et je faisais du piano. Je n’avais aucune idée de savoir si je pourrais faire de l’opéra… Dans ma tête c’était impossible, ça appartenait à l’Europe, à l’au-delà, Pavarotti, Domingo… Je continuais le piano, et puis dans le secondaire j’ai fait du théâtre parce que j’aimais beaucoup la scène, j’ai appris à projeter, à respirer, j’ai rencontré des profs de théâtre ; ensuite pour les cours préparatoires à l’université il fallait choisir un autre instrument, j’étais pianiste, j’ai essayé le chant, la prof m’a dit qu’il y avait un potentiel, et voilà… J’avais dix-neuf, vingt ans… La voix n’était pas du tout prête, c’était un son un peu fabriqué, j’imitais, j’imitais… Et puis j’ai un peu laissé tomber le piano, ce qui est dommage parce qu’aujourd’hui je n’arrive pas à m’accompagner dans les Strauss, dans les Mozart oui, mais pas dans les Strauss… Mais donc j’ai retrouvé une passion d’enfance, je me disais waouh ! J’étais petite fille, je rêvais de ça, et maintenant je peux concrétiser cette passion…
Vous avez commencé votre études de chant au Canada, et puis vous êtes allée à la Juilliard School à New York ?
La Julliard, je n’y suis restée qu’un an. J’ai suivi ma prof, Marlena Malas, qui y enseignait, j’ai fait aussi des stages semi-professionnels aux Etats-Unis, à San Francisco par exemple : on reçoit une petite allocation, mais on fait des concerts, des opéras, on reçoit des cours, du coaching, on fait beaucoup d’entraînement théâtral… En Amérique du Nord, on est assez forts là-dessus, on se concentre beaucoup sur l’aspect théâtral, on travaille très tôt avec des metteurs en scène, qui souvent viennent du théâtre.

Siebel dans Faust, Washington (2012) © Catherine Ashmore
Ensuite j’ai continué à prendre des cours en privé avec Marlena Malas. Qui enseigne toujours à New York, même si elle est dans les quatre-vingt ans. Elle m’a beaucoup marquée, mais d’autres chanteuses aussi, Hélène Guilmette par exemple, ou le ténor Frédéric Antoun… On vient tous de cette école, même s’il y avait d’autres professeurs à Montréal.
C’est quelqu’un qui m’a donné beaucoup de confiance, qui a cru en ma voix de mezzo-soprano lyrique et qui m’a aidée pour les aigus. Elle était aussi mezzo (« But i was a very bad singer ! » (Rires), elle a beaucoup voyagé, parce que son mari, Spiro Malas, était un chanteur qui travaillait avec Joan Sutherland et Pavarotti, et donc elle avait beaucoup appris sur la route de ces chanteurs. Mais ce que je dis à propos d’elle n’enlève rien aux autres profs que j’ai eus. Tout le monde m’a vraiment emmenée vers le chemin, eh bien, du succès, disons. Aujourd’hui je l’appelle encore pour discuter de certains trucs…

Charlotte (Werther) à Montréal © D.R.
Comment expliquez-vous qu’il y ait une telle profusion de chanteurs et chanteuses venant du Québec ? Karina Gauvin, Marie-Nicole Lemieux, Julie Boulianne, Hélène Guilmette, Marie-Eve Munger, Florie Valiquette, Philippe Sly, Frédéric Antoun, Etienne Dupuis et dans le passé Raoul Jobin, Léopold Simoneau, Joseph Rouleau, Bruno Laplante…
Jadis je disais c’est l’air de la mer (rires), aujourd’hui je parle beaucoup de la langue francophone, de notre accent, qui nous offre une certaine ouverture vocale dès le début. Quand je chante en français, je ne trouve pas ça facile parce que le français est très « devant ». Et justement ma prof américaine me disait que je ne pouvais pas chanter le français comme on le parle en France. Evidemment que je ne vais pas le chanter en québécois non plus, mais il y a une espèce d’entre-deux à trouver, parce que notre accent est plus ouvert et plus « derrière », comme à l’italienne. Donc c’est une affaire de placement naturel.
Aujourd’hui je vis en Belgique, et donc j’entends beaucoup les Flamands, c’est une langue que j’étudie aussi, et je trouve fascinant de voir qu’il y a autant de voix graves. C’est aussi une conséquence de leur langue. D’être né dans une langue ou dans une autre, ça peut t’aider ou te nuire pour chanter…
Mais ce qu’il y a aussi au Québec, c’est qu’il y a des cuvées, Karina, Marie-Nicole, c’étaient mes idoles, même si Marie-Nicole a mon âge… Et puis on vient en Europe pour gagner notre vie, et donc on se fait remarquer. Chanter au Canada, c’est possible mais il faut voyager d’un endroit à l’autre, ça reste un marché très restreint, sauf dans le cas d’un Gerald Finley qui se promène aux Etats-Unis autant qu’au Canada… Mais on nous remarque peut-être parce qu’on vient d’une contrée lointaine alors qu’un chanteur européen qui va d’Allemagne en Italie, ou de France en Espagne, c’est la vie normale. Moi, si je veux chanter tous ces Strauss, j’ai plus de chances de le faire en étant établie en Europe.
En tout cas, on est tous amis et on en rit ensemble. On est fiers les uns des autres, il n’y a pas de jalousie. On est solidaires. Quand je suis arrivée au Met, je ne connaissais personne, j’ai reçu beaucoup de soutiens de mes collègues québécois. Là ce qui est drôle, c’est que Julie et moi on sera en alternance à Bruxelles pour Oktavian…

Siebel dans Faust au Met (2011) © D.R.
Justement à propos du Met, vous y êtes arrivée très tôt, c’était dans Siebel de Faust avec Jonas Kaufmann, non ?
J’ai même commencé avant, j’avais fait Iphigénie en Tauride, le rôle de Diane, cette déesse qui apparaît à la fin, je descendais des cintres… Ça, c’était grâce à un metteur en scène. Je dois admettre que beaucoup de mes contrats sont venus grâce à des metteurs en scène ou grâce à des chefs d’orchestre. Le Met, c’était il y a longtemps, je n’ai rien en vue là-bas pour le moment, mais, comme je dis, pour les musiciens le rideau monte et descend, il y a des périodes où l’on est plus invité, d’autres moins, ça change de couleur, ça change de mode, ça change de mezzo, de soprano… Je suis super contente d’être passée sur cette scène, avec le Faust…
Et avec Kaufmann et René Pape et Yannick Nézet-Séguin qui dirigeait…J’imagine que regarder travailler de magnifiques collègues comme eux, c’est intéressant… C’était il y a une dizaine d’années…
Mais j’avais travaillé avec eux avant. A la Scala avec Kaufmann je faisais Mercedes dans un Carmen… Avec René Pape au Royal Opera House. Effectivement c’était fascinant… J’ai même à mes débuts travaillé avec Villazón et Netrebko, j’étais Javotte dans un Manon. J’ai travaillé avec Domingo, aussi. C’étaient des rencontres impressionnantes, j’étais toujours dans un état de reconnaissance suprême.
Mais en fait ça m’a aidée à garder vraiment les pieds au sol. Ce sont des chanteurs qui ont toujours gardé les pieds sur terre, même si ce sont des grandes stars. J’ai appris des choses sur l’éthique du travail avec eux, et j’ai appris aussi à relaxer un peu… Kaufmann, je me rappelle, il y a eu un soir où il était un peu malade, et donc j’étais fascinée, je lui ai dit « Mais tu n’es pas un peu stressé », il m’a dit « Mais non, c’est comme ça… » Il avait ses propres défis, mais c’est quelqu’un qui aime aller sur scène et qui allait gérer sa voix au fur et à mesure de cette soirée-là. Moi, ça m’a aidée à me dé-stresser, à mettre les choses en perspective, parce que je ne suis pas comme lui, mais ça m’a aidée. Je ne suis pas dans cette classe de chanteurs, je n’ai pas leur vie…
Mais vous faites le même métier, et vous êtes sur scène à avancer tous ensemble. Et on sait bien que si un second rôle est mal distribué, c’est tout l’ensemble qui vacille…
Oui, il y a deux ans, j’étais à Paris et je faisais Siebel, et j’ai dit en riant au directeur que je commençais à être un peu vieille, par rapport au Faust de Benjamin Bernheim…. Ceci dit, si j’entre en scène pour ne chanter que deux airs, eh bien j’ai encore plus le trac… Je n’ai pas droit à l’erreur et je n’ai pas le temps de me rattraper… Mais voilà, j’ai appris de tout le monde et maintenant j’ai quarante-quatre ans et j’apprends de collègues qui sont plus jeunes que moi…

Oktavian à Berlin (avec Camilla Nylund) © Ruth Walz
Au printemps j’ai chanté avec Siobhan Stagg qui est une soprano australienne qui est à Berlin, elle a une dizaine d’années de moins que moi, elle chantait Sophie et j’adorais voir son sang-froid, son équilibre, sa discipline. Ça m’a fait du bien. Quand j’étais jeune je défonçais les portes, je voulais réussir, j’étais un peu égoïste, et puis en vieillissant je me suis assagie et je dois dire que je m’aime davantage aujourd’hui, ouverte, apprenant des plus jeunes ou des plus expérimentées, je reste toujours à l’affût, plus même que quand j’étais jeune.
Vous tenez des propos très modestes, il n’empêche que vous êtes invitée par les plus grandes scènes, vous êtes quasiment pensionnaire à Vienne…
J’y suis allée trois fois et au printemps on m’a appelée pour faire un remplacement. Les choses bougent. J’ai passé beaucoup de temps à Paris, il y avait Philippe Jordan qui m’aimait bien. Comme je le disais il y a des chefs qui nous aiment et qui nous réengagent. Là récemment j’ai travaillé avec Daniele Gatti, et je vais avoir d’autres occasions de travailler avec lui parce que ça s’est bien passé…
C’était pour le Compositeur dans Ariadne…
Oui, et je vais faire des Mahler avec lui. Mais en fait la roue tourne… On change de chef, on en rencontre un autre, il vous reprend pour un projet, et c’est comme ça qu’on peut passer deux ou trois saisons à revenir sur la même scène, et ensuite ça s’arrête et on vous appelle ailleurs… J’ai appris à ne pas m’inquiéter avec ça. Avant je m’inquiétais, je me disais que c’était terminé dans tel théâtre, que ça ne marchait plus, que je n’avais pas fait un bon travail… Mais aujourd’hui je sais que ce sont les chaises musicales avec les directeurs et les chefs… et tant mieux pour nous, on change de théâtres ! J’ai encore beaucoup de théâtres à conquérir ! Et ce n’est pas grave si on en manque un… Je pense au Teatro Real de Madrid, je devais y faire un Siebel, mais j’ai été enceinte, et l’occasion ne s’est pas représentée… Aujourd’hui j’arrive à me dire que ce n’est pas grave si je ne vais jamais à Madrid. Mais si un jour j’y arrive, eh bien j’en serai très contente… Je suis toujours curieuse d’aller essayer des acoustiques que je ne connais pas…

La Muse (Contes d’H.) avec Patricia Petibon à Bruxelles © D.R.
Qu’est-ce qui vous courir maintenant ? Les rôles, les chefs d’orchestre, les metteurs en scène ? Qu’est-ce qui vous intéresse le plus dans le métier tels que vous le pratiquez aujourd’hui ? Quarante-quatre ans pour un mezzo, c’est le bel âge !
Oui, je pense que j’ai devant moi plusieurs années de bons moments ! (Rires) Ce qui me fait courir, ce sont les chefs. Je vous ai parlé beaucoup de théâtre et de scène, mais pour moi, et je le dis en toute humilité, la scène et le théâtre c’était facile, naturel. J’ai été choyée par la vie, la présence sur scène, on l’a ou on ne l’a pas. J’enseigne et je le constate. Cela dit, j’adore travailler avec des metteurs en scène, aller plus loin dans le jeu, quitter mes petits stéréotypes d’actrice, ça me fait du bien…
Mais mes connections sont toujours plus fortes avec les chefs. Je suis musicienne au départ. C’est toujours « Prima la musica, poi le parole » ! Souvent, je vous le disais, ce sont les chefs qui font appel à moi, mais on n’a pas toujours le choix. Parfois on vous propose un contrat en vous disant que ce sera tel chef, et parfois on ne le sait même pas à l’avance. Je n’ai pas le luxe de dire non à une production parce que je ne connais pas le chef.
Mais la chose la plus importante à dire, c’est que ça ne m’arrive jamais de ne pas aimer un chef. Parce que je m’adapte, que je regarde comment ils travaillent. Et que si je constate que je n’ai pas accompli un travail qui va dans le même sens que le chef, eh bien je m’adapte à lui, je vais dans son sens. Ensuite, il se peut qu’on soit vraiment en difficulté, pour une histoire de respiration ou de scène ou de tempo que je n’aime pas, eh bien pour moi c’est un défi. On parlait de Dorabella, je me souviens que Philippe Jordan m’avait demandé : « A quelle vitesse maximum est-ce que tu peux chanter ? » Et on a essayé, et encore plus vite ! Est-ce que dans l’idéal je serais allée aussi vite ? Je ne pense pas. Mais c’était un beau défi.
De la même façon, il y a quelques années j’ai fait Sesto de la Clémence de Titus, et on s’est demandé quel était le plus lent qu’on pouvait faire, non seulement pour la respiration, mais aussi pour l’intérêt : il ne faut pas qu’on arrive à une lenteur telle que le public décrocherait…
Voilà, j’aime beaucoup les chefs. Ça ne veut pas dire que je n’aime pas les metteurs en scène, au contraire, ça se passe toujours assez bien. Je suis assez ouverte.

La Muse (Les Contes d’H.) à Barcelone (2013) © D.R.
Quand un chanteur se plaint que ça ne marche pas bien, c’est souvent que la technique ou les habitudes vocales ne lui permettent pas certaines choses. Il y a des rôles qui sont difficiles, où on a envie de dire au chef : « Là, il faut me suivre, parce que sinon je ne vais pas y arriver », ça c’est normal, mais je n’ai jamais des relations tendues avec les chefs. L’année dernière, j’ai travaillé avec Simone Young, qui a beaucoup de caractère, beaucoup de demandes, et moi j’étais un peu rebelle sur certains trucs, mais c’est pas grave ! On s’asseyait, on discutait, je lui disais « Là, je suis désolée, j’ai encore fait à ma tête », et elle me répondait « Voilà pourquoi j’ai envie de le faire comme ça », et on trouvait un terrain d’entente. Ce n’était pas du tout « Je n’aime pas, je ne suis pas contente de ce que je fais », c’était juste que ça me demandait un peu de plus de travail, parce que j’avais déjà chanté le rôle, donc j’étais dans mes habitudes, et j’avais du mal à changer certaines habitudes….
Justement, c’était pour Oktavian, cela…
Exactement, et ce qui est très drôle, c’est que trois jours plus tard, je suis allée à Vienne pour un remplacement et que ç’a n’a pas été un problème : je me suis adaptée à nouveau, j’ai passé ma soirée à regarder le souffleur et le maestro Jordan, mais ça s’est très bien passé. On arrive à faire des choses incroyables quand on a l’adrénaline !

Oktavian à Berlin © Ruth Walz
Mais j’imagine que c’est intéressant, ce sentiment de posséder un rôle, de l’avoir fait avec toutes sortes de chefs ou de metteurs en scène, de l’avoir intégré en soi…
C’est vrai, mais je dois toujours me remettre dans la situation. On découvre beaucoup de choses grâce aux chefs et aux metteurs en scène, on découvre les personnages sous de nouveaux aspects. Avec Simone Young, on regardait les mots du livret, et elle me disait « Moi, j’ai toujours analysé les choses comme ci ou comme ça, mais on peut les lire autrement », donc on avance ensemble, même avec des chefs qui ont travaillé des partitions à l’endroit, à l’envers !
Pour moi, le défi dans Rosenkavalier, c’est le baron Ochs qui chante en dialecte viennois, et parfois il y a des phrases en dialecte qui glissent tellement rapidement, que je loupe un jeu de scène le temps d’attraper ce qu’il a dit. Ça, c’est mon défi personnel, j’aurais dû mieux étudier l’allemand.

Cherubino (Nozze) Washington, 2010 © D.R.
Quel est le rôle qui vous manque, que vous ne pouvez pas faire ?
Ah, j’aurais aimé chanter Salomé… J’ai même essayé pendant le confinement pour voir si j’en étais capable. Ce qui me pose question, c’est la fin, c’est la tension dans l’aigu et je me demande jusqu’à quel point je serais capable de soutenir la tessiture avec le drame. Dans un salon ou debout face à un chef, vocalement je peux y arriver. Mais sur scène, dramatiquement, est-ce que je ne me mettrais pas en danger ? C’est un rêve depuis que j’ai vingt ans !
Mais ça reste très haut très longtemps, toute la scène finale est dans le haut de la tessiture ?
C’est vraiment tendu, oui, vraiment tendu là-haut, oui. Ça reste un fantasme, je le sais bien. Quand j’étais jeune, je me disais que je finirais ma carrière avec Salomé ! Ce n’est pas réaliste, effectivement ! Après, il y a quelque chose qui ne s’est pas encore produit, mais j’en ai déjà parlé… Parce j’ai travaillé avec des chefs spécialistes de musique ancienne comme Minkowski ou Hervé Niquet… J’aimerais beaucoup faire des Gluck, Iphigénie, Alceste, ces fameux rôles de Falcon qui sont tout à fait accessibles pour moi. Encore faut-il avoir le contact, que le chef ait envie de travailler avec moi… Et il y a de très bonnes mezzos françaises qui les font, je pense à Karine Deshayes qui est vraiment une très grande voix, qui aborde les Bellini, les Donizetti très bien, qui fait très bien ces Gluck. J’attends un peu mon tour et on verra ! Et puis justement, il y a les Bellini et les Donizetti… Je les trouve difficiles à faire, par rapport à Strauss…
Mais vous avez fait Giovanna Seymour dans Anna Bolena, si je ne me trompe ?
Oui, j’ai adoré ça, mais je n’ai pas trouvé que c’était facile ! Je suis sur mes gardes dans ce répertoire. Je peux chanter Strauss malade, à l’endroit à l’envers… Tandis que ce répertoire belcantiste me demande plus d’énergie, de concentration, parce que c’est beaucoup sur le passage. J’ai un passage de soprano, et ça tombe souvent sur une partie de ma voix qui se fatigue davantage. Je n’ai pas encore eu l’occasion de travailler Adalgisa. Comme je le disais tout à l’heure, je peux isoler « Casta Diva ». Et le chanter. Mais quand vous êtes sur scène, il faut le vivre, sur toute la durée de l’opéra. Quoiqu’il en soit, pour le moment, je n’ai pas d’offres dans ce répertoire, je suis dans Strauss, dans Mozart, dans le répertoire français, on verra…
Et puis de plus en plus je vais faire du concert, que ce soit des lieder, Mahler, Chausson, Ravel… Ça m’intéresse beaucoup, peut-être davantage que les grandes héroïnes du bel canto.

Shéhérazade de Ravel en récital à Montréal © D.R.
D’ailleurs votre premier disque, il y a pas mal d’années, c‘était une intégrale Duparc, une belle version avec au piano Daniel Blumenthal, merveilleux pianiste canadien.
J’étais très jeune, je les referais aujourd’hui tout autrement. Je me rappelle qu’avec le réalisateur Michel Stockhem, on se disait, je lui disais que j’étais trop jeune… mais qu’il m’avait dit « Allons-y, on se lance ! »
Il y a là une retenue, une intimité, L’Invitation au voyage, Lamento, c’est très beau..
A l’époque, j’avais trente ans, j’étais plus retenue, je n’avais pas encore tous les aigus, ni les pianissimi que j’ai aujourd’hui, mais j’arrivais à négocier… Ce n’est pas que j’étais mécontente, mais je n’arrivais pas à faire tout ce que j’entendais dans ma tête ou dans mon cœur…
Et donc aujourd’hui vous avez la liberté de faire ce que vous avez en tête ?
C’est quelque chose dont j’ai souffert depuis ma jeune vingtaine ! Comme vous savez, je fais de la musique depuis que j’ai cinq-six ans ; au piano j’avais l’habileté pour réaliser ce que j’avais en tête. Tandis que pour le chant, ç’a a mis des années, et aujourd’hui, c’est ça qui est chouette, j’arrive enfin à chanter les choses comme je les entends ou les ressens. Ou comme les chefs ont envie de les entendre : ils me demandent un truc et je peux dire « Oui, on essaie ! » C’est le bonheur de la quarantaine !

Benvenuto Cellini à Bastille (Ascanio) © ONP Agathe Poupeney
De surcroît, vous avez ce truc inexplicable qu’on appelle la présence… Je me souviens d’un Ascanio de Benvenuto Cellini dans l’énorme mise en scène de Terry Gilliam et vous étiez éclatante…
C’est mon défi, je n’ai pas besoin de rôle-titre, je suis très à l’aise dans mes rôles secondaires, mais je veux rayonner, j’ai mon orgueil et je veux prendre ma place. En l’occurrence, j’avais des directions précises, mais j’avais carte blanche pour ma présence en scène, j’avais des collègues formidables, John Osborn avec qui je m’entends bien.Et puis j’avais beaucoup de confort vocal, il y avait Philippe Jordan, je suis à l’aise dans Berlioz… C’est un opéra qui n’est pas fait souvent. Donc on a moins le trac, parce qu’il y a moins de conventions, moins d’a priori, on se sent libre et moins jugée, vocalement et théâtralement.
Est-ce que ce n’est pas quelque chose qui pèse au-dessus des chanteurs, l’idée de comparaison ?… Les lyricomanes ont toujours en tête des distributions de référence…
Oui, je n’aurais pas supporté d’être un soprano lyrique ou un ténor lyrique ! Chanter Mimi sur scène ou « Che gelida manina »… Je n’aurais pas envie de chanter cela du tout… Je parle souvent avec Frédéric Antoun de la pression qui pèse sur les ténors. Je suis contente d’avoir ce que j’ai. Je me sens comparée souvent, mais ça n’est pas très grave, ça ne m’affecte pas. Moi aussi, j’écoute Janet Baker ou Christa Ludwig et je les admire et les adore, même si certains disent que c’est dépassé, mais je vais aussi écouter des mezzos contemporaines et je suis capable d’admirer leur interprétation.
Je me souviens que sur un réseau social quelqu’un avait mis une interprétation des années soixante, en disant : « C’est fini, on ne retrouve plus ça, ça n’existe plus ! » Et qu’il y a eu tout un débat avec des collègues, disant « Mais ça suffit ! On ne peut pas discréditer tout ce que nous faisons aujourd’hui et depuis vingt ou trente ans. Pourquoi ce qu’on fait aujourd’hui ne serait pas aussi bon que ce qu’on a fait auparavant ? »
Moi, je trouve des qualités dans toutes les voix avec lesquelles je travaille et si j’entends une voix pour la première fois et que ça ne me plaît pas, je sais que quelques jours plus tard je vais lui trouver des qualités, des forces, et que je vais être touchée. Donc je finis toujours avec tous mes collègues par être touchée, je vois leurs forces ou leurs faiblesses. C’est pareil avec moi. Et jamais je ne me dis que je travaille avec un mauvais chanteur ou un chanteur qui n’a rien compris. Il faut aimer ce que l’autre offre. Si quelqu’un est conscient de ses limites vocales, il choisit ses rôles, ses vitesses, ses nuances en fonction de ses limites et alors on a une belle interprétation.

Cenerentola à Lyon © J.-P. Maurin
J’ai vécu un exemple de cela : je chantais une Cenerentola à Lyon, moi qui n’ai jamais été une bonne rossinienne, j’ai toujours été complexée. Mais j’ai fait ce Rossini avec Stefano Montanari qui a su trouver les bons tempis pour moi et, même si ce n’était pas pyrotechnique à la Bartoli, je sortais de mes soirées satisfaite, et je sentais un public satisfait lui aussi, qui ne disait pas « Oh la la, elle ne le chante pas aussi bien ou aussi vite qu’une telle »… Parce que j’ai su faire l’amalgame d’une mise en scène hyper-active avec le chant et avec mon lyrisme, mon legato et mes aigus et ma tessiture qui était toute là… Bon, j’avais travaillé très fort pour faire les colorature toutes égales et ne pas tricher. Mais j’avais eu un chef qui avait perçu où étaient mes forces et où je serais gênée. Lui et moi, on savait la ligne à ne pas dépasser.
Quelquefois la ligne est très fine.
C’est le travail de tous les chanteurs, d’arriver sur scène et d’accepter leurs limites et de ne pas les dépasser. Quand je passais des concours, je ne chantais pas le Compositeur, parce que je n’étais pas encore prête, et quand j’ai passé le Reine Elisabeth, j’ai évité les airs pyrotechniques, j’ai choisi Mahler, Ravel, Mozart… et c’est comme ça qu’on m’a choisie pour les Duparc dont on parlait tout à l’heure. Pour moi c’est ça, la réussite.
J’aime bien cette idée d’apprécier chaque chanteur avec nos oreilles d’aujourd’hui, que chaque chanteur a des qualités pour les auditeurs d’aujourd’hui…
Il faut aller au concert, écouter des chanteurs en direct, ne pas vivre avec ses enregistrements et ses haut-parleurs, se confronter avec des voix, admirer qu’une voix d’opéra puisse emplir une salle, être touché par un son, ne pas s’attarder aux défauts ou aux lacunes, surtout à l’heure du virtuel, il faut aller écouter la musique réelle, sinon on s’en va vers la catastrophe…

L’Heure espagnole à Paris. MeS Laurent Pelly © Svetlana Loboff