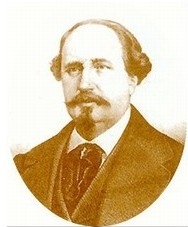L’opéra italien a trouvé son âge d’or dans un fabuleux XIXe siècle où sa vogue tenta même des compositeurs étrangers ! Ainsi, La firme Dynamic nous propose aujourd’hui La Conquista di Granata*, un opéra « à l’italienne » de Emilio Arrieta, compositeur espagnol plutôt connu pour ses nombreuses zarzuelas. A son écoute, la question qui se pose est la suivante : est-il si facile de composer « italien » ou doit-il exister une fibre mystérieusement nationale ?
Pascual Juan Emilio Arrieta Corera est né dans l’ancien royaume de Navarre devenu région d’Espagne, le 21 octobre 1823. Etudiant en Italie dès 1839, il entre deux ans plus tard au Conservatoire de Milan où il travaille avec le compositeur estimé Nicola Vaccaj. Temistocle Solera, curieux personnage de poète-aventurier-agent secret, auteur notamment du livret Nabucco si important pour Giuseppe Verdi, lui fournit le texte de son premier opéra italien, Ildegonda, en 1846, année de son retour en Espagne. Après avoir été le professeur de la reine Isabelle il est nommé Compositeur de la Cour par cette dernière. Le 10 octobre 1850 a lieu la création de La Conquista di Granata à Madrid, sur un texte du même Solera, qui lui prépare également celui d’un troisième opéra italien, Pergolesi, demeuré inachevé. Le Romantisme avait mis à la mode un exotisme dont relèvent ces sujets hispano-mauresques, et du reste dès 1820 le compositeur Giuseppe Nicolini (1762-1842) avait fait créer au Gran Teatro La Fenice, sa propre Conquista di Granata, sur un livret de Luigi Romanelli.
En 1857 Emilio Arrieta est nommé professeur de composition à l’Ecole nationale de musique de Madrid, qu’il dirige ensuite jusqu’à sa disparition, le 11 février 1894. Sa notoriété lui viendra en fait d’une trentaine de « zarzuelas » dont la plus connue est cette Marina (1855) qu’il refondra curieusement en opéra (son quatrième et dernier) en 1887. Du reste on remarque parmi ses élèves Tomás Bretón et Ruperto Chapí qui feront partie des compositeurs de zarzuelas les plus connus.
L’opéra italien dominait le monde culturel au XIXe siècle, de son mélodisme exacerbé et donc les cas de compositeurs non italiens ayant composé dans le style italien abondent. On connaît notamment aujourd’hui le Mexicain Melesio Morales et bien sûr Carlos Gomes, capable d’une force mélodique véritable, et d‘une vitalité aux vives couleurs exotiques indéniables. D’ailleurs, après le triomphe de Il Guarany, on voyait, non par hasard, des caricatures de Gomes en Indien Guarany ! Une puissance mélodique, disions-nous, car à l’écoute des opéras de Gomes, on découvre plus qu’une manière de faire. Ce n’est hélas pas le cas chez Arrieta. Ecouter sa musique procure l’impression que l’on ressent souvent en abordant celle d’un Saverio Mercadante par exemple. On demeure un peu extérieur, en fait, perplexe de ne pas être ravi, ou tout au moins « pris » par ce que l’on entend… Et puis on comprend. Les ingrédients sont présents : l’accompagnement ondoyant des cordes, typiquement romantique ; la harpe brodant délicatement autour de la ligne de chant ; la flûte introduisant le motif de la mélodie mais qui, lorsqu’elle se déploie, laisse curieusement indifférent ! On finit par comprendre la perplexité qui nous étreint : c’est l’inspiration, l’étincelle du génie qui manque, tout est là : n’est pas Donizetti ou Verdi qui veut.
Voilà l’impression que produit la musique d’Arrieta, des façons de faire à la Verdi, mais d’un Verdi ne retenant l’attention, et dépassé même, car ce dernier n’utilisait déjà plus dans son Stiffelio, précisément contemporain de La Conquista di Granata, ces chœurs brusques et syncopés à la Ernani, ces cordes systématiquement vibrantes lorsqu’il y a une tension dans l’action, ces élans un peu stéréotypés qui sous la plume d’Arrieta semblent seulement chaleureux car la mélodie en est quelconque…
Le mélodisme à l’italienne n’est pas uniquement le fait d’indéniables génies nommés Bellini, Donizetti ou Verdi, il faut entendre ce dont sont capables notamment Giovanni Pacini, et pas seulement dans la splendide Saffo (1840), Mercadante lui-même, touché parfois par la grâce, comme dans Le Due Illustri Rivali (1838) ou La Vestale (1840), sans oublier des talents encore moins connus aujourd’hui, comme Alessandro Nini avec La Marescialla d’Ancre (1839) ou Lauro Rossi dans Il Domino nero (1849)… Enfin, tout proches d’Arrieta, Giuseppe Apolloni et son fulgurant opéra L’Ebreo (1855) — l’époque et le lieu de l’action sont ceux de La Conquista ! —, dont certaines « montées » vous donnent un frisson qui arrache les larmes, et Errico Petrella avec sa Jone (1858), mais également L’Assedio di Leida (1856). Que l’on écoute ces curieux fichiers « Midi » où l’on a confié la lecture de la partition de ce dernier opéra au piano informatique à l’ingrate sonorité décharnée… Eh bien, on a la chair de poule à l’audition de ce mélodisme immédiatement touchant et dont on pourrait dire qu’il vibre d’un élan passionnément désespéré hérité d’un Donizetti notamment, car l’Inspiration passe, nous « parle » au travers du piano informatique, c’est dire le pouvoir suggestif de la musique !
Emilio Arrieta
Arrieta n’atteint jamais à cela, et fait encore moins bien, si l’on peut dire. On a ainsi nombre de moments dramatiques non soulignés par une musique suffisamment puissante ou évocatrice. La stretta finale du duo père-fille et Finale de l’Acte I comporte une phrase pleine d’autorité, digne et menaçante à souhait pour le père, mais la fille n’est dotée que d’un motif rapide, certes vibrant mais qui n’a que l’élan (et l’allant !). La mélodie, vide, « n’accroche » pas, malgré un « aigu désespéré à la verdi », c’est-à-dire brusquement hors ligne de chant, comme pour souligner l’exaspération étreignant le personnage à ce moment crucial. Sans être difficile, on ne peut que penser à nombre de Verdi ou Donizetti peu courants qui savent, eux, trouver une mélodie charmant ou tout au moins accrochant l’oreille !
Le Finale Secondo, construit sur le traditionnel concertato ou ensemble concertant semble moderne, en un mouvement au lieu du traditionnel couple largo puis stretta finale, mais dans ce cas il faut une ampleur particulière de la mélodie et de la conclusion orchestrale afin de « faire Finale » ! Au lieu de cela, on en vient à se demander si une stretta ne suivait pas ce largo et si on ne l’a pas coupée. Cela s’est déjà vu… tout arrive dans les résurrections ! Du reste, curieusement, certaines cabalettes d’air ou strettes de duo n’ont qu’une exposition (écriture ? coupure ?) et c’est dommage, surtout lorsque le motif est plaisant, comme dans le duo Zulema-Gonzalvo à l’acte II.
On ne peut enfin passer sous silence le défaut du Finale Ultimo, qui est un hymne à l’ampleur certaine mais dont le motif n’offre pas suffisamment d’impact pour une fin d’opéra, il pourrait se trouver à tout moment, à l’intérieur de l’œuvre, de même la partie orchestrale qui le conclut tourne court, rapidement achevée et non en accord avec l’hommage à la Croix triomphante devant laquelle « tous se prostrent », comme l’indique la didascalie juste avant la chute du rideau.
Cela posé, non par volonté de saboter l’initiative espagnole mais afin de remettre Arrieta à sa place par rapport aux Maestri évoqués plus haut, l’écoute globale de La Conquista di Granata, si elle déçoit, n’est pas déplaisante et certaines subtilités charment même l’oreille. Il y a cette ferveur qui bouillonne souvent, notamment dans les cabalettes qui possèdent un évident élan enflammé à la Verdi. A défaut d’inspiration mélodique, l’orchestration retient l’attention avec de délicates touches de couleur locale arabo-hispanisante, comme les gracieuces volutes de la flûte dans la romance hors scène de Zulema, avant son entrée (Acte I). De même, si la mélodie de l’air ouvrant l’acte III ne retient pas vraiment l’attention, on remarque en revanche l’orchestration avec une belle partie de soliste que tisse la flûte.
L’amateur passionné de melodramma, l’opéra italien de ces florissantes années 1830-60, devra non seulement tenter d’oublier Verdi et Donizetti mais également ignorer Errico Petrella, Giuseppe Apolloni ou Lauro Rossi afin d’apprécier La Conquista di Granata.
Yonel Buldrini
* Lire la critique du disque.