Celui dont on célèbre cette année le centenaire de la mort aura traversé de gigantesques transformations dans le monde, que ce soit en matière musicale, ou plus généralement artistique, sans parler d’un contexte géopolitique plus que complexe. Et pourtant, nul ne niera que la pâte puccinienne, présente dès Le Villi (pour ne parler ici que de ses opéras) est immédiatement reconnaissable tout au long de sa production.
Les dates de naissance et de mort (1858 et 1924) disent assez combien on est passé, en l’espace de moins de 70 ans, d’un monde à un autre. Songez donc : en 1858, l’année de naissance et celle de l’attentat contre Napoléon III, l’Europe sort tout juste de la guerre de Crimée, l’unification italienne n’est pas encore réalisée (elle sera effective trois années plus tard) et, à l’autre bout du parcours, en 1924, l’Europe panse ses plaies du premier conflit mondial et de la pandémie de la grippe espagnole ; Lénine vient de mourir et Mussolini, que Puccini rencontrera en 1923, est premier ministre !
Dans le domaine littéraire on est passé de Jules Verne (il publie son Voyage au centre de la terre en 1864) à Jean Cocteau et Raymond Radiguet (Le Diable au corps date de 1923) en passant par Marcel Proust (Le Côté de Guermantes date de 1920). En peinture, d’Edouard Manet et Edgar Degas à Amedeo Modigliani, en passant par la période « bleue » de Pablo Picasso. A noter aussi que le mouvement réaliste pictural (les premiers chefs-d’œuvre de Gustave Courbet datent des années 1850) va précéder de peu son pendant dans l’opéra, le vérisme.
Gustave Courbet : Autoportrait (Collection privée)
Quand le petit Giacomo, cinquième de huit enfants, vient au monde le 22 décembre 1858 à Lucques, Jacques Offenbach crée son Orphée aux Enfers. Il naît dans une famille de musiciens ; chez les Puccini, on est organiste à San Martino de père en fils. C’est l’époque où, pendant les offices, tout était jouable, y compris des pastiches de « Questa o quella » (Rigoletto) ! Et quand il prend ses premiers cours, Carlo Angeloni, son professeur de piano, lui fera découvrir les partitions de Rigoletto, Trovatore, Traviata. N’oublions pas que lorsque Verdi achève sa « trilogie populaire », Puccini n’a que cinq ans.
Petite incise sur les relations entre les deux géants italiens : Puccini, qui était le cadet de Verdi de 45 ans, ne l’a rencontré que deux fois, deux rencontres qui ne laisseront pas de souvenir durable (sorte de rendez-vous raté entre deux génies, un peu comme celui entre Goethe et Beethoven en juillet 1812). On a supputé un complexe d’infériorité face au monument italien. En février 1887, Puccini, retenu à Trieste, manque de peu la première d’Otello à Milan, mais y revient quelques semaines plus tard. Comble de malchance, en 1893, La Scala étant totalement absorbée par la préparation de Falstaff, la première de Manon Lescaut doit être déplacée à Turin.
En attendant et pendant que le jeune homme se forme, l’opéra commence à sortir de ses gangues romantiques. Le mouvement artistique dit de la « scapigliatura », que l’on peut traduire par « bohème » (« scapigliati » désigne des cheveux en bataille) trouve en Boito, Catalani ou Ponchielli (que Puccini rencontrera en 1880) ses plus éminents représentants. Autrement dit, pendant que Puccini se forme, d’autres travaillent à défricher un terrain neuf que lui-même empruntera rapidement : « La Bohème » (la bien nommée) date de 1896. La « scapigliatura » est un mouvement, né à Milan vers 1860, que l’on pourrait définir comme le refus de tout ordre établi ; il s’érige contre la culture bourgeoise dominante. Musicalement, le point principal dans l’opéra est l’abandon de toutes les « pezzi chiusi », les numéros fermés.
Toutefois, les premières influences sont incontestablement celles du maestro Verdi ; à peine revenu des représentations de son premier opéra Le Villi, à Trieste, Puccini se précipite à La Scala pour assister à ce fameux Otello. Il en tirera des leçons ; la représentation terminée, il rentre chez lui, reprend la plume pour retravailler l’orchestration d’Edgar, dont l’achèvement est ainsi retardé, et qui ne sera finalement donné qu’au printemps 1889 à la Scala. Puccini y aura travaillé quatre ans et la première est un échec. Mais l’évolution depuis Le Villi est patente ; Puccini, en adepte de la « scapigliatura », abandonne la démarcation rigide en arias, récitatifs et duos.
Une autre influence marquera aussi ses premières années de créateur. Wagner, né la même année que Verdi, même s’il ne jouit pas, et de loin, de la même aura que l’enfant de Busseto en Italie, est au sommet de son art quand Puccini le découvre. Déjà dans Le Villi il faut voir dans l’importance de l’élément orchestral (notamment dans les intermèdes, fréquents dans l’œuvre de Puccini), une prise en compte croissante de la musique de Wagner : dans Edgar également, où le chromatisme tient une place non négligeable. En janvier 1890, il assistera à Milan à une version abrégée des Meistersinger von Nürnberg, désertée par les Milanais accablés par une épidémie de grippe. Et en 1912, il assistera à une représentation de Parsifal à Bayreuth.
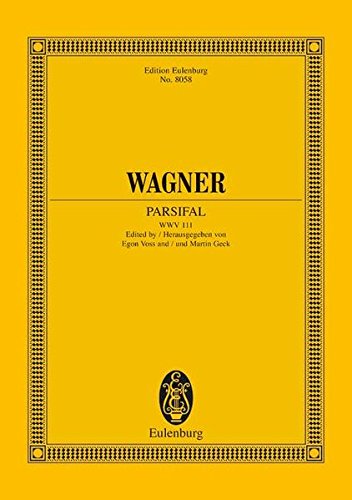
Mais dans ce début des années 1890, il y a aussi la montée en puissance du vérisme. Cavalleria rusticana de Mascagni est créé à Rome en mai 1890 et c’est un triomphe : l’action est réduite à l’essentiel, les sentiments ruissellent et le fleuve orchestral wagnérien submerge tout, sans pour autant trahir les aspects lyriques et mélodiques incontournables. Mascagni, le Bizet italien, comme on l’appelle, est au faîte de sa gloire : il a compris ce que réclame le public.
En mars 1893, Puccini et Leoncavallo se retrouvent dans un café fameux de la Galleria à Milan et découvrent qu’ils travaillent sur le même sujet : La Bohème. Leoncavallo est furieux et organise une compétition par communiqués de presse interposés. Plus tard, Giacomo dira que s’il avait su que le maestro Leoncavallo travaillait sur la même pièce que lui, il n’aurait pas composé La Bohème. Du reste sa Bohème n’est pas très bien reçue, au contraire de celle de Leoncavallo qui triomphe. Qui plus est, les Milanais lui préfèrent également Giordano, autre grand vériste, et son Andrea Chénier.
Mais la notoriété de Puccini ne cesse de croître et il est appelé à monter ses opéras dans les plus belles maisons italiennes. Très vite, ceux-ci rencontrent un succès international et Puccini voyage pour assister aux représentations – souvent en langue étrangère, comme il se devait à l’époque. Angleterre, Allemagne, Suisse, Autriche, Hongrie, Egypte, Argentine et puis, plus tard, la consécration américaine. Son premier voyage parisien se situe en 1897, de retour d’Angleterre. C’est l’occasion de côtoyer quelques-uns de ses plus brillants contemporains français : il rencontre Zola (dont il songera à adapter La faute de l’abbé Mouret), Daudet (il a longtemps pensé à un Tartarin) et bien sûr Victorien Sardou. On aurait aimé être témoins de cette rencontre qui portera l’un des plus beaux fruits de la panoplie puccinienne : Tosca. Deux ans plus tard, Félix Faure, le Président de la République française lui remet les insignes de Chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur. Toujours à Paris, mais bien plus tard, en avril 1913 il assistera à l’une des premières représentations du Sacre du Printemps au Théâtre des Champs Elysées : « chorégraphie ridicule et cacophonie extrême. Intéressante néanmoins et réalisée avec un certain talent. Mais dans l’ensemble un truc de dingues » écrira-t-il ! On ne ressentira pas moins l’influence de Petrouchka dans le thème de la valse du joueur d’orgue de Barbarie dans Il tabarro.
Revenons à 1897, qui est aussi l’occasion de la première rencontre avec un jeune ténor de 24 ans, fraîchement engagé pour interpréter Rodolfo à Livourne : Enrico Caruso. Ce n’est pourtant pas le divo napolitain qui créera le rôle de Mario à Rome en 1900 mais Emilio de Marchi. De même Arturo Toscanini, qui devient vite complice de Puccini, est approché pour diriger la première de Tosca : « Souviens-toi, mon bel Arturetto, que c’est toi qui doit dépuceler Tosca », lui écrit-il dans son langage à tout le moins fleuri et qui pouvait rapidement tourner au scatologique. Mais Toscanini est très occupé à Milan et c’est Leopoldo Mugnone qui dirigera la première le 14 janvier 1900 au Teatro Costanzi de Rome. Toscanini assurera la première milanaise le 17 mars. Tosca restera le seul opéra de Puccini inscrit dans un contexte historique avéré.

Les années passent et la notoriété de Puccini ne fait que croître, malgré ici ou là quelques soubresauts ; ainsi le fiasco de la première de Madama Butterfly à Milan, le 17 février 1904, victime sans doute d’une forme de cabale d’éditeurs. Toujours est-il que Butterfly restera son échec le plus important. Dès le lendemain de la première, l’opéra est retiré de l’affiche et la reprise romaine est annulée.
Qu’à cela ne tienne, en 1906 Puccini est encore en voyage à l’étranger. Cette fois il est à Budapest, pour des représentations en hongrois (!) de Bohème, Tosca et Butterfly entre temps réhabilité et… réécrit aussi (il baptisera l’un de ses yachts Cio-cio-san !) et, sur le chemin du retour, il s’arrête à Graz pour assister à une représentation du Salome de Richard Strauss. Représentation qui le marquera fortement : « il y a des tonalités orchestrales magnifiques, mais qui finissent par me fatiguer », écrira-t-il au sujet d’un opéra qu’il reverra à chaque fois qu’il en aura l’occasion, notamment à Naples en 1908, sous la direction du compositeur.
En 1910 c’est la consécration américaine. Il embarque au Havre sur le « Georges Washington » en compagnie des éditeurs Ricordi père et fils et occupe comme il se doit une suite impériale. Le triomphe new-yorkais de La fanciulla del West est absolu : Puccini est rappelé 50 fois sur scène à l’issue des trois actes. Toutefois, la musique dans laquelle l’influence debussyste est revendiquée par le compositeur lui-même, désarçonne la critique, qui est partagée. L’orchestre est un personnage à part entière et c’est peut-être le plus intéressant. Puccini joue de plus en plus avec la tonalité. Notons que cinq ans seulement séparent cette pièce du premier quatuor de Schönberg, dans lequel la tonalité est suspendue. Puccini veut clairement s’insérer dans la modernité, celle de Strauss et de Debussy. Notons que la mort de ce dernier, en 1918, affectera fortement Puccini. Il ressent le besoin de se dépasser, de trouver une sorte de compromis entre la tradition lyrique italienne et le symphonisme allemand. Ce faisant, il déçoit son public qui attendait davantage de bel canto. Rapidement La fanciulla del West sera mise de côté. Plus tard, en 1918 toujours à New York, Il trittico, premier ouvrage créé en l’absence de l’auteur, recevra un accueil mitigé.
Alors qu’en 1914 la guerre éclate, le positionnement de Puccini est ambigu. Une prise de position anti-germanique pourrait lui valoir des annulations en Allemagne et surtout à Vienne qui lui a commandé La Rondine (au final cette pièce sera créée en terrain neutre, à Monte-Carlo). Il retournera toutefois à Vienne en 1923 pour la première de Manon Lescaut au Wiener Staatsoper ; malheureusement, l’interprète de Manon, une certaine Lotte Lehmann, âgée alors de 35 ans, tombe malade, et la première doit être reportée.
Son attentisme, à la veille de la première guerre mondiale, lui vaudra d’être vu en France et en Italie comme un ami de l’Allemagne et comme un ami du peuple allemand dans les pays de l’Alliance. En 1922, il écrira à Adami : « Et Mussolini ? Qu’il soit le bienvenu s’il peut rajeunir et donner un peu de calme à notre pays ! ».
En 1924, peu de temps avant sa mort, Puccini se rend à Florence pour assister à une représentation du Pierrot lunaire. A la fin du concert, il échange quelques mots de circonstance avec Arnold Schönberg. Sans doute se rend-il compte qu’avec cette pièce, plus encore qu’avec la musique de Stravinski et Debussy qu’il connaissait bien, une révolution est en cours à laquelle la sienne ne participera jamais. Un cycle se termine, le cycle du mélodrame à l’italienne, qui est en train de s’éteindre. Cycle qui trouve une conclusion avec Turandot qu’il laissera d’ailleurs inachevé, puisque son cancer de la gorge l’emporte le 29 novembre 1924, à Bruxelles. La première de Turandot, aura lieu à la Scala le 25 avril 1926. A la baguette, Arturo Toscanini qui arrête la représentation après la scène la mort de Liù : « C’est ici que le maestro est mort », adresse-t-il à la foule silencieuse.
La version intégrale, complétée par Alfano, sera donnée triomphalement le lendemain.









