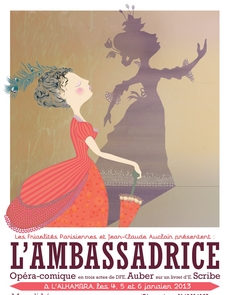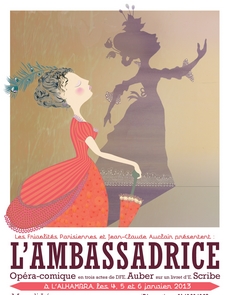Autant les codes d’interprétation et de représentation des opéras baroques sont aujourd’hui globalement déchiffrés, autant ceux des opéras-comiques du XIXe siècle attendent de l’être. Dans ce travail d’archéologie musicale, chaque découverte compte. L’Ambassadrice en est une. Créé en 1836 à Paris, l’ouvrage avait disparu de l’affiche depuis 1873. L’auteur du livret, Eugène Scribe (1791-1861) est une des figures de proue du théâtre français de l’époque. Le compositeur, Daniel François Esprit Auber, (1782-1871), appartient à cette lignée de musiciens dont on prend souvent à tort l’élégance pour de la légèreté. Leur association a fait tinter les tiroirs-caisses des théâtres parisiens. Citons ne serait-ce que La Muette de Portici, cet opéra que Wagner trouvait « plein de chaleur et de feu et intéressant jusqu’à enthousiasmer ».
Moins connue, L’Ambassadrice raconte l’histoire d’Henriette, prima donna de l’Opéra de Munich adulée du public, qui renonce aux planches pour épouser l’ambassadeur de Prusse, le duc de Valberg, avant de réaliser combien elle faisait fausse route et d’abandonner toute idée de fortune et de mariage pour se consacrer entièrement à son art*. Charmante histoire qui ne se contente pas d’être bien ficelée : tous les personnages possèdent une épaisseur dramatique ; fantaisie, satire et sentiments se confondent selon une recette bien française ; et le procédé du théâtre dans le théâtre sur lequel repose le dernier acte n’est pas si fréquent à l’opéra. Le deuxième acte avec sa leçon de chant, son trio et son duo mélancolique rappelle l’un des fleurons du genre, La Fille du régiment. On peut d’ailleurs s’amuser à établir une correspondance entre Henriette et Marie, Benédict et Tonio, Fortunatus et Sulpice, la comtesse de Fierschemberg et La Marquise de Berkenfield ; correspondance trop évidente pour qu’il n’y ait pas eu, sinon imitation du moins inspiration, de la part de Donizetti et ses librettistes.
Musicalement, la partition comprend plus d’ensembles que d’airs. Sans posséder la dimension parodique que les répétition et représentation d’opéra à l’intérieur de la pièce rendaient possible et dont un compositeur comme Offenbach aurait fait son miel, la musique est d’un caractère égal avec de nombreuses richesses mélodiques. L’écriture, savante, se pose à cheval entre le style galant du siècle précèdent et Rossini dont l’influence est perceptible à travers la virtuosité requise et certaines formules rythmiques.
En exhumant un tel ouvrage, conçu pour des interprètes rompus à ce répertoire en un temps où le genre faisait florès, Les Frivolités Parisiennes n’ont pas choisi la facilité. Il reste beaucoup à prospecter pour retrouver ces codes perdus que nous évoquions plus haut. La metteuse en scène, Charlotte Loriot, commence ici à mettre en application le fruit de ses recherches sur la scénographie de l’époque sans que l’on en perçoive encore clairement les caractéristiques. A noter l’utilisation astucieuse du rideau de scène au 3e acte pour figurer le théâtre où se déroule l’action.
La distribution, équilibrée, comprend des chanteurs venus d’horizons différents. Jean-François Novelli, Bénédict attachant, est un passionné de musique baroque, qui a remporté le premier prix du concours Sinfonia en 1997 avec Patricia Petibon et l’ensemble Amarillis. Christophe Crapez (Le Duc), transfuge de la Compagnie Les Brigands, a pas mal roulé sa bosse du côté d’Offenbach. On ne présente plus Magalie Léger (Henriette), nommée dans la catégorie « Révélation » des Victoires de la Musique en 2003, qui a beaucoup œuvré pour le répertoire français, au sens large, en tant que soprano léger et dont la voix semble avoir gagné en lyrisme ce qu’elle a perdu en facilité dans l’aigu. Il y a aussi de jeunes talents en devenir : le baryton sonore et timbré de Guillaume Paire (Fortunatus) et Estelle Lefort (Charlotte) dont on avait déjà remarqué le tempérament dans Mon Bel Inconnu Salle Favart en janvier 2011. Autant de styles qui demanderaient à se fondre en un seul pour retrouver les fondements d’une école de chant dont la virtuosité et l’art d’orner sont deux des composantes, inspiration rossinienne oblige. Autre élément essentiel, la prononciation pourrait être encore plus affirmée. Mais l’effort pour négocier avec le plus de naturel possible le passage du parler au chanter, l’un des écueils du genre, est déjà remarquable.
A la direction d’orchestre, Mathieu Romano fait preuve d’un métier certain : pas de décalage malgré la complexité des ensembles, une attention de chaque instant aux chanteurs et dans sa lecture de la partition, un entrain qui nous donne à ressentir tout ce que cette musique contient de promesses. Souhaitons que Les Frivolités parisiennes transforment ce joli coup d’essai pour une prochaine fois toutes les tenir.
* Le premier acte voit Henriette dans sa loge répéter son prochain opéra, sous l’œil bienveillant de sa tante Mme Barneck. Auprès d’elle se pressent ses amis, le ténor Bénédict et la coquette Charlotte, ainsi que leur imprésario Fortunatus. Demandée en mariage par son plus fidèle admirateur, Henriette hésite puis accepte dès qu’elle apprend le titre et la fortune de son prétendant. Il s’agit du Duc de Valberg, l’ambassadeur de Prusse. Le deuxième acte nous transporte à Berlin. En attendant l’autorisation royale d’épouser son amant, Henriette chaperonnée par sa future belle-sœur, la comtesse August de Fierschemberg, se morfond. L’Ambassadeur est en mission depuis 3 mois à Vienne et la jeune femme, recluse dans son palais, doit, pour ne pas le compromettre, faire croire qu’elle est issue de la plus noble extraction. Il lui est même interdit de faire de la musique. Peine perdue, l’arrivée inopinée de ses anciens camarades, en tournée à Berlin, vient révéler la supercherie. Entretemps, Charlotte est devenue prima donna et le duc, dont la frivolité n’a d’égal que le rang, la courtise de manière éhontée. Accablée, Henriette décide de se venger. Le dernier acte se passe à l’opéra. Charlotte, prétextant un enrouement pour ne pas chanter, a rejoint en cachette le duc dans sa loge. L’annonce de son remplacement par une soprano venue de Paris suscite la curiosité. C’est Henriette qui a repris sa place de prima donna et que le public acclame. En la revoyant sur les planches, l’amour du Duc renait. Trop tard, la cantatrice a compris la leçon. Elle abandonne toute idée de fortune et de mariage pour se consacrer entièrement à son art.