Remaniement du Maometto secondo de 1820, Le Siège de Corinthe constitue en 1826 la première contribution de Rossini à ce qui sera plus tard appelé le grand opéra à la française, soit une oeuvre mobilisant toutes les ressources artistiques et techniques d’un grand théâtre pour une représentation à grand spectacle. Cette ambition étant hors de portée des moyens financiers du festival de Bad Wildbad, ville d’eaux où Rossini vint en cure, c’est la version de concert qui s’est imposée. Etait-il alors pertinent de maintenir la musique du ballet ? Sans doute est-elle plaisante à entendre, avec ses échos du Comte Ory, mais elle fait regretter plus vivement une version scénique. Quant à la révision opérée par Jean-Luc Tingaud, qui consiste essentiellement à modifier l’ordre de certains numéros au deuxième acte, l’évidence de sa nécessité musicale ou dramatique ne s’est pas imposée à nous.
L’exécution, pour l’essentiel, est satisfaisante. Passons sur les prestations de Marco Filippo Romano et de Silvia Beltrami, respectivement Omar et Ismène ; la qualité de la voix du baryton n’est pas en cause, mais ni lui ni la soprano, aux inflexions de soubrette, ne chantent clairement le français. Le jeune ténor Gustavo Quaresma Ramos s’en tire un peu mieux dans le court rôle d’Adraste. On voudrait en dire autant de Marc Sala, à la prestance irréprochable dans le rôle de Cléomène, créé par Louis Nourrit, mais il n’est pas toujours intelligible en dépit de ses efforts et surtout il chante souvent du nez. Il souffre évidemment de la présence à ses côtés de Matthieu Lécroart, le seul Français de la distribution ; avec son émission et sa diction nettes il semble arriver de la rue Le Peletier, et il donne ainsi au rôle de Hiéros son vrai poids de gardien des traditions. Aux prises avec les chausse-trapes de Néoclès, créé par Adolphe Nourrit, Michael Spyres s’en tire avec les honneurs ; non seulement il articule, module et phrase avec clarté et musicalité mais il surmonte les écueils de l’écriture tendue et son air du troisième acte lui vaut un triomphe mérité. Sa Pamyra a été appelée pour suppléer aux défections successives de deux autres soprani ; familière du répertoire des années 1800-1850, Majella Cullagh a appris le rôle très vite ; est-ce pour cela qu’elle semble sur ses gardes, ne se « lâchant » que progressivement ? Son français est bon mais la voix sonne petite et si les agilités sont exécutées sans problème majeur on effleure les limites de l’extension dans l’aigu ; néanmoins une prestation de qualité. Rossinien émérite, Lorenzo Regazzo a déjà incarné Mahomet dans la version italienne avec succès ; pour lui aussi l’intelligibilité du français est bonne, et comme la tessiture du rôle ne lui pose aucun problème il peut se concentrer sur une interprétation vocale qui cisèle les facettes du personnages, guerrier conquérant, amoureux attendri, vainqueur généreux, autocrate intransigeant, avec le soin et la justesse qui en font un artiste accompli.
Partenaire important des solistes, le chœur. L’effectif réduit du Camerata Chor Bach fait des merveilles, tant sur le plan du texte que sur celui des accents et de la musicalité. L’orchestre des Virtuoses de Brnö, au sein duquel se détachent les prestations des harpes, hautbois et cors, obéit de son mieux à la direction attentive et claire de Jean-Luc Tingaud. Malgré une baisse de tension au deuxième acte, la tragédie file bon train et le final déchaîne les acclamations d’un public apparemment ravi de ce qui était pour beaucoup une découverte, à porter à l’actif du Festival.


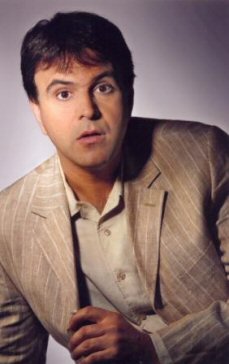
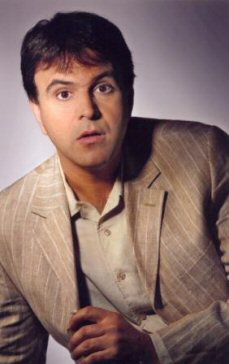



 : Supérieur aux attentes
: Supérieur aux attentes



