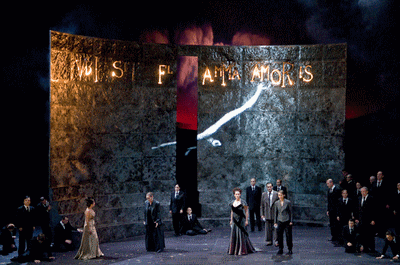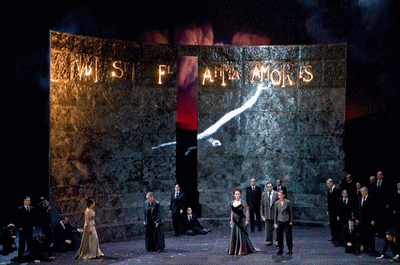…C’est ce qui est écrit au fronton du palais de Titus dans la production que l’Opéra de Lyon donne actuellement de l’œuvre de Mozart. Et c’est tellement vrai ! Tellement adapté à cette histoire qui, finalement, traite plus de cette lancinante question de l’amour, des amours en fait – amour passion, pouvoir de l’amour et amour du pouvoir – que de l’acte de clémence final qui semble plus là – et je soupçonne que ç’ait été, aussi, un peu le point de vue de Mozart – pour répondre aux besoins de la commande que comme démonstration à valeur moralisatrice.
La mise en scène de Georges Lavaudant joue ce jeu de l’amour, de ce marivaudage en accessoires historicisants. Bref, il montre – et avec quel talent – que Mozart n’a pas interrompu sa réflexion sur les ravages des passions dans le cœur des hommes – à prendre au sens large, avec un grand « H » – après Cosi. Il révèle un talent de directeur d’acteurs assez impressionnant, maîtrisant les regards, les gestes, les déplacements ; on se dit même que ce Lavaudant a demandé à ses acteurs/chanteurs a dû influer sérieusement sur les considérations strictement musicales – voir, par exemple le premier air de Vitellia, détaillé, félin, coulé avec la légèreté, la sinuosité de l’aspic.
Avec cela, le metteur en scène est aussi un décorateur extraordinaire qui suscite des visions d’un esthétisme très délicatement signifiant, comme c’est le cas du magnifique miroir au tain délavé, zébré de fêlures dans lequel se diffractent Vitellia et Sesto au I. Bref, on aime le palais de Titus avec ses larges plaques de métal martelé qui pourrait être une architecture de n’importe quel régime totalitaire des années 1930 – d’ailleurs n’est-ce pas un peu le but ? On aime, l’immense saule du II, entre Böcklin et Magritte. On aime les thermes du II, encore, avec leur longue perspective et leurs rideaux qui se tordent, se cuisent, se déchirent au fur et à mesure de l’action. On aime, aussi, les projections virtuoses qui dilatent l’espace, accompagnent la narration. C’est bon d’aimer, aussi !
On peut, en revanche, être en désaccord avec l’image qui est donné du personnage de Tito. On peut se dire que cet empereur cyclothymique, névrosé, régressif aussi – l’image du nounours fait rire les spectateurs ; c’est tout dire – ressemble plus à Caligula ou à Néron qu’au modèle de pondération qui a été choisi pour le couronnement de Leopold II. Mais on touche là à cette notion d’amour du pouvoir – « Que me resterait-il si je perdais encore ces seuls moments de bonheur que je trouve à secourir les opprimés […] à récompenser le mérite et la vertu ? » ; à cette idée, aussi, qu’un homme qui fait acte de clémence est, toujours, un homme qui éprouve l’absence de limites qui est attachée à l’exercice de son pouvoir, justement. Donc, on a le droit de ne pas adhérer mais on reconnaîtra au moins à Lavaudant de très bien défendre son point de vue.
Et en plus, musicalement, on flirte avec les cimes.
Il faut d’abord parler de la direction de Jérémie Rohrer qui convainc beaucoup plus qu’elle n’avait pu le faire, à Lyon déjà, lors de la tournée de promotion de l’album « Arie di bravura » de Diana Damrau. Il faut dire – et j’en suis bien désolé – que cette fois le chef ne dirige pas son orchestre sur instruments anciens mais celui de l’Opéra de Lyon, qui en termes de son et de qualité d’exécution n’appelle aucune réserve – un cuivre dissonant, c’est réellement une toute petite paille. Quant à Rohrer il apparaît indéniablement plus pondéré, choyant chaque famille de l’orchestre – les bois surtout et ce n’est que justice dans cet opéra particulièrement, ne serait-ce que pour les deux airs concertants, extraordinaires. Une réserve peut-être tenant à la gestion de l’équilibre fosse/plateau, la première submergeant parfois le second – c’est vrai des nuances très délicatement posées de Vitellia dans ses deux airs qui passent mal la rampe. Mais là encore, ce n’est qu’une paille. Comme pourrait l’être la manière dont Rohrer disloque – de manière éminemment théâtrale il est vrai – le cadre des deux airs concertants, en jouant le jeu du ralentissement de la section centrale jusqu’à quasiment scier le discours en deux. C’est on ne peut plus vrai des « A questo sguardo solo » dans « Parto ! Ma tu ben mio » ; mais comme l’intention est d’un vrai, bon chef de théâtre…
Lequel est excessivement bien secondé par ses chanteurs qui vont du bon – voire très bon – à l’excellent. Au rayon des bonnes voix saines et bien menées il faudra compter les comprimarii – pardon pour eux – en l’occurrence Judith Van Wanroij et Nicolas Testé auxquels échoit la redoutable tâche de faire exister des caractères par ailleurs très secondaires – Servilia c’est quoi, en fait, à part un duo un final et un air, délicat mais sans plus ?
Et on monte ensuite la pente de l’excellence. Avec l’Annio tourmenté, mais si franc, sans calculs ni arrière-pensées de Renata Pokupic, d’abord. Avec le fabuleux Sesto de Ann Hallenberg, ensuite. Elle porte le travesti plutôt pas trop mal ; mais elle le chante encore mieux. Et même mieux que mieux avec une voix à la chair palpitante, nourrie ; avec, aussi, des colorations fines, des dégradés subtils dans la dynamique – le trio « Se al volto mai ti senti » d’abord, et évidemment ses deux airs avec une petite mention à « Deh per questo istante solo » qui balaie d’un pinceau large toute la gamme des affects. Alexandrina Pendatchanska tutoie les mêmes hauteurs, bouleversante parce que tout sauf monolithique. Le portrait est savamment décliné sur tous les modes : furioso, amoroso, pentito… Et la voix est menée royalement, malgré ce que l’on devine, parfois, d’anarchie dans la gestion des registres – ces derniers n’étant finalement exposés que dans les grands moments de fureur, bref, là où cela dérange le moins. La projection est tétanisante, comme les graves – même tubés – de vrais beaux graves de mezzo « colorature », chauds, avec juste un soupçon de raucité pour réellement impressionner !
Une réserve alors ? La même que celle concernant la mise en scène : le personnage de Titus, donc. Andrew Kennedy joue à fond la carte du tyran cyclothymique ; à la fois monstre et ami. Bien sûr cela peut déplaire – et, audiblement, cela a manifestement déplu à certains – mais là encore, le parti est plutôt pas mal assumé avec de la ressource vocale – superbe épure de « Ah, no sventurato non sono contanto » – quand bien même la voix n’est pas ce que l’on a entendu de plus beau – un peu quelque chose entre Schreier et Van Rensburg.
Cela dit ces réserves ne restant que des réserves – et encore, formulées uniquement dans l’optique de l’avocat du diable ; en somme juste pour trouver quelque chose à dire ! – il s’avère que ce spectacle est objectivement l’un des plus complet et donc des plus complètement satisfaisants qu’ait présenté l’Opéra de Lyon ces deux ou trois dernières saisons.