Y a de l’idée ! C’est le sentiment qui nous habite au sortir de cette très belle production du Bal masqué de Verdi. Pour sa mise en scène, Johannes Erath a choisi un décor spectaculaire qui place le lit au centre du plateau comme enserré par un immense escalier circulaire s’inversant pour atteindre un plafond où l’on trouve le même lit, prophétique cette fois-ci, avec une Amelia prostrée puis le cadavre de Riccardo. Les costumes années 20 sont riches et élégants, et la direction d’acteurs astucieuse et rythmée par la musique. La gestion des chœurs notamment est particulièrement brillante (arrivant à reculons, passant en procession, s’étripant entre maris jaloux et femmes attirées par Riccardo), et l’usage de figurants pour doubler les personnages très efficace (Amelia qui voit son double avec son enfant dès le premier acte, ou Renato qui se revoit mener sa femme au foyer après leur mariage pendant sa grande scène). L’idée de départ est simple : ce n’est pas une tragédie mais un drame domestique, son épicentre est donc le lit conjugal. Cela fonctionne magnifiquement lorsqu’Amelia lance son « Ecco l’orrido campo », sortie par un cauchemar du lit où dort encore son mari Renato. Le metteur en scène twiste même parfois le drame avec bonheur lorsqu’il fait révéler à Oscar sa véritable identité féminine lors de son dernier air, le masque des personnages n’est pas toujours là où on l’attend. A côté de ces réussites, d’autres choix sont plus difficile à décoder : Ulrica n’est plus une sorcière mais une vamp de films noirs qui hante la maison comme une grande faucheuse (ce qui l’éloigne trop de sa position intermédiaire de devineresse) ; le lit est tantôt celui de Riccardo (au I et au III), tantôt celui de Renato (au II), les deux partageant la même robe de chambre Hokusaï ; Amelia est sur le point d’étouffer son mari dormant avec un coussin (mais si le personnage flirte avec la faute, c’est aller trop loin que lui prêter des intentions criminelles) ; les conjurés jettent à terre le billet qui leur permettrait d’être tirés au sort pour le meurtre ; le bal final n’est pas masqué (on a du mal à comprendre tous les échanges permettant aux uns et aux autres de s’identifier du coup) ; Riccardo voit finalement son double mourir avant de gravir l’escalier avec Ulrica et chacun de reprendre le bal comme si rien ne s’était passé. Tout cela ressemble à des intuitions qui n’ont pas été portées assez loin pour prendre tout leur sens sur scène. L’ensemble est cependant très travaillé et de haute tenue, maintenant constamment l’attention du spectateur dans une atmosphère dominée par la mort sans parasiter son écoute.

© Wilfried Hösl
Et il y avait de très belles choses à entendre ce soir-là ! En Oscar, Sofia Fomina fait montre d’un très grand naturel en scène mais manque d’aigus et, peut-être, de technique belcantiste pour rendre justice à ses airs virtuoses tout en s’intègrant bien dans les ensembles. L’Ulrica d’Okka von der Damerau manque, elle, de graves, mais la mezzo poitrine avec beaucoup d’élégance et sa robe fourreau de femme fatale lui sied comme un gant. Franco Vassallo campe un Renato impressionnant d’autorité et de style. Pas très à l’aise en scène, l’acteur se révèle après l’entracte, au point même de cabotiner en appuyant un peu trop certains points d’orgue. Piotr Beczala fut égal à lui-même, très généreux sur tout l’ambitus, très sensuel aussi, ce qui est loin d’être accessoire pour ce rôle, mais n’a pas réussi à éviter un très audible couac dans la dernière scène à laquelle il arrive épuisé. Il reste tout de même un Riccardo très attachant et bien chantant, ses dérapages signalant surtout une grande prise de risque. La reine du bal fut sans conteste Anja Harteros : le timbre, que l’on peut trouver ingrat, semble constamment transfiguré par une expressivité ardente et des aigus fulgurants qui font tout le charme de cette rare héroïne verdienne, victime de ses propres penchants et non d’une force extérieure. Que ce soit pour évoquer l’apparition d’un cadavre sortant de la tombe ou pour prier son mari de revoir leur enfant une dernière fois, elle trouve des accents immédiatement touchants et justes, sans jamais tricher avec une partition hérissée de difficultés.
Daniele Callegari à la tête d’un rutilant Bayerisches Staatsorchester offre un vision très cinemascope de l’œuvre qui colle parfaitement avec la mise-en-scène. Les traits de corde sont souvent trop nets et les ambiances manquent parfois de mystère mais les ensembles menés tambour battant avec beaucoup de contrastes sont une vraie réussite. Sa direction permet aux chanteurs comme au chœur (qui ne le regardent pas toujours dans cette production) de donner le meilleur d’eux-mêmes.










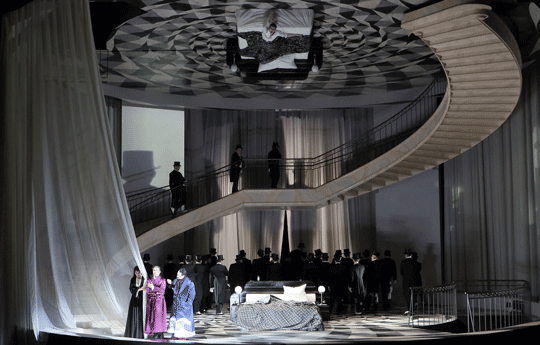
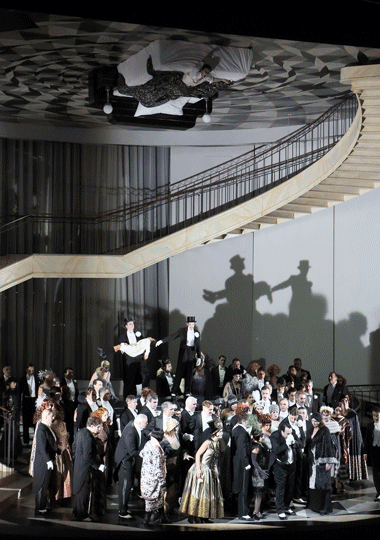



 : Supérieur aux attentes
: Supérieur aux attentes

