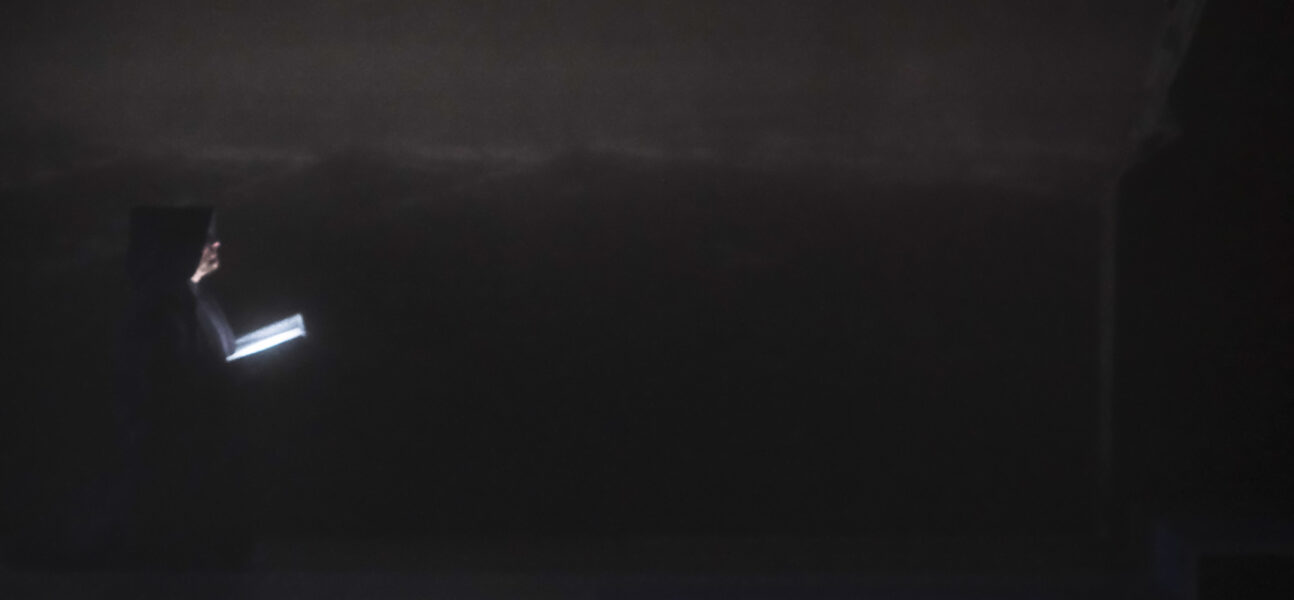La démonstration est désormais achevée, et de quelle manière ! La déambulation chronologique à laquelle Michael Spyres nous invitait dans son dernier album récital, qui tissait tous les liens stylistiques et interprétatifs dans de grandes pages du répertoire belcantiste et romantique en droite ligne vers Wagner, trouve à Strasbourg un incarnation tout à fait convaincante. Balayées les interrogations autour de l’endurance du ténor américain, sorti du confort du studio ! Le Lohengrin qu’il propose s’avère vitaminé dans tous les sens du terme : puissance confortable, projection irréprochable, legato et souffle qui rafraîchissent l’interprétation wagnérienne. Bien entendu, le cocon de l’Opéra national du Rhin et l’œuvre elle-même sont des choix judicieux pour tenir le pari. On ne va pas bouder son plaisir d’entendre un chevalier du Graal ainsi gorgé de nuances et dont les affects épousent les scènes. Que Lohengrin tempête, pavoise ou courtise, Michael Spyres lui prête la juste voix. A ses côtés, Edwin Fardini se fait remarquer en héraut stentor, quand Timo Riihonen donne à Heinrich des accents paternels bienvenus (malgré une prononciation allemande exotique). Josef Wagner déçoit quelque peu après son Barak lyonnais superlatif en début de saison. Il faut dire que Telramund mobilise davantage le spectre supérieur de son ambitus et représente une tout autre écriture rythmique. Toutefois, le baryton déploie toujours une ligne élégante qui demande à gagner en robustesse et en noirceur.
Las, le plateau féminin ne se hisse pas à la même hauteur. Johanni van Oostrum reçoit des éloges réguliers depuis son apparition dans le rôle à Munich. On s’interroge aujourd’hui : le chant est monotone et le portait sommaire. Son Elsa, dépeinte comme une petite chose fragile, n’évolue guère pendant les deux premiers actes. Il faut atteindre la folie du dernier duo pour distinguer de nouvelles facettes au personnage. A ce portrait sommaire s’ajoutent de menus défauts : l’aigu parfois bas, les attaques quasi systématiquement prises par en dessous. Martina Serafin remplace certes à la dernière minute. Pourtant les problèmes qu’elles rencontrent ne découlent pas d’un défaut de mise en place ou à des repères non mémorisés. Après des années à chanter des rôles lourds pour ses moyens vocaux (Isolde, Brunnhilde), la voix a achevé de s’acidifier, les aigus de vibrer. Si Ortrud peut tomber aussi bien dans le gosier d’un grand mezzo que d’un soprano à l’ambitus généreux, Martina Serafin ne répond aujourd’hui ni à l’une ni à l’autre catégorie et semble chanter le rôle comme un pis-aller. Il reste un art salutaire du sprechgesang et un engagement scénique d’autant plus remarquable que la production s’avère quasi dépourvue de direction d’acteur.

Ce n’est pas le seul problème dont souffre la proposition de Florent Siaud. On cherche encore le point de vue ou l’angle. L’œuvre est encapsulée entre deux pantomimes où Elsa et son frère observent les étoiles et les constellations. Le décor, unique et pauvre en options scénographiques, évoque une antiquité néo-classique décatie, que des soldats à l’uniforme 20e siècle viennent habiter. On brûlera quelques livres au passage sans que ce geste ne soit développé. On aurait juste pu conclure à un travail inachevé. Mais montrer une forme de fascisme sur une scène et ne rien en faire s’avère pour le moins léger.
On terminera sur une note bien plus positive concernant la direction d’Aziz Shokhakimov. Le directeur musical jouit de la préparation irréprochable de son orchestre. Celui-ci réunit deux caractéristiques a priori antinomiques : homogénéité et transparence. Quel plaisir d’entendre aussi clairement l’architecture harmonique wagnérienne, d’autant que cette démonstration n’est en rien de l’ostentation et, bien au contraire, vient soutenir un discours musical tendu, résolument théâtral. Le chef se délecte dans des pages orchestrales au rubato généreux, maintient la cohésion au seins des chœurs (un rien en sous-effectif malgré le support des forces nantaises) mais doit encore trouver le bon réglage entre la scène et le plateau. Gageons que cet art du détail au service du tout trouvera toute son ampleur au cours de la série.